La vérité du “non européen”Par Alain BERGOUNIOUX - Libération du 09/11/04
http://www.liberation.frDans l’action politique, ce ne sont pas les intentions qui priment, mais ce qui est réalisé effectivement. La logique du non n’amènerait pas plus d’Europe, mais moins d’Europe. Si d’autres pays européens disent non, ce ne sera pas pour plus d’Europe. Si nous pensons, par exemple, à l’Angleterre, cela serait contre toute perspective fédérale, à la Pologne, contre une Europe trop laïque, etc. Et, en France, les autres partis qui prennent position pour le non, ne le font pas non plus pour l’Europe, ils ont été toujours contre toutes les initiatives prises dans le passé. Jean-Pierre Chevènement dit en fait la vérité du non. Faute de solution alternative, concrète, la renationalisation des politiques est peu évitable. Or, l’Europe est une construction politique nécessairement complexe, qui a son rythme propre, qui n’avance pas en ligne droite, qui connaîtra sans doute des évolutions différenciées. Ce que l’on peut demander aux socialistes, militants d’un grand parti, c’est de bien peser les enjeux qui portent maintenant sur plus de cinquante années de la construction européenne. Autrement dit sur ce qui est arrivé de mieux aux peuples européens dans leur histoire moderne.La libre opinion de Jean-Pierre Chevènement, publiée récemment par Libération sur “Europe : un non républicain” (1), est fort intéressante. Car il dit la vérité de ce que serait un non au traité constitutionnel. L’intérêt ne vient pas de ce que Jean-Pierre Chevènement soit contre l’Union européenne telle qu’elle s’est construite depuis le traité de Rome. Il l’a toujours été avec constance... Il tient dans ce qu’il analyse ˇ il est à peu près le seul, parmi les partisans du non à gauche ˇ les conséquences d’un non.
Ce serait, enfin, l’Europe à la carte, qu’appelle de ses voeux depuis longtemps, l’ancien président du Mouvement des citoyens. Les coopérations pourraient se nouer entre les différents Etats qui sur la monnaie, qui, sur la défense, qui sur la recherche, etc. On pourrait recomposer l’Europe à partir d’un coeur franco-allemand, appelé à s’étendre à d’autres pays, par contagion. Et, par un véritable coup de baguette magique, ce serait une possibilité “de gouvernement économique de la zone euro, de révision des statuts de la Banque centrale et du pacte de stabilité budgétaire, de renouveau de la politique industrielle, etc.” Bref, ce serait une Europe des nations volontaires. Ce serait évidemment ˇ et de manière fort cohérente pour Jean-Pierre Chevènement ˇ le contraire de la perspective d’une Europe plus fédérale.
Seulement, pour en arriver là, il faut s’accorder plusieurs facilités de pensée, les unes concernant le présent, à savoir le texte du traité constitutionnel, les autres portant sur le passé (ah ! les reconstructions historiques...) et sur l’avenir.
Il vaut la peine, en effet, d’analyser le pot-pourri d’arguments proposés contre le traité constitutionnel. Tout est asséné avec autorité et, pourtant, tout est contestable. Il faut, d’abord, ne pas commencer par confondre volontairement les politiques menées et le texte du traité constitutionnel qui définit des principes, fixe des objectifs, donne des règles. La baisse des exportations européennes dans l’économie mondiale est un effet de la mondialisation et non du traité ! L’indépendance de la Banque centrale empêcherait toute politique monétaire et de change active face au dollar ? N’est-ce pas l’euro qui protège partiellement aujourd’hui les pays qui l’ont adopté, de la flambée des prix du pétrole. Hostile à son instauration hier, Jean-Pierre Chevènement n’ose plus parler aujourd’hui de sa remise en cause. Il doit y avoir une raison... Il est vrai que la Banque centrale est dite avoir pour objectif “la stabilité des prix”. Mais, il est écrit aussi, dans le texte ˇ ce qui n’est jamais cité par ses adversaires ˇ qu’elle apporte “son soutien aux politiques économiques, générales dans l’Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci”. (I-IV. chap. 2 - art. 1.30), au titre desquels figure une économie sociale de marché “qui tend au plein emploi et au progrès social” (I-I bis 1.3).
La dénonciation du principe “d’une concurrence libre et non faussée” fait aussi partie d’une ancienne critique. Passons sur le fait que ce principe existe depuis le traité de Rome, que la question centrale est de savoir à quoi s’applique la concurrence et que le traité ˇ de manière claire ˇ légitime juridiquement les services d’intérêt général, en leur donnant la garantie d’un “financement pérenne” ˇ ce qui exclut certains biens publics, à la convenance des Etats de la concurrence. Il importe de souligner que ce principe n’a pas empêché la définition et la mise en oeuvre de politiques communes, au premier rang desquelles la politique agricole commune. Ce sera le résultat des combats politiques à venir ˇ en augmentant notamment le budget de l’Union ˇ de promouvoir des politiques communes industrielles et technologiques. Mais, cela n’est ni écrit, ni non plus interdit.
La politique étrangère retient évidemment l’attention de Jean-Pierre Chevènement. Il est clair qu’en ce domaine, l’unanimité rend difficile le processus de décision, malgré la désignation d’un ministre des Affaires étrangères européen ˇ ce qui est un progrès par rapport aux traités précédents. Mais, nous sommes là au coeur de la souveraineté. Et l’Union, aujourd’hui, même avec ce traité, n’a pas une nature fédérale, elle reste une libre association d’Etats souverains qui partagent volontairement leur souveraineté dans des politiques communes. Les contradictions entre Etats européens demanderont du temps pour se réduire. On peut penser que nos intérêts communs dans un monde dangereux l’emporteront. Mais, il faudra aussi que la France accepte de mener une politique véritablement européenne... La référence à l’Otan, dans le texte ˇ qui traduit actuellement une réalité ˇ est-elle une inféodation ? Elle n’a pas empêché l’Allemagne ˇ et d’autres pays ˇ de dire non, avec la France, à la guerre en Irak. L’objectif, certes progressif, d’une politique de défense commune de l’Union est souligné (Art. 1.41). La plupart des Etats membres de l’Union étant membres de l’Otan ˇ la France, elle, appartenant à l’Alliance de l’Atlantique Nord ˇ il était inévitable d’établir un équilibre entre l’objectif d’une défense européenne ˇ avec notamment la création d’une Agence commune de l’armement ˇ et les appartenances actuelles à l’Otan.
Cette discussion de quelques-unes des affirmations de Jean-Pierre Chevènement ˇ que l’on retrouve d’ailleurs dans toutes les argumentations du non ˇ est nécessaire pour montrer qu’elles ne sont rien moins qu’évidentes. Toutefois, l’essentiel n’est peut-être pas là. Il est sans doute dans le contexte.
Ce contexte s’éclaire d’abord par l’histoire. Et là, comme dans son livre de mémoires, Défis républicains (2), Jean-Pierre Chevènement sait ce qu’est une “reconstruction historique”. Certes, l’Europe, en tant que telle, n’était pas évoquée en 1905 et le Parti socialiste était une section française de l’Internationale ouvrière. Mais, après 14-18, la nécessité d’une Union européenne a commencé à se faire jour. Léon Blum en parlait dès les années 1920. Elle s’est imposée après 1945. La SFIO, divisée sur la Communauté européenne de défense, en 1954, a porté ensuite le traité de Rome et a accepté ainsi de construire l’Europe comme un “marché commun”.
Jean-Pierre Chevènement a, certes, tenté avec une part du courant propre de François Mitterrand, d’imposer un refus de l’Europe du Marché commun. Mais, c’est pour cela que François Mitterrand a mis dans la balance son mandat de premier secrétaire, en 1973, pour imposer un compromis favorable à la poursuite de la construction européenne, quel que fût le langage utilisé dans les années 1970. C’est pour cela que Jean-Pierre Chevènement ne devrait pas continuer à s’étonner du choix européen de 1983. Il n’était pas une “parenthèse”, mais bien une orientation fondamentale. Alors, oui, c’est bien une question d’identité pour les socialistes.
Reste, le plus important, l’avenir. De la dissolution de l’Europe des 25, sortiraient, en premier cercle, des Etats nations volontaires. Et là, miracle, les problèmes et les contradictions actuels sont supposés se régler aisément : les Allemands accepteraient de renoncer à l’indépendance de la Banque centrale, de quitter l’Otan, d’adopter la laïcité, etc. Rien que dire cela montre que ˇ même dans l’hypothèse de Jean-Pierre Chevènement ˇ des compromis seraient inévitables demain. En fait, ce traité constitutionnel, porteur de progrès notables, n’a pas une autre nature. Il est un compromis, insatisfaisant pour des socialistes, mais évolutif, car la plupart des politiques qui figurent dans la troisième partie du traité sont le produit de rapport de forces politiques et non pas l’effet du traité. La plupart des partisans socialistes du non, le font au nom d’une Europe meilleure. Mais, Jean-Pierre Chevènement leur dit la vérité du non, ce sera un non tout court à l’Europe.
Car, je ne crois pas du tout qu’un retour à la situation institutionnelle, antérieure, codifiée par le traité de Nice, permettrait un nouvel élan dans l’état où sont les forces politiques européennes. Le risque serait plutôt un “détricotage” progressif de l’Union européenne et de ses politiques communes. Or, le marché unique, avec la politique de concurrence, est une politique qui a besoin de contrepoids. Et, nous n’y arriverons pas avec moins d’Europe politique. Le traité constitutionnel donne des leviers qu’il faut consolider et mettre en oeuvre. La France et, au premier chef, les travailleurs français auraient beaucoup à perdre si l’Union européenne se réduisait durablement, pour de longues années, au marché unique. C’est bien ce qu’ont dit la très grande majorité des syndicats qui composent la Confédération européenne des syndicats, en demandant d’engranger les acquis réels de ce traité, tout en poursuivant le combat pour davantage de progrès sociaux.
Dans l’action politique, ce ne sont pas les intentions qui priment, mais ce qui est réalisé effectivement. La logique du non n’amènerait pas plus d’Europe, mais moins d’Europe. Si d’autres pays européens disent non, ce ne sera pas pour plus d’Europe. Si nous pensons, par exemple, à l’Angleterre, cela serait contre toute perspective fédérale, à la Pologne, contre une Europe trop laïque, etc. Et, en France, les autres partis qui prennent position pour le non, ne le font pas non plus pour l’Europe, ils ont été toujours contre toutes les initiatives prises dans le passé. Jean-Pierre Chevènement dit en fait la vérité du non. Faute de solution alternative, concrète, la renationalisation des politiques est peu évitable. Or, l’Europe est une construction politique nécessairement complexe, qui a son rythme propre, qui n’avance pas en ligne droite, qui connaîtra sans doute des évolutions différenciées. Ce que l’on peut demander aux socialistes, militants d’un grand parti, c’est de bien peser les enjeux qui portent maintenant sur plus de cinquante années de la construction européenne. Autrement dit sur ce qui est arrivé de mieux aux peuples européens dans leur histoire moderne.



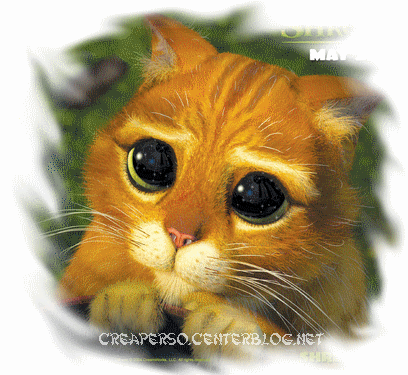

 Relis Zola.
Relis Zola.
