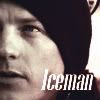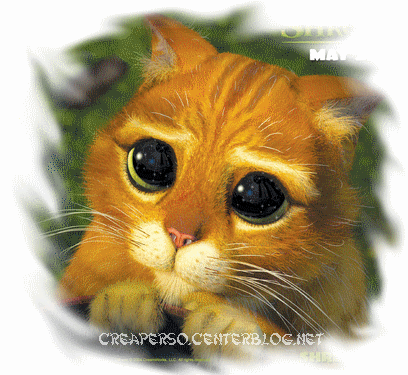de Shunt le 02 Juil 2011, 12:25
de Shunt le 02 Juil 2011, 12:25
Un édito réjouissant.
De la différence entre journaliste professionnel et amuseur du samedi soir
La plume d'Aliocha - Blogueur associé | Samedi 2 Juillet 2011 à 12:01 | Lu 228 fois
Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier ont pris des risques inconsidérés, éructent les professionnels de l’insulte sur les forums des organes de presse. Et nos soldats, ajoutent-ils, dont ils ont mis la vie en danger ? Et nos impôts qui ont servi à payer ces chasseurs de scoop ? Aliocha leur répond.
« Nous réglerons nos comptes avec eux, quand ils sortiront »
Dans un article très intéressant sur l’affaire que j’ai déjà mentionné sous le précédent billet, Raphaëlle Bacqué du Monde rappelle les premiers dérapages à l’égard des journalistes et raconte cette scène survenue en février 2010 : « A Paris, l’Elysée a aussi conscience que les déclarations des plus hautes autorités contre les otages sont devenues incongrues. Nicolas Sarkozy décide donc de recevoir enfin les familles. Les parents de Stéphane Taponier, la compagne d’Hervé Ghesquière sont donc conviés au Château. L’entretien est éprouvant. Le président est tendu. Agressif. » Nous réglerons nos comptes avec eux, quand ils sortiront », menace-t-il devant les familles accablées avant d’ajouter brutalement « mais s’il faut payer, je paierai ! ».
Entre nous je comprends, sans l’approuver, la réaction du Président de la République. Un autre à sa place se serait tu, ce qui eût été à la fois plus sage et plus élégant, mais il aurait sans doute réagi de manière similaire. Je m’explique moins en revanche cette réaction quand elle vient des citoyens qui, en l’espèce, sont les titulaires du droit à l’information sur la politique que l’on mène en leur nom. Le conflit en Afghanistan pèse lourd en termes d’intérêts stratégiques, diplomatiques et militaires. Nicolas Sarkozy est dans sa logique quand il s’irrite que des professionnels tentent d’aller au-delà de l’information officielle en sortant du giron de l’armée. Les journalistes qui veulent cherchent l’information au-delà de la communication officielle ont raison aussi. Ce sont deux logiques aussi respectables l’une que l’autre qui s’affrontent. Raison d’Etat contre liberté de l’information. Droit à la sécurité contre droit de savoir. Vivre ce type de conflit est un privilège réservé aux démocraties, nous devrions nous en féliciter. Que ceux qui dénigrent Hervé et Stéphane prennent au moins la mesure de la profondeur du débat dans lequel ils décident de prendre parti et réfléchissent un tout petit peu avant d’invectiver.
« Pas assez près »
Ce qui nous amène au coeur du problème, à savoir une soi-disant recherche du scoop. C’est aussi un argument du gouvernement. Et c’est une réaction assez naturelle du pouvoir à l’égard de la liberté de la presse. Commençons par écarter un regrettable malentendu lié à la méconnaissance du métier qui affecte tout le monde visiblement, de l’internaute mal embouché jusqu’au Chef de l’Etat. Le journalisme de guerre ne rapporte rien. Le scoop juteux, c’est dans les magazines people qu’on le trouve, c’est ça qui rapporte au journaliste et à l’organe de presse lui-même. L’information sur qui contrôle une route en Afghanistan, cette information que précisément Hervé et Stéphane sont allés chercher, elle ne vaut rien financièrement. En revanche, elle est nécessaire, voire indispensable si l’on veut comprendre une situation pour l’expliquer ensuite le plus fidèlement possible au public.
Ce qui est vrai, c’est que lorsqu’on aime ce métier, on veut aller sur le terrain, être là où les choses se passent. « Si ta photo n’est pas bonne, c’est que tu n’étais pas assez près » disait le célèbre photoreporter Robert Capa. Alors ces professionnels là vont toujours plus près, parce que c’est l’esprit même du métier, et parce que c’est aussi une exigence professionnelle. Ravaler cela au rang de simple chasse au scoop, c’est aussi stupide qu’insultant. Des journalistes envoyés dans des pays en guerre, il y en a deux catégories. Ceux qui restent à l’abri de l’armée, embedded, comme on dit, et voient ce qu’on leur montre, répètent ce qu’on leur dit. Et puis ceux qui pour le même salaire et pas davantage de reconnaissance ou de notoriété (qui connaissait Hervé et Stéphane avant qu’on les enlève ?) décident de faire vraiment leur boulot, d’aller chercher eux-mêmes l’information…. ce qui suppose de prendre des risques. Pour le public, la différence au final est infime, voire invisible, c’est donc aussi facile que tentant de rester bien à l’abri et de rapporter un reportage superficiel, bâclé. De fait, ceux qui leur crachent au visage ne s’aperçoivent même pas qu’ils insultent les meilleurs d’entre nous, ceux qui risquent leur peau précisément pour rapporter une information de qualité, pour ne pas se laisser piéger par les apparences et les mensonges officiels, pour ne pas tomber dans les travers qu’on reproche habituellement aux journalistes. Accessoirement, ils envoient un dangereux signal aux médias en montrant qu’ils ne font pas la différence entre un bon et un mauvais travail journalistique. On ne peut pas dire que ce soit très encourageant.
Les risques du métier
Peu importe, me dira-t-on, au final leur inconscience a mis nos soldats en péril et nous a coûté de l’argent. Non, ils n’ont pas fait preuve d’inconscience. Ce sont des reporters chevronnés. A eux deux, ils ont couvert l’ex-Yougoslavie, le Rwanda, l’Irak, et d’autres conflits encore. Ils avaient pris toutes les précautions, je vous renvoie à ce sujet à l’excellent papier de Libération. Lisez-le, prenez le temps de visionner la vidéo où Hervé s’explique. Ecoutez les centaines de journalistes présents applaudir quand il dit qu’il faut continuer d’aller sur place. Ils ont fait leur travail, dans une zone à risque, et ils ont été piégés. Comme auraient pu l’être à leur place des ingénieurs, des humanitaires ou tout autre professionnel intervenant dans un pays en guerre. Et puisqu’on parle d’impôts et de vies humaines, n’est-ce pas important de savoir si notre présence là-bas est utile, légitime, et donc au final de comprendre pourquoi on y dépense nos impôts et on y risque la vie de nos soldats ? Comment répondre à ces questions si personne n’a le courage d’aller sur place, pour vérifier ce qu’il s’y passe ?
Nous continuerons d’aller sur le terrain
Il ne s’agit pas d’en faire des héros, eux-mêmes ne se vivent pas ainsi. Revoyez leur arrivée sur le tarmac. La première réaction d’Hervé a été de dire « d’habitude, je suis de l’autre côté », c’est-à-dire de l’autre côté des objectifs. Elle n’a l’air de rien cette petite phrase et pourtant, elle est lourde de sens. Elle signifie « nous ne sommes pas à notre place ici, laissez-nous revenir parmi vous confrères, nous ne sommes pas intéressants, c’est le monde qui est passionnant. Il y a encore tant de choses à voir, à comprendre, à raconter, ne perdons pas notre temps ». Leur numéro de duettiste, leur humour poussé jusqu’à l’auto-dérision, tout démontre à qui veut bien regarder avec la même objectivité que celle qu’on exige de nous, la même attention à l’autre, la même sensibilité, la même absence de préjugé, qu’ils ne sont pas à l’aise dans ce rôle-là, que leur raison d’être à eux c’est de se tenir derrière les caméras, pas devant. Qu’ils n’ont qu’une hâte, comme ils l’ont dit tous les deux, c’est de reprendre le travail. Eh oui, ce travail qui leur a coûté 547 jours de leur vie. Vous pensez qu’on peut faire ça pour une autre raison que la passion ?
Thierry Thuillier, directeur de l’information de France Télévision a lancé un message hier : « Notre honneur, c’est d’aller sur le terrain et nous continueront à le faire. »
Notre honneur…
Je comprends d’autant mieux l’irritation que suscitent les médias que je la ressens moi-même de manière extrêmement violente parfois. Mais bon sang, un peu de discernement, ne mélangeons pas l’amuseur public du samedi soir et le journaliste professionnel, le traqueur de cul de star au téléobjectif et le reporter de guerre. Sinon, à terme, il ne restera que le pire.