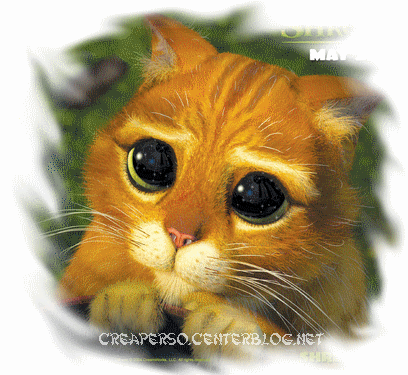Neoflo a écrit:qu'elle nous éloigne de notre prime nature
Tu sous-entends donc que dans la nature de l'homme il y a la notion de nature (sous la forme de terre, d'eau, des arbres)... ce qui n'est pas acquis pour moi.
On retrouve donc bien dans ce film et dans tes propos, cet ancrage très important de la religion, qui transparait pour moi via tous ces éléments.
En quoi l'homme est-il rattaché à la nature ? En quoi le fait de s'emerveiller sur la beauté de la nature doit-il nous renvoyer à une sorte de commencement ?
Par Nature, je ne crois pas que tu doives lire seulement arbre, eau, terre..)
Par Nature, il faut lire, le Monde.
Nous sommes arrachés à la contemplation du Monde, dans le sens où nous vivons toujours dans un ailleurs, toujours dans la poursuite d'une félicité (que nous nous fixons) à venir, sans même voir le Monde tel qu'il est dans l'instant présent. Au lieu de voir la Terre, nous cherchons l'Univers, au lieu de voir le Monde, nous cherchons le moi.
Ce sont ces Indes que poursuit John Smith.
C'est cette réussite professionnelle que poursuit Mr O'Brien.
Avant, cette quête d'ailleurs, que nous assouvissions par les oeuvres, nous ramenait au Monde, nous réconciliait avec l'acceptation de notre finitude.
Mais dans une société où le travail n'est souvent plus qu'avilissant et ne permet plus de se réaliser, pour faire accepter cette vie misérable, les oeuvres sont détournées de leur usage. On contrôle l'ailleurs l'imaginaire, pour mieux faire accepter cette vie mutilée. D'où cette peinture de surhommes, d'où des êtres dénués de limites, d'où
Tu peux ne pas partager le constat du dernier paragraphe. Mais dire le reste, ça n'est pas transmettre un propos forcément religieux. C'est ce qu'écrivait, sous d'autres mots, Heidegger. C'est ce que dit Malick.
Nous sommes des Êtres jetés dans le Monde. Par essence, nous ne savons tout à fait être. Nous sommes détourné de l'être en permanence par la quotidiennté.
Pourtant nous pouvons nous approcher de l'être, que nous entendons, indistinctement, en contemplant le Monde, en décidant de l'habiter, au lieu de le transformer, par la Technique. Ou dit autrement, poursuivre cet ailleurs toujours insatisfaisant.
Contempler le monde s'acquiert par exercice, par habitude, par goût. Contempler c'est un des fruits inestimable de l'éducation, elle, l'éducation, qui prépare notre cerveau à l'accueil du monde par l'accueil préalable des choses qui ne relèvent pas de l'expérience et du vécu. Plonger ses yeux dans les oeuvres, nous constitue un cerveau de réserve pour sentir et juger, pour mémoriser et exercer la réflexion. Le cerveau a un besoin urgent de distance par rapport à l'expérience immédiate, la sensation tyrannique, la dictature de la réaction. Contempler, c'est créer en soi une chambre de protection et une chambre de restitution créative du réel, où nait la vraie beauté du monde, une remontée de l'intime qui se fait à partir des mémoires délaissées de notre vie. De notre vraie vie.
Pas celle qui est absorbée, inquiétée, mobilisée pour "toutes fins utiles ". Pour ce que Heidegger appelait la quotidienneté.
L'invisible ainsi est l'écorce vive du réel.
Pocahontas montre finalement qu'elle est partout chez elle. Que partout il y a à contempler. Elle nous apprend à habiter le Monde.
Mais tout ça, silverwitch en parlera mieux que moi.
Hugues (qui n'en est pas pour autant absolument d'accord avec Shoemaker, sur tout ce qu'il a écrit, quelques passages prêtent à débat, mais dans l'ensemble c'est très juste)