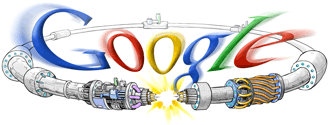*
Interview - Elie Aslanides, physicien au CNRS, explique les missions du LHC, l'accélérateur de particules mis en service aujourd'hui. Et balaie les scénarios catastrophes évoqués ici et là.
Propos recueillis par Matthieu DURAND - le 10/09/2008 - 09h00
Le "LHC", l'accélérateur de particules le plus puissant du monde, entre en service ce mercredi à 9h (suivez cette première journée historique en direct sur LCI.fr). Directeur de recherche émérite au CNRS, le physicien Elie Aslanides est le responsable français d'une des quatre expériences menées par le Cern au LHC.
LCI.fr : A quoi sert l'accélérateur de particules LHC ?Elie Aslanides : A créer des conditions d'expérimentation, d'énergie ou de température, de plus en plus proches de celles qui ont prévalu au début de l'Univers, soit d'un temps inférieur à un milliardième de seconde. Le LHC est une sorte de chambre à vide circulaire, de 27 kilomètres, enterrée à 100 mètres sous terre, afin d'éviter les radiations.
Dans le LHC, qui est équipé d'aimants supraconducteurs maintenus à une température proche du zéro absolu, soit -271,3° Celsius, nous allons faire circuler deux faisceaux de protons en sens opposés, les accélérer puis les obliger à collisionner en quatre points précis, où se situent les détecteurs [dont le CMS ; voir le reportage : Plongée dans l'accélérateur de particules, NDLR]. L'énergie des faisceaux du LHC est sept fois plus élevée que celle des faisceaux de l'accélérateur Tevatron du Laboratoire Fermi, près de Chicago, et leur intensité, trente fois plus importante.
LCI.fr : Des citoyens entourés de certains scientifiques se sont émus des risques liés au démarrage du LHC. On parle de la création de mini trous noirs, voire d'un nouveau Big Bang. Faut-il s'inquiéter ?E. A. : Des groupes d'études se sont penchés sur la sécurité du LHC dès 2003. Il n'y a pas à avoir peur. La Terre est exposée en permanence à des rayons cosmiques. Par ailleurs, l'énergie du LHC, même si elle n'a jamais été atteinte jusqu'à présent, reste très inférieure à celle produite couramment par les corps célestes. On a calculé que l'Univers avait survécu à plus de 100.000 expériences de type LHC.
Un trou noir, ce sont des corps célestes dont la masse représente des millions de soleils qui s'écroulent au moment de mourir. Et cette masse est tellement élevée qu'elle engloutit tout son voisinage. Pour comparaison, le LHC accélère un millionième de millionième d'un gramme d'oxygène ! Quant aux minis trous noirs, ils ne vivent que d'infimes fractions de secondes, ce qui ne leur donnerait pas le temps de s'agglutiner et de former de vrais trous noirs. Scientifiquement, ces soi-disants risques ne tiennent pas la route.
LCI.fr : Des experts estiment que les collisions menées au LHC pourraient remettre en cause certaines thèses scientifiques établies. De quelle manière ?E. A. : Parmi les nombreux objectifs du LHC, le premier d'entre eux est la compréhension de l'origine de la masse des particules élémentaires. Ces particules sont les éléments constituants de la masse de l'Univers. Pour schématiser, c'est à partir de quelques particules élémentaires que se composent les noyaux, les atomes, la matière macroscopique... Depuis une quarantaine d'années, il existe un cadre de description théorique, le modèle standard de la physique des particules et de leurs interactions. Toutes les prédictions et particules "prédites" par ce modèle ont pu être confirmées lors d'expériences. La seule prédiction de ce modèle qui échappe encore à l'observation, est l'existence d'une particule "spéciale", indispensable au mécanisme à l'origine de la masse, appelée le boson de Higgs.
"Devoir se remettre
en cause, c'est une
des meilleures façons
d'avancer
Elie Aslanides
Les scientifiques estiment que le LHC permettra de détecter le boson de Higgs et par conséquent, de valider la théorie ; on pourrait aussi découvrir d'autres particules révélatrices d'une physique nouvelle. Si cela n'était pas le cas, il y aurait certainement beaucoup de certitudes à revoir et de nouvelles interprétations à chercher. Mais je fais partie de ceux qui estiment que si les choses ne se passent pas comme prévu, il n'y aura pas de quoi être déçu : devoir se remettre en cause, c'est une des meilleures façons d'avancer.
LCI.fr : Donc pas de risque que les expériences menées n'aboutissent à rien ?E. A. : Non, c'est un vaste champ d'observation qui s'ouvre et qui apportera des résultats dans tous les domaines. Peut-être découvrira-t-on des particules candidates à la composition de la matière noire, laquelle représente 96% de l'Univers. Le LHC va fournir une production inégalée de quantités de particules et d'antiparticules.
LCI.fr : Le LHC est un instrument de recherche fondamentale pure. Pas d'application concrète en perspective ?E. A. : En tant que physicien, rien que le progrès des connaissances, c'est déjà impressionnant ! Maintenant pour faire ces découvertes, il a fallu construire un accélérateur et des détecteurs bourrés de haute technologie : matériaux, électronique, informatique... Ces avancées se retrouveront à terme dans de nombreuses applications. L'analyse des données a également forcé chercheurs et informaticiens à inventer de nouvelles manières de gérer les puissances de calcul mondiales via leur mise en réseau. Avancées également dans le domaine de la communication, du transfert et de l'échange de données par fibres optiques à très haut débit - plus d'un gigabit par seconde.
LCI.fr : C'est d'ailleurs au Cern qu'est né le world wide web...E. A. : Vous avez raison de le rappeler. Ce n'est pas que nous, au Cern, soyons plus intelligents que d'autres, mais il a fallu inventer des techniques précises d'information pour faire nos expériences et partager les données.
LCI.fr : Quelle rôle la France joue-t-elle au sein du Cern ?E. A. : La France finance 15% du budget du Cern et 16% du LHC - 6 milliards de francs suisses ont été investis dans l'accélérateur et 4 milliards dans les expériences et l'analyse des résultats. Plus de 440 physiciens et ingénieurs français participent au LHC, sur un total de 10.000 collaborateurs. Au sein du CNRS, du CEA et de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3), les équipes françaises jouent un rôle important, visible et reconnu par la communauté scientifique internationale.
LCI.fr : Paradoxalement, le CNRS est au cœur de la réforme de la recherche publique française. Qu'est-ce que cela vous inspire ?E. A. : Le CNRS est une organisation de recherche fondamentale de très haut niveau, pluridisciplinaire que le monde entier nous envie. Il est très important de noter que les critiques à l'égard du CNRS représentent un amalgame de plusieurs domaines : l'ouverture au monde industriel existe déjà, peut-être faut-il l'améliorer ? Idem pour l'organisation. Mais certains atouts devraient être étudiés avec plus de sérénité.
Evidemment, la recherche fondamentale se doit d'utiliser l'argent public correctement et dans une direction conduisant à des retours et à des bénéfices. A la base, ce qui gène certains dirigeants, c'est la liberté de recherche. Or, comment savoir et programmer des choses non prédictibles ? C'est un fait : les plus grandes découvertes sont celles qui n'étaient pas prévues.
et un commentaire d'une personne qui vit dans le merveilleux monde de Candy et de Thierry Messan





le 10/09/2008 à 11h21, Cécile (Antibes) a écrit:Il est surprenant de voir qu'avec ce projet coûtant quelques milliards, on ne puisse trouver aujourd'hui aucun traitement contre les cancers par exemple !!!! Chose qui me paraît beaucoup plus importante, sauver des vies. Et dire qu'il y a des milliers d'enfants en train de mourir de faim dans le monde, ne me dite pas que ce genre d'expérimentation ne tente pas à découvrir également de nouvelles armes.