Vraiment indispensable décidément !
Hugues (bon j'arrête ... #nièmedegré #autodérision #vautmieuxpréciser #cesttristequonsoitobligémaintenant )
Modérateurs: Garion, Silverwitch
Hugues a écrit:Et puis il fallait désamorcer les propos de Cyril

Hugues a écrit:Même si, désolé mon cher mais la filmographie de Bud Spencer est assez médiocre. Ca n'est parce que les personnages étaient cultes, et par extension l'acteur, que les films étaient bons.
Ensuite, Aiello a raison, chez Forestier, amoureux des nanars écrire ça c'est un bel hommage à sa façon.. Je ne sais pas si tous les lecteurs l'ont compris.




Nuvo a écrit:Nostalgique d'une époque où on croyait que la politique pouvait changer les choses...
Si jamais vous ne savez pas où situez Rocard, sachez que Valls se réclame du "rocardisme". Tout est dit.


Sylphus a écrit:Le paillasson de Mitterrand est décédé...
Plus sérieusement, Rocard aura contribué à ruiner la France, à la plonger dans l'horreur avec quelques mesures tristement célèbres comme le RMI et surtout la CSG, une saloperie fiscale injuste que nous continuons à payer.
Autre point noir : sa phrase non assumée sur "La France ne peut accueillir toute la misère du monde", pourtant très vraie.
Si jamais vous ne savez pas où situer Rocard, sachez que Valls se réclame du "rocardisme". Tout est dit.


Sylphus a écrit:mais BHL est un peu ma boussole : là où il va, je vais à l'opposé. Vu que Wiesel était me semble-t-il un de ses amis proches, j'en tire certaines conclusions.
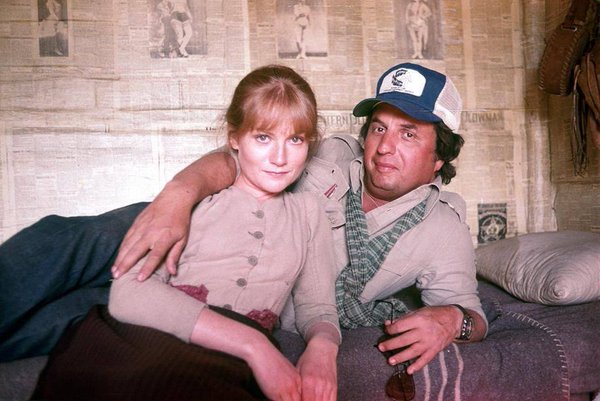

Hugues a écrit:Mais je pense le contraire.. Qu'il n'a rien accompli. Qu'il a tout abandonné au marché.
Hugues

Hugues a écrit:Voyage au bout de l'enfer (1978)


Algérie : Michel Rocard a sauvé des milliers de vies
Sur France 5, Une histoire algérienne, le documentaire de Ben Salama, diffusé dimanche, revient sur les destins de la guerre d'Algérie.
Par Emmanuel Berretta
En février 1959, Michel Rocard n'est alors qu'un jeune inspecteur des finances. Le rapport qu'il remet à sa hiérarchie sur les conséquences dramatiques du déplacement des populations paysannes va sauver des centaines de milliers de vies. Ce rapport alerte les autorités françaises sur la famine qui sévit dans les camps de regroupement. Auront lieu alors les premiers soins et l'afflux de vivres. Parmi ces enfants musulmans sauvés par le rapport Rocard se trouve Ben Salama, l'auteur du documentaire, Une histoire algérienne, diffusé, dimanche, à 22 heures sur France 5.
"J'ai mangé grâce à lui, se souvient le documentariste que Le Point.fr a rencontré. Le matin, quand on se levait le ventre vide, nous n'étions pas sûrs de pouvoir manger. Grâce à Michel Rocard, la nourriture est arrivée au printemps." C'est un aspect assez méconnu de la guerre d'Algérie : à partir de 1957, l'armée française a déplacé jusqu'à deux millions de paysans pour les soustraire à l'influence du FLN, soit la moitié de la population musulmane rurale. Ce faisant, on privait ces chefs de famille de leurs terres, de leur bétail, et donc de leurs moyens de subsistance.
L'horreur des camps de regroupement
"J'ai été déplacé de 1957 à l'indépendance, raconte Ben Salama. Nous avons vécu à six dans une petite pièce avec ma mère, car mon père travaillait en France. Les gens agglutinaient du matériel de récupération pour se fabriquer des baraquements de fortune." À l'époque, il vivait en Kabylie, près de Bougie (aujourd'hui Bejaïa). "Mon avis, c'est que sont mortes de faim 200 000 personnes et en majorité des enfants", conclut Michel Rocard devant la caméra de Ben Salama.
Le parcours du documentariste est singulier et lui permet de réaliser un film où toutes les douleurs sont respectées : celle des musulmans, celle des harkis, celle des rapatriés, celle des appelés, comme l'ancien ministre Jean-Pierre Soisson jeté dans l'horreur d'une guerre qu'il ne comprend pas... Né français sous la colonisation, Ben Salama devient algérien à l'indépendance. Passionné de cinéma, il fréquente la cinémathèque d'Alger, y croise Truffaut, Godard, etc. Si bien qu'en 1972 il réussit le concours de l'Idhec, à Paris, et vient étudier le cinéma grâce à une bourse. Au début des années 1980, il décide alors de réintégrer la nationalité française de sa naissance. "Parce que ma vie était à Paris, que j'aime la France, ses valeurs", lâche-t-il.
Juger les gens à leur enfer
Dans sa famille, les liens avec l'Hexagone sont anciens. En 1917, durant la Grande Guerre, son grand-père déjà avait quitté l'Algérie et travaillait dans le sud de la France pour le compte d'une usine qui fabriquait du gaz de combat. En 1938, ce grand-père est rejoint par son fils de 16 ans. Le père de Ben Salama, disparu en 2003, n'est jamais retourné en Algérie. Tout le documentaire de Ben Salama traduit la complexité, les choix de ces destinées prises au piège des événements et de l'enchaînement infernal à partir du moment où la guerre s'enclenche. "Dans tous les conflits armés, ce sont les ultras des deux bords qui mènent la danse", observe Ben Salama.
Une histoire algérienne recueille les témoignages dépassionnés de ceux qui ont, de tous côtés, connu l'horreur de cette danse macabre. Zohra Drif, la poseuse de bombes du FLN, devenue depuis la présidente de l'association Algérie-France au sénat algérien, fait part de sa compassion pour les victimes du camp adverse : "On imagine ce que l'autre a souffert, parce que nous, dans notre chair, on l'a vécu depuis très longtemps." Témoignage également bouleversant de Raphaël Draï, politologue français, rapatrié, absolument dépourvu de ressentiment, qui livre sa réflexion à travers une citation de l'écrivain Marcel Arland : "Il faut juger les gens à leur enfer." "Ce film m'a servi de thérapie", confie l'auteur qui, dernier mouvement de balancier à l'âge mûr, vient de récupérer un passeport algérien en plus de sa nationalité française. "J'ai senti qu'il y avait une envie chez mes enfants de ce retour aux origines," glisse-t-il.
Dans son ouvrage L'Industrie de l'Holocauste, Norman G. Finkelstein reproche à Elie Wiesel d'instrumentaliser l'Holocauste nazi pour défendre, notamment, la politique israélienne. De son côté, Alain Gresh qualifie Wiesel d'« imposteur moral qui mériterait un traitement différent dans les médias » (wiki)
Aiello a écrit:Dédé la Sardine, 97 ans (c'est le moment de le mettre en boîte).

Cortese a écrit:Aiello a écrit:Dédé la Sardine, 97 ans (c'est le moment de le mettre en boîte).
Ah merde ! Je rêvais de le rencontrer. C'était le voisin d'un copain corse. Les mémoires de ce ce cinglé sont hilarantes.




Marlaga a écrit:qui est tout de même le plus important défunt de la journée d'hier, quoiqu'en dise Hugues,

porcaro77 a écrit:Message modéré [...] la mort du pacifiste Wissel.

LeFigaro.fr a écrit:Mort de Michael Cimino, grand cinéaste incompris de l'Amérique
Par Olivier Delcroix Publié le 03/07/2016 à 10:05
Michael Cimino est mort à l'âge de 77 ans. Considéré aussi bien comme un génie que comme un cinéaste maudit à Hollywood, il laisse derrière lui des œuvres aussi fortes que dérangeantes.
DISPARITION - Décédé à l'âge de 77 ans, ce génie atypique du Nouvel Hollywood aura enfin vu s'ouvrir La Porte du paradis après son Voyage au bout de l'enfer. Son œuvre aussi géniale que dérangeante aura marqué au fer rouge le cinéma américain.
Il n'avait pas touché une caméra depuis plus de vingt ans. The Sunchaser, sorti en 1995, restera son dernier film. Michael Cimino est «mort en paix, entouré des siens et des deux femmes qui l'aimaient» a indiqué le directeur général du Festival de Cannes Thierry Frémaux dans un tweet daté du samedi 2 juillet à 21h52, dévoilant la nouvelle au public français.
Michael Cimino s'en est donc allé à l'âge de 77 ans. Réalisateur américain aussi génial que maltraité, c'est l'une des figures légendaires du cinéma hollywoodien des années 1970-80, qui tire ainsi sa révérence, sans bruit et sans fureur, alors que ses films, de Voyage au bout de l'enfer, à L'Année du Dragon, en passant par Le Canardeur ou même La Porte du Paradis, en sont gorgés.
Un «Madmen» repéré par Clint Eastwood
Né le 3 février 1939 à New York, Michael Cimino est assez vite qualifié de «petit prodige de Long Island». Diplômé en arts au Michigan State University, il poursuit ses études Yale en se spécialisant dans le théâtre et l'architecture. Mais c'est d'abord du côté des agences publicitaires de Madison Avenue (les fameux «Madmen», représentés dans la série éponyme) qu'il fait carrière en réalisant quelques spots publicitaires mémorables.
En 1972 pourtant, il met un pied dans le cinéma, en collaborant au film de science-fiction de Douglas Trumbull (le directeur des effets spéciaux du 2001 L'Odyssée de l'espace de Kubrick) Silent Running, avec Bruce Dern. Ce premier space opera écologique, qui annonce à la fois Soleil Vert et Star Wars, lui met le pied à l'étrier.
Quatre ans plus tard, il est repéré par Clint Eastwood qui lit, apprécie et achète le script d'un film qui deviendra Le Canardeur. Eastwood fait totalement confiance à ce petit jeune homme, tout de noir vêtu, qui passe son temps à lire de la littérature russe, de Nabokov à Pouchkine, sans oublier Tolstoï, Lemontov ou Tchekhov. Le grand Clint vient de lancer sa maison de production Malpaso.
Il confie à Cimino les clefs de la réalisation du Canardeur (Thunderbolt and Lightfoot en version originale). Mi-comédie picaresque, mi-road-movie existentiel et subversif, le premier film de Cimino est une ode aux paysages sauvages des États-Unis. Les deux braqueurs doux dingues que sont Eastwood et Jeff Brigdes, traversent les plaines de l'Ouest, en semant le chaos et en faisant parler la poudre, dans une sorte de synthèse étonnante entre le western à la John Ford et le thriller façon Don Siegel.
Voyage au bout de l'enfer, l'anti-Apocalypse Now
Fruit atypique du Nouvel Hollywood, Cimino poursuit sa route avec un authentique chef-d'œuvre, Voyage au bout de l'enfer (The Deer Hunter), réalisé en 1978. La guerre du Vietnam hante alors l'Amérique. En suivant le destin de trois personnages (Robert De Niro, Christopher Walken et Meryll Streep) pris dans la tornade de cette effroyable guerre, Cimino signe un film aussi violent que magistral, salué par le Tout-Hollywood, et qui récoltera cinq Oscars, dont celui du meilleur réalisateur. C'est un peu l'anti-Apocalypse Now de Coppola. On se souviendra longtemps de la séquence de la roulette russe, dont Spielberg avoua un jour à Cimino qu'elle resterait pour lui un grand moment de mise en scène et de tension cinématographique.
Vient alors le temps de La Porte du paradis (Heaven's Gate). Cimino est considéré comme le «wonder boy du cinéma américain». On lui alloue un budget exceptionnel de 40 millions de dollars pour son western allégorique de 3h39, avec Isabelle Huppert, Chris Kristopherson et Christopher Walken. Fresque ambitieuse suivant la vie de James Averille et sa participation à la «guerre du comté de Johnson» qui vit se dresser en 1890 de pauvres immigrants d'Europe de l'Est face à de riches propriétaires de bétail du Wyoming, le film sera un cuisant échec, tant commercial que critique.
Renaissance avec L'année du dragon
Cimino entre alors dans la catégorie des cinéastes maudits. D'aucuns disent qu'il vient à lui seul d'enterrer le cinéma américain d'auteur, et qu'il met fin à l'ère du Nouvel Hollywood. Après une longue période de purgatoire, Cimino revient aux affaires comme on renaît de ses cendres, avec un polar crépusculaire, explosif et violent L'année du Dragon, sorti en 1985. Adapté du livre de Robert Daley paru en 1982, le film met en scène un flic revenu de tout, Stanley White, magnifiquement incarné par Mickey Rourke, qui débarque à Chinatown pour mettre un terme à la vague de violence qui s'abat sur le quartier chinois de New York durant les fêtes du Nouvel An.
Oliver Stone et Cimino troussent un script implacable, lyrique, violent, sans concession. La mafia chinoise issue des Triades y est décrite comme beaucoup plus dangereuse que la mafia italienne. C'est ainsi que le héros du film, immigré polonais revenu traumatisé par le Vietnam, même s'il est le «flic le plus décoré de la ville», se comporte comme un va-t-en guerre. Sa phrase fétiche, «Je veux le chaos!», en dit long sur le personnage: Stanley White mène un combat qui ressemble à une croisade purificatrice contre le crime organisé. C'est sans doute pour cela que le film créera à nouveau la polémique à sa sortie, étant taxé de film «raciste».
Il rêvait de mettre en scène un film sur le Tour de France
Cimino, revenu de tout, déclara lors d'une interview en 2014 pour le magazine Sofilm: «Moi, on m'a collé toutes les étiquettes. J'ai été traité d'homophobe pour Le Canardeur, de fasciste pour Voyage au bout de l'enfer, de raciste pour L'année du Dragon, de marxiste pour La Porte du Paradis et de violent pour La Maison des otages…»
Même si le film provoqua un scandale, L'année du Dragon reste le dernier grand sursaut du Cimino. Le Sicilien (1987), La Maison des otages (1990) et The Sunchaser (1995) sont des œuvres mineures en regard des autres films qu'il aura signé tout au long de sa carrière.
Ses dernières années, Cimino qui vivait retiré des plateaux de cinéma, songeait à revenir derrière la caméra. Celui qui mettait au pinacle John Ford, Akira Kurosawa et Luccino Visconti rêvait de mettre en scène un film sur le Tour de France, d'adapter le roman de Malraux La Condition humaine, et formait même le projet de réaliser un film en langue sioux.
Le chaos aura eu raison de tout cela. Reste une œuvre fondatrice, dérangeante, puissante. Une œuvre cinématographique aussi précieuse qu'accidentée qui aura marqué le cinéma américain au fer rouge.
LeMonde.fr a écrit:Michael Cimino passe la porte du Paradis
LE MONDE | 03.07.2016 à 09h02 • Mis à jour le 03.07.2016 à 12h29 | Par Isabelle Regnier
Le cinéma lui doit deux des plus grands films de son histoire. Deux fresques historiques portées par un souffle épique et une puissance incantatoire inouïes, et travaillées en sourdine par une méditation sur le temps, la perte, la condition humaine. Voyage au bout de l’Enfer (1978), premier film américain critique de la guerre du Vietnam, dépeinte comme le cauchemar halluciné d’une Amérique en pleine dislocation, et La Porte du Paradis (1980), évocation de la naissance de cette nation légendaire dans la violence d’un crime de masse.
Liberation a écrit: Michael Cimino, la fin du voyage
Par LIBERATION — 3 juillet 2016 à 07:45
Le réalisateur américain de «Voyage au bout l'enfer» est mort à 77 ans.
Le scénariste et réalisateur américain Michael Cimino, dont le décès a été annoncé de sources concordantes, a marqué le cinéma par son film Voyage au bout de l’enfer sur la guerre du Vietnam, lauréat de cinq oscars en 1979.
Né à New York le 3 février 1939 (date communément retenue, faute de date officielle) d’un père éditeur de musique et d’une mère styliste, il obtient une licence puis un master en peinture, respectivement à l’université de Yale (1961) et à celle de New Haven (1963), avant de réaliser des spots publicitaires pour la télévision. En 1971, il s’installe à Los Angeles et se lance dans l’écriture de scénarios comme Silent Running, récit de science-fiction écologique, l'Inspecteur Harry, Magnum Force, avant de réaliser Thunderbolt and Lightfoot (le Canardeur) en 1974, avec notamment Jeff Bridges et Clint Eastwood qui produit le film.
La guerre du Vietnam
Le vrai succès arrive avec Voyage au bout de l’enfer (1978), film de plus de trois heures et un des premiers à évoquer la guerre du Vietnam, à travers la vie de trois amis. Outre l’oscar du meilleur film, remporte celui du meilleur acteur dans un second rôle (Christopher Walken), du meilleur réalisateur, du meilleur montage, du meilleur mixage de son.
A contrario, la Porte du paradis (Heaven’s Gate, 1980) ne reste à l’affiche qu’une semaine. Egratignant le mythe fondateur du melting-pot, cette saga est un fiasco critique et financier, fatal pour United Artists qui avait grandement investi pour ses 3h40 de projection.
Même raccourci d’une heure, il reste un échec jusqu’à ce qu’en août 2012, Cimino en dévoile une version intégrale remastérisée qui trouve enfin son public. Le directeur de la Mostra de Venise, Alberto Barber, qualifie même de «chef-d’œuvre absolu» cette évocation du combat sanglant de riches éleveurs du Wyoming contre des immigrés d’Europe centrale, avec l’accord tacite des autorités fédérales.
Cimino doit attendre cinq ans pour revenir en grâce en 1985 avec l’Année du dragon, sur la mafia chinoise, mais la communauté asiatique l’accuse de racisme. Suivent trois échecs commerciaux : le Sicilien en 1987, sur le bandit Salvatore Giuliano, que ses détracteurs l’accusent de glorifier, Desperate Hours, remake de la Maison des otages de William Wyler, en 1990, et The Sunchaser en 1996, road movie sur les Navajos dans les montagnes du Colorado.
Lorsque la caméra lui fait défaut, Cimino s’exprime par l’écriture, notamment avec Big Jane, un beau portrait de femme et de l’Amérique des années 50 publié chez l’éditeur français Gallimard en 2001, faute d’éditeur américain. Ce roman lui vaut la même année le prix littéraire du Festival du film américain de Deauville (France). On peut citer également Shadow Conversations (Conversations en miroir), livre de mémoires, et Hundred Oceans, roman autoportrait.
En 2001, la France, où il aimait résider, avait remis à Michael Cimino la médaille de chevalier des arts et des lettres, décoration qui, disait-il, le touchait plus que toutes les autres.
AFP a écrit:Mort de Michael Cimino, réalisateur de «Voyage au bout de l’enfer»
Par AFP — 3 juillet 2016 à 06:38 (mis à jour à 11:29)
Le réalisateur et scénariste américain Michael Cimino, qui aura marqué l’histoire du cinéma avec son épopée, le film «Voyage au bout de l’enfer», est mort samedi à Los Angeles à l’âge de 77 ans.
Son décès, annoncé par un tweet du directeur du festival de Cannes Thierry Frémaux, puis par le New York Times, citant un ami, a été confirmé par le Service de médecine légale de Los Angeles.
Le corps du réalisateur a été retrouvé à son domicile, et les causes de la mort restent à déterminer, a indiqué à l’AFP le lieutenant B. Kim.
Selon un ami de Cimino, l’ancien avocat Eric Weissmann, cité par le New York Times, le corps a été découvert après que des proches eurent en vain essayé de le joindre au téléphone.
L’ancien président du festival de Cannes Gilles Jacob, qui, en 2007, lui avait commandé son dernier film - un court métrage pour les 60 ans du festival -, l’avait vu à Paris il y a trois mois.
«Il allait bien, il ne donnait pas l’impression d’être souffrant». «Il m’avait apporté un roman» qui ne trouvait pas d’éditeur aux Etats-Unis, raconte-t-il.
Michael Cimino aura marqué le cinéma par son «Voyage au bout de l’enfer» («The Deer Hunter»), une épopée de trois heures qui évoque la guerre du Vietnam à travers la vie de trois amis.
Dans une des scènes passées à la postérité, les personnages incarnés par Robert De Niro et Christopher Walken, prisonniers des Nord-Vietnamiens, jouent à la roulette russe.
Le film récoltera cinq Oscars en 1979 dont celui du meilleur film, et de meilleur réalisateur pour Cimino.
«Notre travail ensemble est quelque chose dont je me souviendrai toujours», a réagi samedi Robert de Niro, pour qui «il va beaucoup manquer».
Né à New York le 3 février 1939 (date communément retenue faute de date officielle) d’un père éditeur de musique et d’une mère styliste, Michael Cimino étudie la peinture, à l’université de Yale et à New Haven. Puis il réalise des spots publicitaires pour la télévision.
En 1971, il s’installe à Los Angeles et se lance dans l’écriture de scénarios comme «Silent Running», récit de science-fiction écologique, «L’Inspecteur Harry», «Magnum Force», avant de réaliser «Thunderbolt and Lightfoot» («Le Canardeur») en 1974, avec notamment Jeff Bridges et Clint Eastwood qui produit le film.
- Fiasco financier -
Le succès viendra avec «Voyage au bout de l’enfer», en 1978.
A contrario, «La porte du paradis» («Heaven’s Gate», 1980) n’est à l’affiche qu’une semaine. Egratignant le mythe fondateur du melting pot, cette saga est un fiasco critique et financier, fatal pour United Artists qui avait grandement investi pour ses 3H40 de projection.
«Il voulait soi-disant battre en budget Coppola et +Apocalypse Now+», dit Gilles Jacob. «A la longue, c’est Coppola qui aura gagné cette +rivalité+, car il aura fait plus de films. En tout cas, ils sont comparables, dans leur folie qui confine au génie», ajoute le Français, qui décrit aussi son ami comme un homme à l’abord «très doux».
Dans une interview au magazine américain Vanity Fair en 2010, Michael Cimino avait dit son espoir que quelqu’un reconnaîtrait un jour «La Porte du paradis» comme un chef d’oeuvre.
En 2012, Cimino en dévoile une version intégrale, remastérisée, qui trouve enfin son public. Le directeur de la Mostra de Venise, Alberto Barber, qualifie même de «chef-d’oeuvre absolu» cette évocation du combat sanglant de riches éleveurs du Wyoming contre des immigrés d’Europe centrale, avec l’accord tacite des autorités fédérales.
Après ce cuisant épisode, Cimino doit attendre cinq ans pour revenir en grâce en 1985 avec «L’année du dragon», sur la mafia chinoise, qui lui valent des accusations de racisme de la part de la communauté asiatique.
Suivent trois échecs commerciaux: «Le Sicilien» en 1987, sur le bandit Salvatore Giuliano, que ses détracteurs l’accusent de glorifier, «Desperate Hours», remake de La maison des otages de William Wyler, en 1990, et «The Sunchaser» en 1996, road movie sur les Navajos dans les montagnes du Colorado.
Lorsque la caméra lui fait défaut, Cimino s’exprime par l’écriture, notamment avec «Big Jane», un beau portrait de femme et de l’Amérique des années 1950 publié chez Gallimard en France en 2001 faute d’éditeur américain.
Cortese a écrit:A propos de The Deer Hunter, je me souviens que je l'avais vu dans les années 80 et que je n'avais pas beaucoup aimé. La première chose qui m'avait choqué c'était cette représentation "exotique" du conflit vietnamien qui me faisait penser aux pires caricatures de la cruauté asiatique ; ensuite la certaine complaisance dans la mise en scene de la mort. Ça m'est revenu quand j'ai revu le film récemment à la télé. Le jeune homme qui était avec moi disait qu'il adorait ce film, et en l'observant du coin de l'oeil j'avais ressenti une certaine gêne en constatant sa fascination voire sa délectation morbide devant les scènes récurrentes de roulette russe. Cimino était il une sorte de Tarantino de première classe ?

Romain Le Vern, TF1.fr a écrit:Décès de Michael Cimino, réalisateur de films inoubliables
par Romain Le Vern
le 03 juillet 2016 à 10h46 , mis à jour le 03 juillet 2016 à 10h59.
Le réalisateur américain Michael Cimino est décédé ce samedi 2 juillet, à l'âge de 77 ans. Évidemment, personne ne s'est remis de "Voyage au bout de l'enfer" ou de "La Porte du Paradis". Autant de films inoubliables portés par la croyance totale de Michael Cimino, racontant avec une fluidité et une assurance de chaque plan ce qui se passe avant, pendant et après. Et qui agissent durablement sur le spectateur.
Au début des années 70, Michael Cimino faisait partie de la génération montante génialement mégalo du Nouvel Hollywood avec, entre autres, William Friedkin (French Connection), George Lucas (Star Wars) et Francis Ford Coppola (Apocalypse Now), menaçant l'hégémonie des grands studios. De tous, il était considéré comme l'un des plus grands cinéastes américains.
Jeune, Michael Cimino grandit à New York. Diplômé en peinture de l'Université Yale au début des années 60, il s'engage, durant ses études, dans l'armée de réserve. Premier boulot: réalisateur de spots publicitaires pour la télévision. Puis Cimino devient scénariste, pour l'inénarrable film de science-fiction écolo Silent Running de Douglas Trumbull (1972) ou encore le deuxième volet de l'impitoyable saga de l'Inspecteur Harry, Magnum Force (1973) cette fois-ci réalisé par ce cher et sous-estimé Ted Post.
Sous l'impulsion de Clint, toujours à l'affût, Michael Cimino passe à la réalisation en 1974 avec Le Canardeur, un road-movie très correctement exécuté que le cowboy produit et dans lequel il joue aux côtés d'un certain Jeff Bridges. C'est un hors-d'œuvre quatre ans avant le chef-d'œuvre revendiquant l'ampleur sidérante d'une saga.
Voyage au bout de l'enfer, chef-d'oeuvre absolu
Après le succès surprise du Canardeur et avant le four monstrueux de La Porte du paradis, il y a eu un monument: Voyage au bout de l'enfer (1978), fresque Marxiste inoubliable d'environ trois heures, décrivant de la manière la plus déchirante et la plus tripale qui soit les destins brisés d'américains moyens pendant la guerre du Vietnam (sujet totalement tabou à l'époque). Soit cinq ouvriers sidérurgistes affrontant les hauts fourneaux d'une petite ville de Pennsylvannie et partant ensemble chasser le cerf (d'où le titre US The Deer Hunter).
Parce que c'est la guerre au Vietnam, trois d'entre eux deviennent soldats sur le départ. Deux ans plus tard, la guerre sévit toujours et ces derniers se retrouvent prisonniers dans un camp vietcong. Un casting exceptionnel (Robert de Niro, Christopher Walken, Meryl Streep, John Cazale, John Savage) et des scènes d'une intensité mémorable, de joie comme d'horreur, de mariage comme de mort.
Des films de cette trempe comme ce terrassant Voyage au bout de l'enfer ou l'autre film monstre du genre Apocalypse Now ne peuvent plus exister, faute d'être aussi tolérant avec les génies. Ce que la mort de Cimino nous renvoie soudain, c'est cette évidence qu'un pan de cinéma et donc qu'une manière d'envisager le cinéma est parti avec lui. Cinq Oscars pour Voyage au bout de l'enfer dont celui du meilleur film ; Cimino lui-même reçoit l'Oscar du meilleur réalisateur.
La porte du paradis, le film de tous les scandales
Fort de ce succès, Cimino obtient d'United Artists le contrôle total pour son film suivant: un western qui, en toute simplicité, s'intitule La Porte du paradis. Comme chacun sait, c'est un échec foudroyant qui a marqué la fin d'une époque ayant engrangé seulement un million et demi de dollars de recettes pour un budget trente fois supérieur. Cimino finit l'épreuve lynché pour avoir coulé United Artists, créé par Chaplin et bastion du cinéma indépendant, mettant ainsi sur la paille tous les producteurs impliqués dans le projet, considéré pour toujours comme le fossoyeur du cinéma indé US.
Faut voir le bestiau: un tournage épique de 165 jours (il n'était pas rare que le cinéaste fasse 50 prises d'une même scène) et des acteurs incroyables (Kris Kristofferson, Christopher Walken, John Hurt, Isabelle Huppert...). Plus de trente ans plus tard, il suffit de revoir cet objet unique, fort, somptueux: La Porte du Paradis reste un chef-d'œuvre absolu de superproduction, bien loin du grand film malade comme pouvait l'être The Last Movie de Dennis Hopper (1971)."La porte du paradis peut aussi se voir comme le dernier grand film d’une époque dans le cinéma américain où un réalisateur jouait sa carrière, sa vie, sa santé et tout ce en quoi il croyait sur une œuvre. Avant que Hollywood ne devienne un grand magasin de jouets."
Avec une maestria éblouissante, Cimino y montre la naissance d'une nation bâtie sur le massacre des indiens, l'exploitation des immigrés, le vol systématique, la spoliation et le mensonge. A l'époque, il était possible de parler de politique, de sexe, de religion comme de corruption en ayant les coudées franches.
La porte du paradis peut aussi se voir comme le dernier grand film d'une époque dans le cinéma américain où un réalisateur jouait sa carrière, sa vie, sa santé et tout ce en quoi il croyait sur une œuvre. Avant que Hollywood ne devienne un grand magasin de jouets.
A la sortie, les critiques de La Porte du Paradis sont tellement exécrables - allant jusqu'à taxer Michael Cimino d'anti-américain - que United Artists a fait plus de 300 coupes, réduisant le film de plus d'une heure pour le ramener à une durée d'environ 2h30 (au lieu de 3h39). Un opprobre d'autant plus douloureux qu'une campagne médiatique de dénigrement a obligé Cimino à se cacher pendant cinq ans. Il n'a retrouvé sa « légitimité » qu'en acceptant une commande: L'année du dragon, adaptation du roman de Robert Daley produite par Dino De Laurentiis. Un film de commande, certes, mais comme on en aimerait en voir tous les jours: un sublime polar sur la mafia chinoise avec un Mickey Rourke au sommet en flic polonais obsédé par sa croisade personnelle.
Autre commande pour remonter la pente: Le Sicilien, adaptation du roman de Mario Puzo en 1987, biographie du hors-la-loi Salvatore Giuliano (Cristophe Lambert), qui hélas ne connait pas la même trajectoire.
Au cours de l'été 1989, une version longue de La porte du paradis (soit les fameuses 3 heures 40) est distribuée, réhabilitant ce film maudit. En 2012 (soit vingt-trois ans plus tard), il est possible de découvrir une nouvelle version Director's cut restaurée et remasterisée de 216 minutes, présentée à la Mostra de Venise en grande pompe. Dans la filmographie de Cimino, viendront après Le Sicilien: La Maison des otages (1990), remake d'un film de William Wyler datant de 1955 et Sunchaser (1996) qui sera son dernier film, après un long suspens entretenu plus de 20 ans.
Depuis tout ce temps, la rumeur voulait que Cimino adapte La Condition Humaine de Malraux. Il n'en sera rien. Pendant toutes ces années, on a pu constater la force et constater le manque, le vide laissé par ce cinéma-là. On a donc pu voir et revoir les films de Michael Cimino dont on est encore loin, à l'heure où nous nous parlons et ce pour toutes les générations futures de cinéphiles, d'avoir épuisé toutes les beautés.
Cortese a écrit:A propos de The Deer Hunter, je me souviens que je l'avais vu dans les années 80 et que je n'avais pas beaucoup aimé. La première chose qui m'avait choqué c'était cette représentation "exotique" du conflit vietnamien qui me faisait penser aux pires caricatures de la cruauté asiatique ; ensuite la certaine complaisance dans la mise en scene de la mort. Ça m'est revenu quand j'ai revu le film récemment à la télé. Le jeune homme qui était avec moi disait qu'il adorait ce film, et en l'observant du coin de l'oeil j'avais ressenti une certaine gêne en constatant sa fascination voire sa délectation morbide devant les scènes récurrentes de roulette russe. Cimino était il une sorte de Tarantino de première classe ?

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités