Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
Modérateur: Silverwitch
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
Non.....
« Par exemple, le football, on y joue dans des endroits spéciaux. Il devrait y avoir des terrains de guerre pour ceux qui aiment mourir en plein air. Ailleurs on danserait et on rirait » (Roger Nimier)
- DCP
- 28 juin 2021 !
- Messages: 25717
- Inscription: 26 Fév 2003, 11:18
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
von Rauffenstein a écrit:
Il fait quoi, le mec, là ?
"c'est quoi le blues". Toujours les mêmes histoires, celles qui font vaciller les mondes et les empires.
John Lee Hooker
John Lee Hooker
- Shoemaker
- Messages: 22441
- Inscription: 24 Nov 2003, 12:11
- Localisation: Out of Africa
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
DCP a écrit:Non.....
Si. Ton smiley t'a trahi.
"La citoyenneté réduite au droit du sang consiste à dire que la République est génétique et non pas spirituelle", Waddle, 2013.
Mon blog
Mon blog
-

Waddle - Enculeur de moucheS
- Messages: 24109
- Inscription: 10 Mai 2003, 18:05
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues (à la demande de marlaga)
Xave a écrit:Pourquoi ? Ouais et Silver sont ensemble ?
Tu ne savais pas?
Mais comme il a expliqué, ils n'habitent pas ensemble, elle veut garder son indépendance.
"La citoyenneté réduite au droit du sang consiste à dire que la République est génétique et non pas spirituelle", Waddle, 2013.
Mon blog
Mon blog
-

Waddle - Enculeur de moucheS
- Messages: 24109
- Inscription: 10 Mai 2003, 18:05
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
Waddle a écrit:DCP a écrit:Non.....
Si. Ton smiley t'a trahi.
On a peut-être pas le même humour....
« Par exemple, le football, on y joue dans des endroits spéciaux. Il devrait y avoir des terrains de guerre pour ceux qui aiment mourir en plein air. Ailleurs on danserait et on rirait » (Roger Nimier)
- DCP
- 28 juin 2021 !
- Messages: 25717
- Inscription: 26 Fév 2003, 11:18
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
Waddle a écrit:DCP a écrit:Pourquoi pas ? Disons que ce smiley contient le fond de ma pensée sur ce sujet.
Et parce que tu prends au sérieux un sujet qui n'avait d'autre vocation que de déconner pour taquiner Von et Silverwitch à cause de leur monologue sur l'autre sujet?
Ce n'était pas un monologue, mais un madrigal à la Beaumarchais. D'abord.
Le fascisme au fait, c'était pas déjà l'histoire d'un mec en marche qui fascinait les foules avec son culte de la personnalité ?
-

von Rauffenstein - ultima ratio regum
- Messages: 46968
- Inscription: 20 Fév 2003, 18:01
- Localisation: Auteuil
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
Shoemaker a écrit:von Rauffenstein a écrit:
Il fait quoi, le mec, là ?
Il ne fait pas. Il n'en pense pas moins.
Le fascisme au fait, c'était pas déjà l'histoire d'un mec en marche qui fascinait les foules avec son culte de la personnalité ?
-

von Rauffenstein - ultima ratio regum
- Messages: 46968
- Inscription: 20 Fév 2003, 18:01
- Localisation: Auteuil
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues (à la demande de marlaga)
Ouais_supère a écrit:En fait, elle fait genre "oui, moi, touça, le Cinéma...", Silver, mais elle est plus calée que nous en film à la con.
Elle est super intelligente toute la journée, certes, mais du coup, quand elle rentre chez elle, le masque tombe: jogging, pantoufles roses en pilou, elle tombe comme lourdement entraînée par ses fesses (non, j'ai pas dit qu'elle avait un gros cul) sur son canapé, laisse mollement choir un bras de l'autre côté de l'accoudoir, bras dont la main s'abat sur le pot de Häagen Dazs de la veille, elle porte, regard éteint, la cuillère à sa bouche, attendant le retour de l'homme, qui, tailleur cintré rapidement évacué, s'installera en slip à ses côtés pour se repaître avec avidité du dernier American Pie-like, ne s'interrompant qu'un bref instant pour s’enquérir auprès de sa belle de la qualité de sa journée, et surtout s'il reste de la pizza dans le carton corné par la graisse qui dépasse, abandonné, de sous la table basse.
True story.
Ça sent le vécu.

Le fascisme au fait, c'était pas déjà l'histoire d'un mec en marche qui fascinait les foules avec son culte de la personnalité ?
-

von Rauffenstein - ultima ratio regum
- Messages: 46968
- Inscription: 20 Fév 2003, 18:01
- Localisation: Auteuil
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
von Rauffenstein a écrit:Shoemaker a écrit:von Rauffenstein a écrit:
Il fait quoi, le mec, là ?
Il ne fait pas. Il n'en pense pas moins.
Ok des spasmes cérébraux...
"c'est quoi le blues". Toujours les mêmes histoires, celles qui font vaciller les mondes et les empires.
John Lee Hooker
John Lee Hooker
- Shoemaker
- Messages: 22441
- Inscription: 24 Nov 2003, 12:11
- Localisation: Out of Africa
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues (à la demande de marlaga)
Ouais_supère a écrit:En fait, elle fait genre "oui, moi, touça, le Cinéma...", Silver, mais elle est plus calée que nous en film à la con.
Elle est super intelligente toute la journée, certes, mais du coup, quand elle rentre chez elle, le masque tombe: jogging, pantoufles roses en pilou, elle tombe comme lourdement entraînée par ses fesses (non, j'ai pas dit qu'elle avait un gros cul) sur son canapé, laisse mollement choir un bras de l'autre côté de l'accoudoir, bras dont la main s'abat sur le pot de Häagen Dazs de la veille, elle porte, regard éteint, la cuillère à sa bouche, attendant le retour de l'homme, qui, tailleur cintré rapidement évacué, s'installera en slip à ses côtés pour se repaître avec avidité du dernier American Pie-like, ne s'interrompant qu'un bref instant pour s’enquérir auprès de sa belle de la qualité de sa journée, et surtout s'il reste de la pizza dans le carton corné par la graisse qui dépasse, abandonné, de sous la table basse.
True story.

Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
Jump in di line, rock your body in time!
OK! I believe you!
Jump in di line, rock your body in time!
OK! I believe you!
Jump in di line, rock your body in time!
OK! I believe you!
OK! I believe you!
Jump in di line, rock your body in time!
OK! I believe you!
Jump in di line, rock your body in time!
OK! I believe you!
- Ouais_supère
- Messages: 25817
- Inscription: 20 Juil 2005, 11:54
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
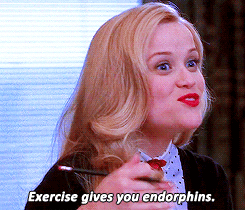
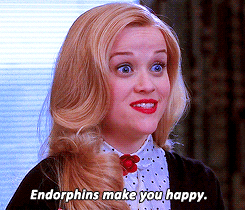
Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
n'empêche, ces petits gifs sont sympas. Regardez ce putain de plan et le mouvement de la caméra ! Ça date de 1932. King Kong.

(Ozzy marlaga, arrête de faire peur à Silver !)

(Ozzy marlaga, arrête de faire peur à Silver !)
Le fascisme au fait, c'était pas déjà l'histoire d'un mec en marche qui fascinait les foules avec son culte de la personnalité ?
-

von Rauffenstein - ultima ratio regum
- Messages: 46968
- Inscription: 20 Fév 2003, 18:01
- Localisation: Auteuil
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von

Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
Allez, un peu de lecture. J'ai repiqué ca sur le forum d'un site DVD qui lui-même.... ( c'est peut-être Silverwitch qui est à l'origine  ) :
) :
Les clichés au cinéma
Le méchant n'est jamais vraiment mort, quel que soit le traitement que lui ai fait subir le héros.
Même complètement mort, le méchant peut renaître. (voir Jason, Freddy, etc...)
Les terroristes perdent beaucoup de temps et d'argent pour mettre sur leurs bombes de gros voyants rouges qui indiquent à la seconde près le moment de l'explosion.
Les héros se débrouillent toujours pour déconnecter la bombe lorsque les gros voyants rouges marquent moins de 10 secondes.
Lorsque 15 malfrats entourent le héros, chacun d'entre eux attend bien sagement son tour avant d'attaquer et de se faire rétamer par le héros.
Les cabines d'ascenseurs ont toujours une trappe qui permet au héros d'accéder à la machinerie pour échapper à ses poursuivants.
Les conduits d'aérations sont toujours assez larges pour permettre au héros d'aller et venir à sa guise dans l'immeuble des méchants et même de passer d'étages en étages et on y voit comme en plein jour.
Les caves par contre n'ont jamais de lumière, il faut toujours les explorer avec une lampe électrique.
Les héros comme les méchants ne se lavent quasiment jamais.
Les héroïnes non plus car quand elles sont dans une salle de bains, il leurs arrive systématiquement quelque chose de désagréable.
L'héroïne ne peut jamais prendre sa douche ou son bain sans être attaquée par un méchant/monstre.
Lorsque l'héroïne se regarde dans une glace puis se baisse pour prendre quelque chose et se relève, il y a toujours un méchant/monstre qui apparaît derrière elle.
Lorsque l'héroïne entend un bruit chez elle la nuit, elle explore systématiquement toute la maison avec une lampe de poche, habillée en robe de chambre.
Comme ils voient parfaitement dans le noir, les méchants coupent toujours l'électricité d'une maison avant d'entrer.
Dans le cas d'une poursuite, le héros doit toujours prendre la main de l'héroïne pour l'aider à courir car elle est incapable de courir par elle-même.
Les héroïnes ne sortent qu'avec des héros ou des méchants, jamais un mec "normal".
Les chats passent une bonne partie de leur temps à sauter à l'improviste juste devant le visage du héros ou de l'héroïne.
Sinon, les chats utilisent leur temps libre pour détourner l'attention des gardes en faisant du bruit à la place du héros même dans des endroits où ils n'ont rien à faire : base militaire, bureau, musée, etc...
Quant on tire sur un cavalier, c'est son cheval qui est touché et qui tombe.
Les chiens ne meurent jamais. Ils sont entre autre : éruption-volcanique-proof, inondation-proof, tornade-proof, tremblement-de-terre-proof et aliens-proof. ("proof " = "à l'épreuve de" en anglais)
Les cochons parlent.
Les extra-terrestres sont toujours en avance sur nous.
Il y a toujours de la place pour se garer juste devant l'endroit où se rend le héros.
Un policier ne peut résoudre une enquête sans se rendre dans une boite de nuit.
Un policier s'engueule toujours avec son supérieur.
Un policier est toujours obligé de menacer son indic pour le faire parler (A mon avis, ils ne doivent pas les payer !).
Un policier ne peut résoudre une enquête difficile sans être mis à pied ou renvoyé de la police.
Le supérieur d'un policier lui attribut toujours un nouveau binôme qui ne lui plaît pas.
Un policier est toujours prêt à utiliser des moyens illégaux pour faire avancer son enquête.
Un policier détruit plusieurs voitures de police pour chaque enquête.
Lorsqu'un policier poursuit un méchant en voiture, il renverse toujours des poubelles ou des étals de marché.
Lors d'une poursuite de voitures, il y a toujours un camion qui vient couper la route/rue/allée.
Dans un film d'action, un tiroir ouvert en gros plan contient toujours une arme à feu.
Un soldat qui montre une photo de sa femme va bientôt mourir...
Quelqu'un qui dit : 'Je ne peux pas vous en parler au téléphone, rencontrons-nous...' va bientôt mourir ! De préférence abattu sous les yeux du héros.
Un adolescent qui fait l'amour dans un film d'horreur va bientôt mourir !
Un méchant qui change de camp et se décide à aider le héros va bientôt mourir !
Dans un film de guerre, le noir qui fait partie de l'équipe du héros va bientôt mourir !
Dans les films d'horreur, les enfants survivent, rarement les adolescents.
Une personne poursuivie par un méchant court toujours dans la même direction et en ligne droite.
Les héros ont des yeux spéciaux qui leur permettent de voir sous l'eau comme s'ils étaient des poissons et cela même dans les eaux les plus sales notamment dans les ports.
Les héros ont la possibilité de savoir quand une information importante les concernant va passer à la télévision, ce qui leur permet d'allumer leur poste juste au bon moment.
Le héros est toujours un maître aux échecs.
Les armes à feu tirent des balles en sucre puisqu'un simple canapé en tissu suffit pour s'en protéger.
Les méchants laissent toujours les clés de contact sur leur véhicule pour permettre au héros de s'enfuir avec n'importe quelle voiture, camion, avion, hélicoptère pris au hasard.
Les voitures sont toutes munies d'auto pilotes, pour que le conducteur puisse discuter avec les autres passagers sans avoir à regarder la route.
Les personnages de 99,9 % des films ne ferment jamais à clé la portière de leurs voitures.
Un méchant arrive toujours à crocheter votre portière et à se cacher sur le siège arrière de votre voiture et vous ne le découvrez qu'une fois assis.
Chaque voiture est équipée de nombreux réservoirs d'essence tout autour de la carrosserie pour garantir qu'elle explosera au moindre accident.
Les voitures sont aussi équipées de suspensions et d'essieux spéciaux, ce qui permet aux voitures de faire des sauts en l'air et de continuer à rouler alors que des suspensions et des essieux normaux auraient éclaté en morceaux.
Lorsque le héros et le méchant se battent sur le toit d'un véhicule, il y a toujours une branche, un poteau ou un pont qui vient frapper le méchant en pleine tête.
Le chef des méchants doit tuer l'un de ses hommes pour que l'on sache que c'est lui le chef !
On est 6 milliards sur cette planète, mais généralement le héros connaît personnellement le chef des méchants... Deux explications possibles à cela : soit il est vraiment très con et choisit vraiment très mal ses fréquentations, soit il doit avoir un carnet d'adresse de 2 tonnes 5 !
Un entrepôt désaffecté est l'inévitable lieu de la bataille générale entre le héros et les méchants.
Les héros ont des c[*****]es en béton. S'ils reçoivent un coup de pied entre les jambes, ils grimacent et repartent immédiatement.
Les méchants ne savent jamais tirer, les héros (même débutants) sont tous des as du flingue et font toujours mouche.
Les héros et les méchants ne font jamais de crise d'hypoglycémie en plein pendant une poursuite haletante alors même qu'ils ne mangent pratiquement jamais.
Lorsqu'un méchant veut tuer quelqu'un dans un hôpital, il entre tranquillement dans la lingerie, d'où il ressort habillé en médecin (y compris le badge et le stéthoscope). Il peut alors se balader tranquillement dans tout l'hôpital car personne ne s'étonne de ne pas connaître ce médecin.
Le méchant, s'il a une milice/armée, embauche toujours des incapables qui n'arrivent jamais à trouver/tuer le héros ou l'héroïne, même à 100 contre 1.
Le méchant, s'il a une armée ou milice arrive toujours à survivre même en se prenant une bombe atomique sur la gueule (mieux, il vient de quitter son QG au moment où arrive la bombe) alors que ses sbires tombent à la moindre balle perdue (le méchant est plus solide).
Le héros a un super plan des lieux dans la tête qui lui permet de pister un méchant même en pleine foule et dans un labyrinthe.
Il y a toujours un bouffon de service qui gravite autour du héros. Il agace le héros et a deux destins possibles, soit il gagne le respect du héros en sauvant sa vie, soit il meurt en sauvant la vie du héros.
Une voiture explose toujours 10s après un accident, elles doivent avoir un minuteur intégré en série.
Un médecin légiste est toujours en train de manger un sandwich lorsqu'il montre un cadavre à un policier, quand il ne fait pas des blagues du style : quelle belle cervelle, on en mangerait !
Si un méchant fonce sur un policier qui n'est pas le héros, celui-ci essaye de tirer sur le chauffeur du véhicule qui lui fonce dessus sans y réussir et se fait écraser au lieu de s'écarter.
Un héros a un corps qui s'adapte à toutes les tailles car lorsqu'il assomme quelqu'un et lui prend ses vêtements, ils lui vont sur mesure.
Quand un couple se retrouve au lit, les draps sont spéciaux, ils arrivent jusqu'a la taille des héros, mais toujours au-dessus des seins des héroïnes.
Les belles femmes dorment toujours nues, mais elles ont un drap sur la poitrine au réveil.
Les hommes n'ont jamais d'érection matinale.
Les héros sont souvent flics donc avec un revenu très bas mais se paie toujours des supers voitures genre cabriolets et autres Porches, c'est le syndrome dit des "Deux flics à Miami".
Le héros peut aller dans n'importe quel pays puisque les gens parlent tous la même langue que lui et si ce n'est pas le cas il sait parler couramment toutes les langues étrangères.
Les numéros de téléphones commencent tous par 555 aux Etats-Unis.
Un héros se fait généralement attaquer par les méchants quand il va pisser (surtout dans les aéroports) - ce qui explique qu'il n'y va pas souvent, même s'il gagne toujours.
Tous les restaurants ont des toilettes qui donnent sur une arrière-cour que les méchants ont oubliés de surveiller.
Tous les cauchemars s'avèrent être prémonitoires.
Lorsqu'on éteint la lumière dans une chambre, la lune s'allume.
La perte d'un ou deux litres de sang n'est pas gênante pour un vrai héros.
L'héroïne se réveille toujours bien maquillée et bien coiffée comme si elle sortait d'un salon de coiffure.
95% des femmes et 100% des enfants sont dans le camp des gentils.
Par contre les mecs en costard/cravatte sont pratiquement toujours des méchants.
Tous les avocats sont des méchants.
Quand une femme se bat contre un homme, elle gagne toujours car généralement elle est maître expert en karaté.
Dans les rares cas où elle ne l'est pas, elle arrive au moins à lui flanquer un coup de pied dans les c[*****]es.
Et comme l'adversaire d'une femme est presque toujours un méchant, il n'a pas des c[*****]es en béton et il tombe en criant.
Les jeunes femmes scientifiques portent toujours des lunettes qu'elles enlèvent pour parler au héros
Les jeunes femmes docteur en physique nucléaire se baladent toujours en tenue Lara Croft
Lorsque le héros traverse une rue rapidement, il y a toujours une voiture qui freine brutalement et manque de le renverser.
Si un noir ou un italien a un rôle important, c'est souvent un gentil, s'ils sont plus de trois, c'est un gang de méchants.
Tous les anciens du KGB travaillent pour la mafia russe.
Tous les Chinois font du karaté. (C'est d'autant plus étonnant que le karaté n'est pas chinois mais japonais !).
Toutes les grandes sociétés américaines ont des équipes de tueurs à gages.
Si le héros, qui se cache des méchants/flics/militaires, appelle son meilleur ami et que celui-ci lui dit : "Dit moi où tu es que je vienne te chercher." c'est que l'ami en question va le trahir.
Les villes américaines sont pleines de hangars/usines abandonnés où les méchants peuvent se cacher à leur guise.
Lorsqu'un garde/sentinelle est tué, il a toujours la bonne idée de mourir vite et en silence.
Lorsque le héros veut rencontrer un type dans son bureau, il y a toujours une secrétaire qui tente de l'en empêcher en affirmant qu'il n'est pas là.
Quand un groupe d'adolescents s'en va en vacances, ils choisissent toujours un chalet dans le fond d'un bois complètement isolé de la civilisation.
Quand la jeune blonde se fait courir après, elle choisit toujours les marches plutôt que de sortir en dehors de la maison.
Le copain de la blonde, qui paraît très gentil, est bien souvent celui qui s'avère être le méchant.
La plupart du temps, la jeune blonde retrouve le nul de l'histoire qui agonise dans une garde-robe et qui essaie de lui dire, grâce à ses derniers soupirs, que le méchant est juste derrière elle, tandis qu'elle, elle ne comprend pas du tout et elle essaye de l'aider.
Si le noir du film a plus de 35 ans,, il est chauve ou a le crâne rasé.
Le trafiquant de drogue est généralement sud-américain. Il habite une maison ultra luxueuse, porte un catogan et s'habille uniquement chez Armani.
Le héros n'enclenche jamais le cran de sûreté de son flingue. Malgré ça, même en cas de chutes à répétition, il n'y a jamais un coup qui part tout seul.
Parfois, à la fin du film, tous les gentils qui étaient en second ou troisième rôle sont morts. Mais le héros garde le sourire, sauf s'il avait son meilleur ami dans le lot. Dans ce cas, le film se termine par une visite sur sa tombe.
Quand on tire sur un cavalier, si ce n'est pas le cheval qui est touché, le cavalier a toujours un pied coincé dans un étrier et se fait traîner par son cheval. S'il tombe directement et n'est pas mort, c'est qu'il sert par la suite dans le film.
Si le héros fume, c'est parce que c'est un rebelle ou un type totalement désabusé.
Malgré son immense carnet d'adresses, le héros a une mémoire éléphantesque et connaît par coeur tous les numéros dont il a besoin, à l'exception de ceux qu'il découvre pendant le film.
Quand on est noir et gentil mais qu'on est pas le héros du film, on a 100% de chances de mourir avant la fin (en sauvant le héros de préférence). Cette règle s'applique aussi aux autres minorités.
Si vous êtes noir et policier, en cas de problème, vous êtes obligé d'être à 2 mois de la retraite.
Pourchasse dans une ville, vous aurez toujours la chance de pouvoir vous dissimuler au milieu d'un défile de la saint Patrick, n'importe quel jour de l'année.
N'importe qui peut facilement faire décoller un avion, pourvu qu'il ait quelqu'un dans la tour de contrôle pour lui donner l'autorisation de partir.
Le système de ventilation de n'importe quel bâtiment est le parfait endroit pour se cacher. Personne ne pensera à vous trouver et, en plus, vous pourrez accéder à toutes les pièces de l'édifice sans aucun problème.
Le héros peut se prendre les plus terribles coups sans broncher, mais sursautera quand une femme tentera de nettoyer ses blessures.
Le chef de la police est toujours noir.
Au moment de payer le taxi, ne regardes jamais dans ton portefeuille pour sortir un billet : prends un billet un au hasard et tends-le : C'est toujours le prix exact.
Les cuisines ne sont pas équipées de lumières. Quand vous pénétrez dans une cuisine en pleine nuit, ouvrez le frigo et utilisez sa lumière a la place.
Une simple allumette ou un briquet suffit pour éclairer une pièce de la taille d'un terrain de foot.
Même si vous conduisez sur une avenue parfaitement droite, il est nécessaire de tourner vigoureusement le volant de droite a gauche de temps en temps.
Un homme vise par 20 hommes a plus de chance de s'en sortir que 20 hommes visés par un seul.
La majorité des gens gardent un album rempli de coupures de journaux ; particulierement si un membre de leur famille est mort dans un étrange accident.
Lors d'une conversation très émouvante, au lieu de parler en regardant votre interlocuteur, placez-vous derrière lui et parlez à son dos.
S'il y a un malade mental psychopathe en fuite, cela coïncide en général avec un orage qui coupe le courant et les communications téléphoniques dans les parages. (Pratique pour les prévisions météo).
On peut jouer de la plupart des instruments de musique, surtout les instruments à vent et les accordéons sans avoir à bouger les doigts.
Au début du film le héros et l'héroïne se détestent et s'engueulent et finissent par sortir ensemble à la fin du film.
A la fin du film, il y a toujours pleins d'ambulances et de voitures de police avec de gyrophares pour venir en aide et réconforter le héros et ses amis blessés (même si 5 minutes avant, le héros était considéré comme l'ennemi public numéro un par la police). Il découle de la constatation précédente que la police voit la fin du film en même temps que le spectateur et se rendent compte de sa méprise.
Il vaut mieux être une pièce q'un billet. Quand on voit à l'écran l'argent dérobé par le méchant (ou la rançon) c'est que les billets vont soient s'envoler (en haut d'un pont, depuis un hélico..) ou alors qu'ils vont brûler (incendie, explosion...).
Personne ne se gratte le nez.
Encore moins les c[*****]es (sauf les méchants).
S'il y a un ordinateur avec un mot de passe, le héros arrive toujours à le trouver. Le héros n'oublie jamais ses mots de passe.
Le héros n'hésite jamais à s'accrocher au filin qui pend de l'hélico, à la portière de la voiture, au pare choc du camion, à la bouée du bateau, dans lequel le méchant essaye de se sauver.
Pour localiser quelqu'un qui appèle au téléphone, la police a toujours besoin d'un délai de 30 secondes à une minute (soit le temps pour celui qui appèle de donner les informations qu'il désire). corollaire : quand le méchant (ou le gentil en fuite) téléphone à la police, il raccroche toujours quelques secondes avant de se faire localiser.
Les portables ne sont jamais déchargés ou leur crédit épuisé.
Les enfants du héros sont toujours de bons élèves (c'est normal : Papa est un héro) et si ce n'est pas le cas c'est parcequ'ils sont surdoués (informatique, electronique...).
Le héros n'a jamais de problème de nourrisse (Les enfants de héros n'ont besoin de personne pour les garder).
Quand un des personnages du film se retrouve complètement saoul dans une soirée, on est sur qu'il va faire péter un gros scandale en public plutôt que d'aller vomir peinard dans son coin.
Le héros n'hésite jamais à tirer comme un malade sur le méchant qui s'échappe dans la rue, les piétons sont balles proof.
Théorème d'Archimède révisé : tout corps de femme plongé dans une baignoire connait une issue fatale.
Les normes de câbles informatiques qui posent tant de problème sur terre ne s'appliquent pas en cas d'opérations sur l'ordinateur du vaisseau alien.
Le héros est droitier s'il se prend une balle dans le bras gauche, et inversement.
Les héros ne dorment jamais. Si on voit un héros en train de dormir, il va être réveillé dans la seconde qui suit par un coup de téléphone.
Les méchants ne tuent jamais le héros quand il est à leur merci. Ils préfèrent perdre du temps à se vanter ou raconter leur vie.
Si un héros fait le plein de sa voiture, c'est qu'il va se passer quelque chose à la station-service.
Le héros se préoccupe de son niveau d'essence quand il est poursuivi par un hélicoptère le mitraillant.
Les ponts suspendus ne sont pas un motif d'arrêt du véhicule.
Lorsqu'une armée de méchants/militaires lance une grenade sur le héros , celle-ci provoque généramement une petite explosion et ne touche jamais le héros. Mais quand le héros réussit à rattraper une des grenades et qu'il la relance, il tue toute l'armée.
Lorsque le héros se fait courser par un méchant dans un immeuble , il s'enfuit toujours sur le toit , et lorsqu'il y est, il se rend compte qu'il n'a aucune issue.
Le héros dispose généralement d'un pistolet spécial qui à plus d'une centaine de balles.
Pour que l'héroïne tombe amoureuse du héros, il faut que celui-ci soit couvert de blessures et qu'il fasse semblant de ne pas avoir mal.
Lorsqu'un film américain se passe à paris, on voit la Tour Eiffel quelle que soit la fenêtre par laquelle on regarde.
Un héros n'a pas besoin de recharger son arme, sauf si, durant la fusillade, il trouve un bidon/palette derrière laquelle se cacher.
Dans un film d'épouvante, lorsque l'héroïne marche dans une zône boisée, le cadreur la suit toujours parallèlement en général à une ou 2 rangées d'arbre d'elle.
Dans un film d'épouvante, il est toujours nécessaire de traverser un parc ou un bois pour rentrer chez soi afin de justifier les frais de rail de travelling (voir remarque précedente)
Dans un film d'horreur, la scène finale se passe toujours pendant un grand orage pendant la nuit. De cette façon, lors d'une poursuite dans le jardin, cela donne une excuse à l'héroïne pour glisser dans la boue.
Quelle soit la vitesse à laquelle se déplace la fille, elle se fait rattraper par le méchant (cf.Halloween).
Il suffit de tirer au pistolet dans une porte pour l'ouvrir, même si c'est la 3 points exigée par les assurances...
Il suffit d'un coup de poing pour anesthésier un vigile sans le blesser, juste le temps de récupérer les documents.
Dès qu'il y a meurtre ou délit grave, une sirène de voiture de police retentit instantanément...
Le grand mechant est lui aussi est balle proof.
Le grand mechant est le seul mechant qui peut vraiment tuer des tas de ptits flics qui savent pas non plus viser
Le grand mechant as souvent tué (au choix) : le pere, le frere , le meilleur ami, la femme ... du héros. rarement la mere ou la soeur.
Lors de la bagarre finale, le heros et le grand méchant sont forcement reduit à se battre à mains nues.
Le heros se fait toujours maitriser grave en debut de bagarre finale, puis finalement pense à (au choix) : son pere, son frere etc ... que le grand méchant a tué sauvagement il y a quelques années, et lui met une énorme rouste ! !
Lors de la bagarre finale, il reste toujours un flingue de base à 2 cm des doigts du heros quand il se fait tabasser. Le grand mechant, bien content de pouvoir enfin se défouler, ne voit jamais que l'autre est a quelques cm d'un fligue !
Si le héros à une nourice qui garde ses enfants, et qu'il les laisse, il peut être sûr de retrouver la nounou ligotté dans le placard et ses enfants kidnappés.
Tous les véhicules que la police réquisitionne toujours en cas d'urgence pour poursuivre les méchants se retrouvent systématiquement en miettes.
Lorsque le téléphone du héros sonne chez lui, c'est toujours le soir quand il travaille à son bureau, ou sur son PC ; et il enlève ses lunettes pour décrocher.
Si l'héroïne chante sous la douche rien ne se passera ; en revanche si c'est le contraire, il y a une musique de suspense, et elle se fait agresser, juste avant que le héros, qui l'avait appris, n'arrive pour la sauver après avoir grillé tous les feux rouges en venant.
Un garçon qui nettoie un verre derrière un bar, est forcément l'indicateur du héros.
Les méchants donnent toujours rendez-vous dans des entrepots près de la mer, car il n'y en a jamais dans la ville.
En revanche si l'entrepôt est dans la ville c'est que le héros va arriver pour découvrir la trame du complot avant de tous les tuer.
Un méchant qui va faire des révélations aux héros, prend bien le temps de trainer en longueur, en répétant ses mots ou en bafouillant ; histoire que son chef ait le temps de l'abbattre.
Le héros n'attends jamais aux feux de signalisation pour traverser.
D'ailleurs il ne se fait jamais écraser.
Si une femme est une méchante elle est toujours étrangère, principalement russe, japonaise ou allemande.
Un héros a toujours des préservatifs sur lui car on ne le voit jamais en acheter.
Chaque fois qu'on parle du président des Etats-Unis dans un film, c'est qu'il risque de mourrir.
Mais à chaque fois le héros est là pour le sauver.
Le héros n'est jamais roux.
Le héros a toujours le plein d'essence dans sa voiture pour faire des course-poursuites.
Les méchants aussi, mais pour que leurs voitures explosent.
Le héros ne couche jamais avec des noires, sauf si ilestnoir ;c'est valable pour les autres minorités.
On ne peut pas appartenir à une minorité sans faire d'activités illégalles, ou être un informateur du héros.
Le héros sait parfaitement danser, car il a pris des cours pendant 10 ans.
Quand une femme décroche le téléphone chez elle, elle fait ou la cuisine, ou elle est en robe de chambre et elle allait se coucher, ou elle était sous sa douche.
Le héros n'a jamais besoin de se moucher ou de faire caca.
Le héros ne lit jamais rien sauf des rapports de police.
Le héros n'a jamais de problèmes au lit avec les femmes.
Le héros s'envoie toujours au moins une fois en l'air dans le film.
Le chef des méchant meurs toujours d'une manière très compliquée et douloureuse, et pas d'un simple coup de revolver comme ses subalternes.
Le héros découvre toujours toutes les réponses relatives à l'enquête sur son PC (internet).
Quand c'est une héroïne, souvent, elle consulte des microfilms à la bibliothèque du coin et tombe pile sur le bon article en 2 minutes !
La prise de note dans une enquète se fait toujours sur un grand calepin aux pages jaunes et à l'aide d'un crayon à papier, faut croire qu'il aime pas les stylos aux USA !
Les méchant ont toujours des phrases récurente pour ceux qui découvrent leurs plan comme : "la curiosité est un vilain défaut", "ce n'est pas bien d'écouter les conversations des grandes personnes", "Malheureusement vous en savez beaucoup trop" (celui-là vient généralement après que le grand méchant aie dévoilé tous ses plans).
Si on est agent du FBI, mais pas le héros du film, on ne sert généralement qu'a lui poser des bâtons dans les roues, et généralement à mourrir après s'être rendu compte que le héros n'était pas un vilain.
Les grands-méchants, contrairement aux héros, n'ont jamais de famille. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils peuvent être aussi méchant.
Le grand-méchant est généralement un surdoué qui a pris un mauvais chemin, et qui a une soif innassouvie de mégalomanie ; ceci s'applique généralement aux scientifiques ou aux hommes d'affaire.
Quand le grand méchant sort de prison, il ne dit pas qu'il s'est fait violer dans les douches ; ceci n'arrive uniquement qu'aux ex-criminels que le héros a coffré et qui sont obligé de lui servir d'indic dans le film.
Les grands-méchants ne sont jamais hommosexuels, hommes d'Eglise, très moches ou ayant une quelconque tarre physique ; si ils sont riches ils sont forcément philantropes, mais dans le cas contraire, ils sont sans foi ni loi.
Quand le méchant pose le canon de son arme sur la tête du héro après avoir flingués tout ses potes le canon (qui doit être très chaud) ne brûle jamais le héro.
Dans les films d'horreur, il y a toujours un mec qui s'y connait dans ce genre de truc (randy dans scream) et généralement si le film a du succès il ne survit pas.
Le héros a toujours une arme cachée dans son pantalon.
Le héros sort toujours quelques secondes avant la fermeture de la porte automatique, ou son pote le balèze maintient la porte ouverte.
Les clichés au cinéma
Le méchant n'est jamais vraiment mort, quel que soit le traitement que lui ai fait subir le héros.
Même complètement mort, le méchant peut renaître. (voir Jason, Freddy, etc...)
Les terroristes perdent beaucoup de temps et d'argent pour mettre sur leurs bombes de gros voyants rouges qui indiquent à la seconde près le moment de l'explosion.
Les héros se débrouillent toujours pour déconnecter la bombe lorsque les gros voyants rouges marquent moins de 10 secondes.
Lorsque 15 malfrats entourent le héros, chacun d'entre eux attend bien sagement son tour avant d'attaquer et de se faire rétamer par le héros.
Les cabines d'ascenseurs ont toujours une trappe qui permet au héros d'accéder à la machinerie pour échapper à ses poursuivants.
Les conduits d'aérations sont toujours assez larges pour permettre au héros d'aller et venir à sa guise dans l'immeuble des méchants et même de passer d'étages en étages et on y voit comme en plein jour.
Les caves par contre n'ont jamais de lumière, il faut toujours les explorer avec une lampe électrique.
Les héros comme les méchants ne se lavent quasiment jamais.
Les héroïnes non plus car quand elles sont dans une salle de bains, il leurs arrive systématiquement quelque chose de désagréable.
L'héroïne ne peut jamais prendre sa douche ou son bain sans être attaquée par un méchant/monstre.
Lorsque l'héroïne se regarde dans une glace puis se baisse pour prendre quelque chose et se relève, il y a toujours un méchant/monstre qui apparaît derrière elle.
Lorsque l'héroïne entend un bruit chez elle la nuit, elle explore systématiquement toute la maison avec une lampe de poche, habillée en robe de chambre.
Comme ils voient parfaitement dans le noir, les méchants coupent toujours l'électricité d'une maison avant d'entrer.
Dans le cas d'une poursuite, le héros doit toujours prendre la main de l'héroïne pour l'aider à courir car elle est incapable de courir par elle-même.
Les héroïnes ne sortent qu'avec des héros ou des méchants, jamais un mec "normal".
Les chats passent une bonne partie de leur temps à sauter à l'improviste juste devant le visage du héros ou de l'héroïne.
Sinon, les chats utilisent leur temps libre pour détourner l'attention des gardes en faisant du bruit à la place du héros même dans des endroits où ils n'ont rien à faire : base militaire, bureau, musée, etc...
Quant on tire sur un cavalier, c'est son cheval qui est touché et qui tombe.
Les chiens ne meurent jamais. Ils sont entre autre : éruption-volcanique-proof, inondation-proof, tornade-proof, tremblement-de-terre-proof et aliens-proof. ("proof " = "à l'épreuve de" en anglais)
Les cochons parlent.
Les extra-terrestres sont toujours en avance sur nous.
Il y a toujours de la place pour se garer juste devant l'endroit où se rend le héros.
Un policier ne peut résoudre une enquête sans se rendre dans une boite de nuit.
Un policier s'engueule toujours avec son supérieur.
Un policier est toujours obligé de menacer son indic pour le faire parler (A mon avis, ils ne doivent pas les payer !).
Un policier ne peut résoudre une enquête difficile sans être mis à pied ou renvoyé de la police.
Le supérieur d'un policier lui attribut toujours un nouveau binôme qui ne lui plaît pas.
Un policier est toujours prêt à utiliser des moyens illégaux pour faire avancer son enquête.
Un policier détruit plusieurs voitures de police pour chaque enquête.
Lorsqu'un policier poursuit un méchant en voiture, il renverse toujours des poubelles ou des étals de marché.
Lors d'une poursuite de voitures, il y a toujours un camion qui vient couper la route/rue/allée.
Dans un film d'action, un tiroir ouvert en gros plan contient toujours une arme à feu.
Un soldat qui montre une photo de sa femme va bientôt mourir...
Quelqu'un qui dit : 'Je ne peux pas vous en parler au téléphone, rencontrons-nous...' va bientôt mourir ! De préférence abattu sous les yeux du héros.
Un adolescent qui fait l'amour dans un film d'horreur va bientôt mourir !
Un méchant qui change de camp et se décide à aider le héros va bientôt mourir !
Dans un film de guerre, le noir qui fait partie de l'équipe du héros va bientôt mourir !
Dans les films d'horreur, les enfants survivent, rarement les adolescents.
Une personne poursuivie par un méchant court toujours dans la même direction et en ligne droite.
Les héros ont des yeux spéciaux qui leur permettent de voir sous l'eau comme s'ils étaient des poissons et cela même dans les eaux les plus sales notamment dans les ports.
Les héros ont la possibilité de savoir quand une information importante les concernant va passer à la télévision, ce qui leur permet d'allumer leur poste juste au bon moment.
Le héros est toujours un maître aux échecs.
Les armes à feu tirent des balles en sucre puisqu'un simple canapé en tissu suffit pour s'en protéger.
Les méchants laissent toujours les clés de contact sur leur véhicule pour permettre au héros de s'enfuir avec n'importe quelle voiture, camion, avion, hélicoptère pris au hasard.
Les voitures sont toutes munies d'auto pilotes, pour que le conducteur puisse discuter avec les autres passagers sans avoir à regarder la route.
Les personnages de 99,9 % des films ne ferment jamais à clé la portière de leurs voitures.
Un méchant arrive toujours à crocheter votre portière et à se cacher sur le siège arrière de votre voiture et vous ne le découvrez qu'une fois assis.
Chaque voiture est équipée de nombreux réservoirs d'essence tout autour de la carrosserie pour garantir qu'elle explosera au moindre accident.
Les voitures sont aussi équipées de suspensions et d'essieux spéciaux, ce qui permet aux voitures de faire des sauts en l'air et de continuer à rouler alors que des suspensions et des essieux normaux auraient éclaté en morceaux.
Lorsque le héros et le méchant se battent sur le toit d'un véhicule, il y a toujours une branche, un poteau ou un pont qui vient frapper le méchant en pleine tête.
Le chef des méchants doit tuer l'un de ses hommes pour que l'on sache que c'est lui le chef !
On est 6 milliards sur cette planète, mais généralement le héros connaît personnellement le chef des méchants... Deux explications possibles à cela : soit il est vraiment très con et choisit vraiment très mal ses fréquentations, soit il doit avoir un carnet d'adresse de 2 tonnes 5 !
Un entrepôt désaffecté est l'inévitable lieu de la bataille générale entre le héros et les méchants.
Les héros ont des c[*****]es en béton. S'ils reçoivent un coup de pied entre les jambes, ils grimacent et repartent immédiatement.
Les méchants ne savent jamais tirer, les héros (même débutants) sont tous des as du flingue et font toujours mouche.
Les héros et les méchants ne font jamais de crise d'hypoglycémie en plein pendant une poursuite haletante alors même qu'ils ne mangent pratiquement jamais.
Lorsqu'un méchant veut tuer quelqu'un dans un hôpital, il entre tranquillement dans la lingerie, d'où il ressort habillé en médecin (y compris le badge et le stéthoscope). Il peut alors se balader tranquillement dans tout l'hôpital car personne ne s'étonne de ne pas connaître ce médecin.
Le méchant, s'il a une milice/armée, embauche toujours des incapables qui n'arrivent jamais à trouver/tuer le héros ou l'héroïne, même à 100 contre 1.
Le méchant, s'il a une armée ou milice arrive toujours à survivre même en se prenant une bombe atomique sur la gueule (mieux, il vient de quitter son QG au moment où arrive la bombe) alors que ses sbires tombent à la moindre balle perdue (le méchant est plus solide).
Le héros a un super plan des lieux dans la tête qui lui permet de pister un méchant même en pleine foule et dans un labyrinthe.
Il y a toujours un bouffon de service qui gravite autour du héros. Il agace le héros et a deux destins possibles, soit il gagne le respect du héros en sauvant sa vie, soit il meurt en sauvant la vie du héros.
Une voiture explose toujours 10s après un accident, elles doivent avoir un minuteur intégré en série.
Un médecin légiste est toujours en train de manger un sandwich lorsqu'il montre un cadavre à un policier, quand il ne fait pas des blagues du style : quelle belle cervelle, on en mangerait !
Si un méchant fonce sur un policier qui n'est pas le héros, celui-ci essaye de tirer sur le chauffeur du véhicule qui lui fonce dessus sans y réussir et se fait écraser au lieu de s'écarter.
Un héros a un corps qui s'adapte à toutes les tailles car lorsqu'il assomme quelqu'un et lui prend ses vêtements, ils lui vont sur mesure.
Quand un couple se retrouve au lit, les draps sont spéciaux, ils arrivent jusqu'a la taille des héros, mais toujours au-dessus des seins des héroïnes.
Les belles femmes dorment toujours nues, mais elles ont un drap sur la poitrine au réveil.
Les hommes n'ont jamais d'érection matinale.
Les héros sont souvent flics donc avec un revenu très bas mais se paie toujours des supers voitures genre cabriolets et autres Porches, c'est le syndrome dit des "Deux flics à Miami".
Le héros peut aller dans n'importe quel pays puisque les gens parlent tous la même langue que lui et si ce n'est pas le cas il sait parler couramment toutes les langues étrangères.
Les numéros de téléphones commencent tous par 555 aux Etats-Unis.
Un héros se fait généralement attaquer par les méchants quand il va pisser (surtout dans les aéroports) - ce qui explique qu'il n'y va pas souvent, même s'il gagne toujours.
Tous les restaurants ont des toilettes qui donnent sur une arrière-cour que les méchants ont oubliés de surveiller.
Tous les cauchemars s'avèrent être prémonitoires.
Lorsqu'on éteint la lumière dans une chambre, la lune s'allume.
La perte d'un ou deux litres de sang n'est pas gênante pour un vrai héros.
L'héroïne se réveille toujours bien maquillée et bien coiffée comme si elle sortait d'un salon de coiffure.
95% des femmes et 100% des enfants sont dans le camp des gentils.
Par contre les mecs en costard/cravatte sont pratiquement toujours des méchants.
Tous les avocats sont des méchants.
Quand une femme se bat contre un homme, elle gagne toujours car généralement elle est maître expert en karaté.
Dans les rares cas où elle ne l'est pas, elle arrive au moins à lui flanquer un coup de pied dans les c[*****]es.
Et comme l'adversaire d'une femme est presque toujours un méchant, il n'a pas des c[*****]es en béton et il tombe en criant.
Les jeunes femmes scientifiques portent toujours des lunettes qu'elles enlèvent pour parler au héros
Les jeunes femmes docteur en physique nucléaire se baladent toujours en tenue Lara Croft
Lorsque le héros traverse une rue rapidement, il y a toujours une voiture qui freine brutalement et manque de le renverser.
Si un noir ou un italien a un rôle important, c'est souvent un gentil, s'ils sont plus de trois, c'est un gang de méchants.
Tous les anciens du KGB travaillent pour la mafia russe.
Tous les Chinois font du karaté. (C'est d'autant plus étonnant que le karaté n'est pas chinois mais japonais !).
Toutes les grandes sociétés américaines ont des équipes de tueurs à gages.
Si le héros, qui se cache des méchants/flics/militaires, appelle son meilleur ami et que celui-ci lui dit : "Dit moi où tu es que je vienne te chercher." c'est que l'ami en question va le trahir.
Les villes américaines sont pleines de hangars/usines abandonnés où les méchants peuvent se cacher à leur guise.
Lorsqu'un garde/sentinelle est tué, il a toujours la bonne idée de mourir vite et en silence.
Lorsque le héros veut rencontrer un type dans son bureau, il y a toujours une secrétaire qui tente de l'en empêcher en affirmant qu'il n'est pas là.
Quand un groupe d'adolescents s'en va en vacances, ils choisissent toujours un chalet dans le fond d'un bois complètement isolé de la civilisation.
Quand la jeune blonde se fait courir après, elle choisit toujours les marches plutôt que de sortir en dehors de la maison.
Le copain de la blonde, qui paraît très gentil, est bien souvent celui qui s'avère être le méchant.
La plupart du temps, la jeune blonde retrouve le nul de l'histoire qui agonise dans une garde-robe et qui essaie de lui dire, grâce à ses derniers soupirs, que le méchant est juste derrière elle, tandis qu'elle, elle ne comprend pas du tout et elle essaye de l'aider.
Si le noir du film a plus de 35 ans,, il est chauve ou a le crâne rasé.
Le trafiquant de drogue est généralement sud-américain. Il habite une maison ultra luxueuse, porte un catogan et s'habille uniquement chez Armani.
Le héros n'enclenche jamais le cran de sûreté de son flingue. Malgré ça, même en cas de chutes à répétition, il n'y a jamais un coup qui part tout seul.
Parfois, à la fin du film, tous les gentils qui étaient en second ou troisième rôle sont morts. Mais le héros garde le sourire, sauf s'il avait son meilleur ami dans le lot. Dans ce cas, le film se termine par une visite sur sa tombe.
Quand on tire sur un cavalier, si ce n'est pas le cheval qui est touché, le cavalier a toujours un pied coincé dans un étrier et se fait traîner par son cheval. S'il tombe directement et n'est pas mort, c'est qu'il sert par la suite dans le film.
Si le héros fume, c'est parce que c'est un rebelle ou un type totalement désabusé.
Malgré son immense carnet d'adresses, le héros a une mémoire éléphantesque et connaît par coeur tous les numéros dont il a besoin, à l'exception de ceux qu'il découvre pendant le film.
Quand on est noir et gentil mais qu'on est pas le héros du film, on a 100% de chances de mourir avant la fin (en sauvant le héros de préférence). Cette règle s'applique aussi aux autres minorités.
Si vous êtes noir et policier, en cas de problème, vous êtes obligé d'être à 2 mois de la retraite.
Pourchasse dans une ville, vous aurez toujours la chance de pouvoir vous dissimuler au milieu d'un défile de la saint Patrick, n'importe quel jour de l'année.
N'importe qui peut facilement faire décoller un avion, pourvu qu'il ait quelqu'un dans la tour de contrôle pour lui donner l'autorisation de partir.
Le système de ventilation de n'importe quel bâtiment est le parfait endroit pour se cacher. Personne ne pensera à vous trouver et, en plus, vous pourrez accéder à toutes les pièces de l'édifice sans aucun problème.
Le héros peut se prendre les plus terribles coups sans broncher, mais sursautera quand une femme tentera de nettoyer ses blessures.
Le chef de la police est toujours noir.
Au moment de payer le taxi, ne regardes jamais dans ton portefeuille pour sortir un billet : prends un billet un au hasard et tends-le : C'est toujours le prix exact.
Les cuisines ne sont pas équipées de lumières. Quand vous pénétrez dans une cuisine en pleine nuit, ouvrez le frigo et utilisez sa lumière a la place.
Une simple allumette ou un briquet suffit pour éclairer une pièce de la taille d'un terrain de foot.
Même si vous conduisez sur une avenue parfaitement droite, il est nécessaire de tourner vigoureusement le volant de droite a gauche de temps en temps.
Un homme vise par 20 hommes a plus de chance de s'en sortir que 20 hommes visés par un seul.
La majorité des gens gardent un album rempli de coupures de journaux ; particulierement si un membre de leur famille est mort dans un étrange accident.
Lors d'une conversation très émouvante, au lieu de parler en regardant votre interlocuteur, placez-vous derrière lui et parlez à son dos.
S'il y a un malade mental psychopathe en fuite, cela coïncide en général avec un orage qui coupe le courant et les communications téléphoniques dans les parages. (Pratique pour les prévisions météo).
On peut jouer de la plupart des instruments de musique, surtout les instruments à vent et les accordéons sans avoir à bouger les doigts.
Au début du film le héros et l'héroïne se détestent et s'engueulent et finissent par sortir ensemble à la fin du film.
A la fin du film, il y a toujours pleins d'ambulances et de voitures de police avec de gyrophares pour venir en aide et réconforter le héros et ses amis blessés (même si 5 minutes avant, le héros était considéré comme l'ennemi public numéro un par la police). Il découle de la constatation précédente que la police voit la fin du film en même temps que le spectateur et se rendent compte de sa méprise.
Il vaut mieux être une pièce q'un billet. Quand on voit à l'écran l'argent dérobé par le méchant (ou la rançon) c'est que les billets vont soient s'envoler (en haut d'un pont, depuis un hélico..) ou alors qu'ils vont brûler (incendie, explosion...).
Personne ne se gratte le nez.
Encore moins les c[*****]es (sauf les méchants).
S'il y a un ordinateur avec un mot de passe, le héros arrive toujours à le trouver. Le héros n'oublie jamais ses mots de passe.
Le héros n'hésite jamais à s'accrocher au filin qui pend de l'hélico, à la portière de la voiture, au pare choc du camion, à la bouée du bateau, dans lequel le méchant essaye de se sauver.
Pour localiser quelqu'un qui appèle au téléphone, la police a toujours besoin d'un délai de 30 secondes à une minute (soit le temps pour celui qui appèle de donner les informations qu'il désire). corollaire : quand le méchant (ou le gentil en fuite) téléphone à la police, il raccroche toujours quelques secondes avant de se faire localiser.
Les portables ne sont jamais déchargés ou leur crédit épuisé.
Les enfants du héros sont toujours de bons élèves (c'est normal : Papa est un héro) et si ce n'est pas le cas c'est parcequ'ils sont surdoués (informatique, electronique...).
Le héros n'a jamais de problème de nourrisse (Les enfants de héros n'ont besoin de personne pour les garder).
Quand un des personnages du film se retrouve complètement saoul dans une soirée, on est sur qu'il va faire péter un gros scandale en public plutôt que d'aller vomir peinard dans son coin.
Le héros n'hésite jamais à tirer comme un malade sur le méchant qui s'échappe dans la rue, les piétons sont balles proof.
Théorème d'Archimède révisé : tout corps de femme plongé dans une baignoire connait une issue fatale.
Les normes de câbles informatiques qui posent tant de problème sur terre ne s'appliquent pas en cas d'opérations sur l'ordinateur du vaisseau alien.
Le héros est droitier s'il se prend une balle dans le bras gauche, et inversement.
Les héros ne dorment jamais. Si on voit un héros en train de dormir, il va être réveillé dans la seconde qui suit par un coup de téléphone.
Les méchants ne tuent jamais le héros quand il est à leur merci. Ils préfèrent perdre du temps à se vanter ou raconter leur vie.
Si un héros fait le plein de sa voiture, c'est qu'il va se passer quelque chose à la station-service.
Le héros se préoccupe de son niveau d'essence quand il est poursuivi par un hélicoptère le mitraillant.
Les ponts suspendus ne sont pas un motif d'arrêt du véhicule.
Lorsqu'une armée de méchants/militaires lance une grenade sur le héros , celle-ci provoque généramement une petite explosion et ne touche jamais le héros. Mais quand le héros réussit à rattraper une des grenades et qu'il la relance, il tue toute l'armée.
Lorsque le héros se fait courser par un méchant dans un immeuble , il s'enfuit toujours sur le toit , et lorsqu'il y est, il se rend compte qu'il n'a aucune issue.
Le héros dispose généralement d'un pistolet spécial qui à plus d'une centaine de balles.
Pour que l'héroïne tombe amoureuse du héros, il faut que celui-ci soit couvert de blessures et qu'il fasse semblant de ne pas avoir mal.
Lorsqu'un film américain se passe à paris, on voit la Tour Eiffel quelle que soit la fenêtre par laquelle on regarde.
Un héros n'a pas besoin de recharger son arme, sauf si, durant la fusillade, il trouve un bidon/palette derrière laquelle se cacher.
Dans un film d'épouvante, lorsque l'héroïne marche dans une zône boisée, le cadreur la suit toujours parallèlement en général à une ou 2 rangées d'arbre d'elle.
Dans un film d'épouvante, il est toujours nécessaire de traverser un parc ou un bois pour rentrer chez soi afin de justifier les frais de rail de travelling (voir remarque précedente)
Dans un film d'horreur, la scène finale se passe toujours pendant un grand orage pendant la nuit. De cette façon, lors d'une poursuite dans le jardin, cela donne une excuse à l'héroïne pour glisser dans la boue.
Quelle soit la vitesse à laquelle se déplace la fille, elle se fait rattraper par le méchant (cf.Halloween).
Il suffit de tirer au pistolet dans une porte pour l'ouvrir, même si c'est la 3 points exigée par les assurances...
Il suffit d'un coup de poing pour anesthésier un vigile sans le blesser, juste le temps de récupérer les documents.
Dès qu'il y a meurtre ou délit grave, une sirène de voiture de police retentit instantanément...
Le grand mechant est lui aussi est balle proof.
Le grand mechant est le seul mechant qui peut vraiment tuer des tas de ptits flics qui savent pas non plus viser
Le grand mechant as souvent tué (au choix) : le pere, le frere , le meilleur ami, la femme ... du héros. rarement la mere ou la soeur.
Lors de la bagarre finale, le heros et le grand méchant sont forcement reduit à se battre à mains nues.
Le heros se fait toujours maitriser grave en debut de bagarre finale, puis finalement pense à (au choix) : son pere, son frere etc ... que le grand méchant a tué sauvagement il y a quelques années, et lui met une énorme rouste ! !
Lors de la bagarre finale, il reste toujours un flingue de base à 2 cm des doigts du heros quand il se fait tabasser. Le grand mechant, bien content de pouvoir enfin se défouler, ne voit jamais que l'autre est a quelques cm d'un fligue !
Si le héros à une nourice qui garde ses enfants, et qu'il les laisse, il peut être sûr de retrouver la nounou ligotté dans le placard et ses enfants kidnappés.
Tous les véhicules que la police réquisitionne toujours en cas d'urgence pour poursuivre les méchants se retrouvent systématiquement en miettes.
Lorsque le téléphone du héros sonne chez lui, c'est toujours le soir quand il travaille à son bureau, ou sur son PC ; et il enlève ses lunettes pour décrocher.
Si l'héroïne chante sous la douche rien ne se passera ; en revanche si c'est le contraire, il y a une musique de suspense, et elle se fait agresser, juste avant que le héros, qui l'avait appris, n'arrive pour la sauver après avoir grillé tous les feux rouges en venant.
Un garçon qui nettoie un verre derrière un bar, est forcément l'indicateur du héros.
Les méchants donnent toujours rendez-vous dans des entrepots près de la mer, car il n'y en a jamais dans la ville.
En revanche si l'entrepôt est dans la ville c'est que le héros va arriver pour découvrir la trame du complot avant de tous les tuer.
Un méchant qui va faire des révélations aux héros, prend bien le temps de trainer en longueur, en répétant ses mots ou en bafouillant ; histoire que son chef ait le temps de l'abbattre.
Le héros n'attends jamais aux feux de signalisation pour traverser.
D'ailleurs il ne se fait jamais écraser.
Si une femme est une méchante elle est toujours étrangère, principalement russe, japonaise ou allemande.
Un héros a toujours des préservatifs sur lui car on ne le voit jamais en acheter.
Chaque fois qu'on parle du président des Etats-Unis dans un film, c'est qu'il risque de mourrir.
Mais à chaque fois le héros est là pour le sauver.
Le héros n'est jamais roux.
Le héros a toujours le plein d'essence dans sa voiture pour faire des course-poursuites.
Les méchants aussi, mais pour que leurs voitures explosent.
Le héros ne couche jamais avec des noires, sauf si ilestnoir ;c'est valable pour les autres minorités.
On ne peut pas appartenir à une minorité sans faire d'activités illégalles, ou être un informateur du héros.
Le héros sait parfaitement danser, car il a pris des cours pendant 10 ans.
Quand une femme décroche le téléphone chez elle, elle fait ou la cuisine, ou elle est en robe de chambre et elle allait se coucher, ou elle était sous sa douche.
Le héros n'a jamais besoin de se moucher ou de faire caca.
Le héros ne lit jamais rien sauf des rapports de police.
Le héros n'a jamais de problèmes au lit avec les femmes.
Le héros s'envoie toujours au moins une fois en l'air dans le film.
Le chef des méchant meurs toujours d'une manière très compliquée et douloureuse, et pas d'un simple coup de revolver comme ses subalternes.
Le héros découvre toujours toutes les réponses relatives à l'enquête sur son PC (internet).
Quand c'est une héroïne, souvent, elle consulte des microfilms à la bibliothèque du coin et tombe pile sur le bon article en 2 minutes !
La prise de note dans une enquète se fait toujours sur un grand calepin aux pages jaunes et à l'aide d'un crayon à papier, faut croire qu'il aime pas les stylos aux USA !
Les méchant ont toujours des phrases récurente pour ceux qui découvrent leurs plan comme : "la curiosité est un vilain défaut", "ce n'est pas bien d'écouter les conversations des grandes personnes", "Malheureusement vous en savez beaucoup trop" (celui-là vient généralement après que le grand méchant aie dévoilé tous ses plans).
Si on est agent du FBI, mais pas le héros du film, on ne sert généralement qu'a lui poser des bâtons dans les roues, et généralement à mourrir après s'être rendu compte que le héros n'était pas un vilain.
Les grands-méchants, contrairement aux héros, n'ont jamais de famille. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils peuvent être aussi méchant.
Le grand-méchant est généralement un surdoué qui a pris un mauvais chemin, et qui a une soif innassouvie de mégalomanie ; ceci s'applique généralement aux scientifiques ou aux hommes d'affaire.
Quand le grand méchant sort de prison, il ne dit pas qu'il s'est fait violer dans les douches ; ceci n'arrive uniquement qu'aux ex-criminels que le héros a coffré et qui sont obligé de lui servir d'indic dans le film.
Les grands-méchants ne sont jamais hommosexuels, hommes d'Eglise, très moches ou ayant une quelconque tarre physique ; si ils sont riches ils sont forcément philantropes, mais dans le cas contraire, ils sont sans foi ni loi.
Quand le méchant pose le canon de son arme sur la tête du héro après avoir flingués tout ses potes le canon (qui doit être très chaud) ne brûle jamais le héro.
Dans les films d'horreur, il y a toujours un mec qui s'y connait dans ce genre de truc (randy dans scream) et généralement si le film a du succès il ne survit pas.
Le héros a toujours une arme cachée dans son pantalon.
Le héros sort toujours quelques secondes avant la fermeture de la porte automatique, ou son pote le balèze maintient la porte ouverte.
"La citoyenneté réduite au droit du sang consiste à dire que la République est génétique et non pas spirituelle", Waddle, 2013.
Mon blog
Mon blog
-

Waddle - Enculeur de moucheS
- Messages: 24109
- Inscription: 10 Mai 2003, 18:05
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von

(arrête de polluer ce topic waddie !
Le fascisme au fait, c'était pas déjà l'histoire d'un mec en marche qui fascinait les foules avec son culte de la personnalité ?
-

von Rauffenstein - ultima ratio regum
- Messages: 46968
- Inscription: 20 Fév 2003, 18:01
- Localisation: Auteuil
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
Quelqu'un a t'il vu le film L'éléphant?
C'est un film assez déroutant avec d'interminables plans séquences (qui rappelleront ceux de l'Overlook Hotel dans "Shinning"... le film est truffé de références au cinéma de Kubrick) et des dialogues minimalistes. Mais c'est un film cinématographement intéressant dont on sort un peu vaseux...
J'ai trouvé une analyse assez originale du film sur le site cadrage.net A ne pas lire si on n'a pas vu le film et qu'on souhaite le voir
GUS VAN SANT ET LE MINOTAURE
par Alexandre Tylski
Le dernier film de Gus Van Sant a reçu la Palme d’Or et le Prix de la Mise en Scène à Cannes 2003 ainsi que le Prix Pédagogique de l’Education Nationale Française, ce qui ne plaira pas à tout le monde.* Voici notre analyse du film ELEPHANT.
ELEPHANT de Gus Van Sant n’est pas un film qui " dénonce " (par ailleurs limite de cinéaste du pourtant passionnant Michael Moore – même s’il en questionne sans cesse les rouages et dangers). Le terme " dénoncer " est employé à tort et à travers par les médias. Ceux-là voient fréquemment dans l’action d’une association sociale, un livre fort ou un film engagé, la " dénonciation " d’un problème ou la " dénonciation " d’un certain système. Un bon film ne dénonce pas, il ne s’abaisse pas à cela, heureusement, il " énonce " comme on le verra. La dénonciation est revenue à la mode en France par certaines lois remises au goût du jour, espérons que ce mot de sinistre mémoire soit de moins en moins employé à propos des films et des cinéastes.
ELEPHANT de Gus Van Sant n’est pas non plus un film qui " sensibilise. " Ici nul pathos, ni démagogie entendue, ni voix off explicative ou étalage de chiffres. Le film de Gus Van Sant est un film avant tout sensible mais précisément pas " sensibilisant ". Le cinéaste évite soigneusement l’écueil du film militant (il a d’ailleurs toujours refusé d’en faire) – le genre militant dénonçant et sensibilisant trop souvent à coups de marteau. Le verbe " sensibiliser " sonne à nos oreilles comme " annihiler ", " aliéner ", " étouffer ", " diriger ". Quel spectacle que celui qui cherche à tout prix à sensibiliser en tirant sur la corde sensible. Godard rappelle ainsi à juste raison qu’un film n’a pas à séduire, ni à chercher à faire " adhérer " (à fédérer), mais plutôt à " convaincre " éventuellement. Non par la rhétorique du politique, mais par la dialectique.
Plan de l’analyse de film de ELEPHANT de Gus Van Sant :
1. ELEPHANT : un film animalier
Le titre du film/Le lycée comme un zoo/L’ange taureau/Les trois petits cochons
2. ELEPHANT : la bulle sonore
Les fantômes errants/Ecouter le photographe/Alex et Beethoven/La jungle
3. ELEPHANT : le crâne, la prison & la spirale
La cité de verre/Trajectoires/Tourner en rond
4. ELEPHANT : le plan séquence & la disparition
Filmer de dos/Tout doit disparaître
5. ELEPHANT : Le regard tourné vers le ciel
Ouverture et final en Ciel/Quatre regards vers le haut
6. ELEPHANT : le triomphe de la civilisation
Evocation de la guerre/Quel triomphe ?
________________________
ELEPHANT : un film animalier
Le titre du film
Le titre du film ELEPHANT est au départ une référence consciente au téléfilm du même nom réalisé par le cinéaste (depuis disparu) Alan Clark sur la violence en Irlande du Nord (un titre évoquant aussi l’impossibilité pour un aveugle à se représenter la forme d’un éléphant). Le titre ELEPHANT est aussi une référence à la mascotte des Républicains aux USA: l’éléphant. Gus Van Sant avoue : " On s’est amusé avec la dimension politique que peut représenter le titre, et donc sa charge satirique envers, bien sûr, l’aspect aliénant du système d’éducation américain. (…) Elephant, c’est ce qui se voit comme le nez au milieu de la figure, mais ce que tout le monde souhaiterait bien occulter. " (1)
Mais nous pouvons aussi décrypter le titre " ELEPHANT " en tant que symbole culturel, voire parfois cultuel. Ainsi, il ne s’agirait pas d’oublier que l’éléphant est la monture du Dieu de la Foudre Indra (on entendra dans le film la foudre gronder avant le massacre). C’est aussi un animal aux grandes oreilles (Alex, le tueur, souffre de surdité lors de la scène de la cantine et toute la bande sonore du film se décompose de résonances et de réverbérations très sensibles). C’est aussi " l’éléphant spirituel et sacré " (le Christ) qui relève Adam après sa chute. L’éléphant est cet animal que l’on dit sage, sans agressivité et solidement ancré au sol ; dans les rêves il représente une réalité terrestre avec laquelle certaines personnes n’arrivent pas toujours à garder le contact.
Bref, autant d’éléments en rapport direct avec le récit et l’esthétique de ELEPHANT de Gus Vant Sant. Un titre pour le moins emblématique des figures animales qui traversent son film : un sweat-shirt représentant une tête de tigre, un T-Shirt jaune représentant un taureau noir, un chien sautillant au ralenti, un éléphant représenté en croquis sur le mur de la chambre des tueurs, le son d’oiseaux pendant la tuerie dans les couloirs du lycée et la scène finale dans la chambre froide remplie de viande animale. Il fallait donc prendre ELEPHANT dans son sens premier : un film animalier. Nous ne sommes pas dans une ménagerie gitane à la Kusturica, mais dans une impossible Arche de Noé déguisée en lycée. Un parc animalier aux accents apocalyptiques. Un retour au monde sauvage.
Le lycée comme un zoo
LE TIGRE. Michelle est une jeune fille timide et rondelette, et visiblement complexée dans les vestiaires. Elle ne semble pas assumer sa féminité. Elle fait figure de garçon manqué. Gus Van Sant nous la présente pour la première fois portant un sweat-shirt sportif arboré d’un tigre (l’emblème même du lycée mais que seule, elle, porte). On sait que le tigre a pour particularité dans les rêves et les mythes d’être un félin gracieux et puissant : tour à tour féminin (longs cils autour des yeux) et masculin (grondement grave). C’est aussi la bête noire rampante (Michelle rase les murs) des premiers hommes, autre retour aux peurs primaires et barbares. Gus Van Sant nous indique la nature foncièrement hybride de Michelle. Mais la nature tout aussi hybride et sauvage des autres personnages.
LE TAUREAU. John est un blondinet habillé de jaune. Cet ange blond marque l’esthétique du film (une sorte de cousin de Tazzio ?) et la mémoire des personnes ayant vu le film (les images illustrant par exemple les critiques de film parues sur ce film mettent presque toujours en valeur ce blondinet). Lui aussi fait figure d’hybride. Car en effet, son T-shirt si particulier y fait représenter un taureau noir sur fond jaune (2) et l’on connaît l’attachement de Van Sant pour les costumes, notamment dans Prête à Tout (1995) avec Nicole Kidman. Le contraste est fort (phrase reprise d’ailleurs dans le film) et nourrira l’esthétique entière du film. Taureau rappelant les peintures pariétales et à la fois symbolique de vie et de mort, on ne voit littéralement que cela lorsque Gus Van Sant filme John déambulant dans les labyrinthes du lycée.
John, l’ange taureau
John est ainsi une sorte d’ange taureau (dont l’écho se fera à la fin avec Benny, son double, jeune noir au T-shirt jaune). Une créature hybride, voire androgyne, que nous soupçonnons un moment d’être le tueur (Gus Van Sant insiste sur lui dans le premier mouvement du film comme s’il s’agissait de son héros principal). Les apparences sont trompeuses (il sera d’ailleurs question d’apparence dans un débat lycéen du film) : le simulacre de l’image est ici au cœur.
Ce jeune homme taureau serpentant dans les labyrinthes rappelle alors inévitablement le mythe même du Minotaure. L’origine de la représentation. Retour aux sources des légendes initiatiques (et de l’art pariétal). Questionnement alors de Gus Van Sant sur " Comment évoluent les mythes et les contes aujourd’hui ? " mais aussi " Qu’est-ce qu’une image ? " et " Comment la jeunesse vit-elle avec les images ? " Comment sont-ils piégés par elles comme dans un labyrinthe de signes ? – pas étonnant de voir ainsi plusieurs scènes se dérouler dans la chambre noire du lycée, Gus Van Sant scrute précisément la création photographique et l’imago.
Les 7 jeunes filles et jeunes garçons offerts au Minotaure sont représentés dans le film par les cartons (retour au cinéma muet) indiquant les noms de ces jeunes (muets ?) – liste létale d’une morte annoncée, ils sont comme jetés aux lions. Les cartons sont autant de plaques mortuaires, de tombeaux ouverts. Gus Van Sant détourne le mythe du Minotaure et questionne une époque, ou plutôt : la représentation d’une époque. Dans le monde décrit dans ELEPHANT, les enfants ne sont plus uniquement les chassés, il sont aussi les bourreaux.
Les Trois Petits Cochons
La présence du conte et de l’animal se poursuit et s’achève jusque dans la dernière scène, tournée dans la chambre froide des cuisines du lycée. Et sur une contine détournée en air de croquemitaine. Alex a passé plusieurs portes pour trouver deux amoureux dans une chambre froide. Comme dans Les Trois Petits Cochons (et SHINING de Kubrick, 1980), il traverse les portes. Alex pointe son arme sur le couple amoureux et récite: " Amstramgram, pic et pic et colegram, bourre et bourre… Si tu prends un tigre par la patte… et qu’il bouge… laisse-le filer… " Des morceaux d’animaux froids pendent au fond alors que les jeunes amoureux sont laissés hors champ, déjà " disparus. " Les corps en mouvement constant du début du film se gèlent. Le zoo est mort.
ELEPHANT : la bulle sonore
Les fantômes errants
A la fin du film, juste après la scène finale de la chambre froide, c’est un ciel qui nous est montré avec, en fond sonore, des grues fantomatiques (nous ne ferons que les entendre). Gus Van Sant termine le film avec ces volatiles errants fuyant le massacre sur la terre. Il nous invite à rêver, à sortir du labyrinthe de la mort. Labyrinthe qu’il aura pris soin de " sonoriser ". Gus Van Sant raconte : " On a travaillé pendant tout le film avec un MS stéréo, un appareil équipé de deux micros, l'un tourné vers le haut, l'autre vers le bas, qui donne une sorte de son en 3D. Pour ce qui est de l'atmosphère sonore générale, tous les comédiens étaient équipés d'un micro." (3)
Les effets de réverbérations indiquent une présence omnipotente, céleste, confinant au religieux (nous pensons ainsi à la scène réverbérée où le blondinet pleure et semble en prière). Les échos démultiplient, décomposent, encore l’espace et le vide glacial. Mais personne ne semble répondre aux échos, personne ne semble vivre ici. Et, si nous tendons l’oreille, aucun pas ne se fait même entendre. Tout le film consiste ainsi à filmer de jeunes lycéens marcher dans des couloirs et aucun bruit de pas pourtant, ne s’entend. Tous sont là, fantomatiques, déjà morts. Idée forte de " mise en son " d’un vide béant prêt à avaler tout le monde, à l’image des perspectives vertigineuses.
Ecouter le photographe
ELEPHANT décrit ainsi un monde du silence où il n’y a pas exactement de silence mais une infinité de micro-bruits et dans lequel chacun crée son monde. Elias, le jeune photographe, Gus Van Sant le décrit d’un point de vue sonore. Lorsque Elias est dans la chambre noire, il place sa pellicule dans une spirale elle-même enfermée dans une boîte révélateur. Il agite consciencieusement sa boîte et Gus Van Sant en gros plan visuel et sonore scrute ce moment. Le bruit de la boîte est semblable à une horloge ou à une bombe. Et ce son de libérer " d’un coup " l’imagination. La révélation des images en cours auront peut-être l’effet elles aussi d’une bombe. Un son évoquant le terrorisme ou la guerre mais aussi cette arme meurtrière qu’est l’image… et son développement.
Cette scène de boîte est aussi symptomatique de ce photographe, Elias, qui, lorsqu’il traverse le couloir, est accompagné, en off, d’une musique flottante qui semble tout droit sortir de sa boîte crânienne ou de son état d’esprit. Les sons de couloirs et des lycéens présents disparaissent. Il vit dans son monde et déambule ainsi au gré des notes. Au moment où Elias salut une amie, le son réel revient un instant, la musique s’adoucit, puis, aussitôt, Elias reprend son chemin et son monde intérieur et sonore revient à nous. Dans ELEPHANT, l’un ne vas pas sans l’autre : pas d’image sans musique. Pas d’image sans monde intérieur complexe.
Alex et Beethoven
Le cinéaste révèle aussi le monde sonore intérieur d’Alex, le jeune tueur. Nous savons que les vrais tueurs de Columbine écoutaient beaucoup de musique, en particulier Marilyn Manson (interviewé dans BOWLING FOR COLUMBINE), qui lui vaut encore de vives attaques. Gus Van Sant détourne alors les faits et prend le contre-pied en filmant le tueur jouer du Beethoven. (4) L’ironie est d’autant plus intéressante qu’Alex (l’acteur s’appelle aussi Alex) se trouve être aussi le prénom du jeune tueur dans ORANGE MECANIQUE (1971), un film que Gus Van Sant vénère pour son traitement de la violence dans la société et dont il s’est ouvertement inspiré pour ce film.
" La Lettre à Elise " de Beethoven est utilisé mais également la Sonate op. 27 n. 2 (appelé Clair de Lune par le poète Rellstab) qui fut dédiée à Giuletta Guicciardi et dont Beethoven était amoureux. Une déclaration d’amour s’est ainsi glissée au cœur de ce film a priori froid. Rappelons ici que la partition de Le Clair de Lune doit se jouer " senza sordini " (c’est à dire avec pédale) et mène ainsi à la fusion constante des basses, à la " fluidité d’une coulée sonore continue… " (5) Le choix de Gus Van Sant pour ce morceau s’entremêle parfaitement avec la coulée visuelle du film, l’état de flottement y est saisissant, le film comme un liquide amniotique. Un monde en gestation, mais un mode déjà mort pourtant.
Néanmoins, la force est de remarquer que le protagoniste du jeune " tueur pianiste " (l’association est plus qu’hybride), Alex n’est pas nécessairement lié à ce liquide amniotique. S’il joue en effet Beethoven, il " massacre " quelque peu les morceaux du maître (avec saturation sonore) et alors qu’il interprète Beethoven dans sa chambre, Alex " dérape " sur le piano et Gus Van Sant alors de couper le grand mouvement circulaire dans la chambre. Il coupe et revient sur un plan d’Alex. La coupure est infime mais bien là. Alex est dans une coquille ronde percée (comme sa voiture a un pare-brise brisé). Une fissure est en lui et est évoque par le montage (Gus Van Sant est ici aussi le monteur du film). Cette cassure du montage avec Alex sera également présente dans la scène de la cantine où Gus Van Sant coupe, à nouveau, sur Alex alors que nous étions dans un long plan séquence. Alex est en rupture avec l’étouffant ballet imposé par les lignes rectiligne de ce lycée.
La jungle
Alors qu’Alex tire sur les élèves du lycée dans les couloirs, Gus Van Sant perce (métaphoriquement) le plafond du lycée en utilisant un hors champ sonore pour le moins étonnant : nous entendons de l’eau, du vent et des oiseaux. La panique se fait sentir par les corps en off dont on aperçoit furtivement quelques parties (le cadrage ici découpe les corps en choisissant de ne reste que sur le tueur et de ne révéler des autres corps que quelques extrémités passant furtivement dans l’image). C’est la loi de la jungle. Mais une presque reposante en contre-pied avec l’action. Une scène qui détonne avec celle de la cantine dans laquelle Alex semblait ne pas supporter le brouhaha général de cris d’adolescent (presque semblables aux oiseaux d’Hitchcock).
Alors qu’il est retourné au stade animal, Alex dira presque à moi-voix (se parlant à lui-même): " Je n'ai jamais vu de jour si immonde et si beau " Une phrase shakespearienne (tirée de Macbeth par ailleurs) qu’affectionne Gus Van Sant (on se rappelle les emprunts de vers shakespearien dans MY OWN PRIVATE IDAHO). Un gramme de poésie dans le massacre. Gus Van Sant nous rappelle que la monstruosité n’est pas nécessairement à opposer à la sensibilité ou la culture. Nature et culture pas toujours distincts. " L’art n’est pas le contraire de la barbarie. La raison n’est pas la contradictoire de la violence. " (6) C’est une des formules paradoxales et secrètes, hybrides, de ELEPHANT.
ELEPHANT : le crâne, l’orthonormé et la spirale
La cité de verre
ELEPHANT est un film crâne où l’on entend la jungle dans la tête d’un adolescent et que nous voyons à l’écran, un aquarium géant multicolore. Dans le film de Gus Van Sant donc, chacun est enfermé dans sa boîte, son bocal, sa bulle et le lycée lui-même d’apparaître comme une véritable cité de verre décomposée en cavités internes. Le rapport du corps au décor dans ELEPHANT est ainsi fondamental. ELEPHANT a été " photographié en 35mm, au format 1 : 33, qui évoque souvent les documentaires de Frederick Wiseman (Domestic Violence et High School) et les photographies de William Eggleston, qui, comme lui, ne dissocient jamais les êtres des décors où ils évoluent, des situations qui les façonnent. " (7).
Gus Van Sant a tourné dans un lycée qui venait de fermer, tournant ainsi aisément 5 semaines avec de vrais lycéens de Portland (ville où habite par ailleurs le cinéaste). Le cinéaste a fait de ce lycée un lieu nourri de chambres noires, de chambres froides, et dans lequel les couloirs semblent ne jamais finir. Une grotte post-historique. Beaucoup de vitrines de verre longent les couloirs eux-même souvent faits de murs de verre. Bref, un aquarium audiovisuel - lié au champ lexical animalier. Un monde animal domestiqué (nous verrons plus tard la question de l’architecture orthonormé).
Mais le monde extérieur (mis entre parenthèses du film) ressemble lui aussi à une bulle : quand ils ne sont pas au lycée, nous voyons ces jeunes évoluer dans leur chambre (Alex et Eric), une chambre fermée comme un bocal (lucarne en verre au-dessus du piano où apparaîtra en spectre Eric une cagoule noire sur la tête), leur cuisine étouffante (on ne voit même pas le visage des parents comme dans un Tex Avery), leur salon (avec le bocal téléviseur et au fond une vitre donnant vers le livreur), ou leur voiture (scène introductive entre John et son père).
Trajectoires
Quelques rares moments fugitifs nous sortent du bocal : en particulier ce ciel mystérieux qui finit par devenir nettement menaçant et annonçant la mort. La nature aussi préfigure une sorte de mort et de déclin : c’est l’automne. Mais tout ce monde là supposé être libérateur et reposant est marqué par la cassure (voiture heurtant le rétroviseur d’une autre voiture dès le commencement du film). Le père de John est perdu, brisé, et les routes, elles aussi sont orthonormé, quadrillées, comme dans une caserne.
" Trajets, parcours, topologie, quadrillage, lignes de fuite, lignes de désirs… Espace complexe donc, multitude de points de fuit singuliers, la perspective tourne. Rien d’irrémédiable. Cheminements. On ne choisit pas sa mort ? (…) Troupeau d’éléphants en marche, sans lieu précis, en errance. Chacun son allure, sa vitesse donc. Son désir… (…) Dehors, l’ange d’ELEPHANT fait sortir les corps encore en vie, aide le père à sortir de son absence, sans pathos, dans le silence des grandes catastrophes… Le ciel est vide, inquiet et beau. Une Saison en enfer ". (8)
Le film se lance sur une route, se poursuit avec un plan séquence suivant un jeune sportif dont le sweat-shirt rouge laisse apparaître, au dos donc, une croix blanche où il est noté " Lifeguard " (mot ironique quand nous connaissons le destin de ce protagoniste). Mais toute la visée est cette croix, semblable à une cible toute désignée dans la chasse à venir. Chercher l’erreur, chercher le centre, le cœur ou, comme le dira un des professeurs (un des rares adultes du film) : " le noyau de l'atome ".
Ces signes sont autant de codes de la route pour le voyage du film. Film de codes, de routes et de carrefours. Un monde de codes, carcéral. Un des acteurs (non-professionnels) du film dira à la presse : Il y a une pression terrible sur les élèves, déplore John, afin qu'ils aient les meilleurs résultats possibles en vue d'entrer à l'université." Sans oublier la discrimination sociale que "les élèves reproduisent au lycée le plus naturellement du monde, sans même s'en rendre compte, ajoute Alex. Gus filme le lycée comme s'il était une prison. Moi, je ressens ça en permanence. " (9)
Dans la chambre des tueurs, de la brique et des dessins au mur comme dans une cellule. Le champ est bouché. Mais la profondeur de champ des longs couloirs étouffent autant, avalent en spirale et les trajectoires des élèves à moitié éveillés fait figure de danse macabre comme à l’époque des grandes épidémies. Au Moyen-Age, cette danse était évoquée ainsi : " media vita in morte sumus " (au milieu de la vie nous sommes déjà dans la mort). Elèves fantômes, morts-vivants, le flottement est celui d’une déambulation morbide et sans quête.
Tourner en rond : figure de la spirale
Dans cette esthétique rectiligne, Gus Van Sant apporte néanmoins une sorte de contrepoint : les panoramiques. Un panoramique circulaire est utilisé dans la scène du groupe de discussion, mais leur propos étant vite convenu et sans profondeur, la caméra " tourne en rond " à l’image peut-être des protagonistes décrits à l’écran. De la même manière ce mouvement circulaire étouffant, en spirale, avalera les deux tueurs, Eric et Alex dans leur chambre. L’Eternel retour. La musique reviendra aussi, la nature reviendra aussi comme un retour barbare. Un mouvement de caméra de surveillance finira par dépeindre les deux tueurs endormis (morts ?) : la caméra pivote en panoramique comme une caméra de surveillance dans une vision panoptique digne des cellules d’observation.
4. ELEPHANT : le plan séquence et la disparition
Filmer de dos
Gus Van Sant filme ce monde carcéral de dos. Ce dispositif cinématographique, en méta-discours, mène à la réflexion. Pourquoi filmer si souvent les personnages de dos ? On aura parlé de référence aux images de jeux vidéo, mais cet inversement, ce questionnement hybride, de l’endroit et de l’envers mêlés, du positif et du négatif (qui chasse ? qui est chassé ? que se trame-t-il donc derrière les crânes ?), va plus loin. Ces images de dos font aussi référence à la peinture, par exemple à Giandomenico Tiepolo et son "Nouveau Monde".
Gus Van Sant, dans tous ses films, ramène toujours ses personnages à l’origine (leur foyer natal dans Drustore Cowboy (1990) ou My own private Idaho (1992), leur enfance dans Will Hunting (1997), etc.). Et cela est d’autant plus vrai ici que sa manière de filmer évoque un retour aux premiers portraits peints, égyptiens, qui ne peignaient jamais personne de face (même si ELEPHANT se permet de filmer aussi de face) s’accordant avec le souci des Egyptiens d’une continuité parfaite de la vie après la mort.
Or, Gus Van Sant fait revenir sa caméra à un endroit stratégique du lycée (où passeront tous ses personnages et où se déroule la pause photo du blondinet): un couloir. Un couloir dont un des murs est peint d’une fresque aux couleurs primaires (couleurs que portent les élèves pendant tout le film). Des élèves y sont peints (mortifiés) et on y voit une jeune fille représentée, de profil, les mains placées comme les Egyptiens. Ce clin d’œil de Gus Van Sant n’est pas le fruit du hasard, il désigne le portrait peint égyptien (origine du portrait) qui fut d’abord funéraire puis identitaire – les questions mêmes soulevées dans ELEPHANT.
Tout doit disparaître
Gus Van Sant avoua s’être fortement inspirer des films de Bela Tarr pour ELEPHANT. A la question que Libération en 1987 avait posée au cinéaste : " Pourquoi filmez-vous ? " Bela Tarr répondit : " Parce que je déteste les histoires, puisque les histoires font croire qu'il s'est passé quelque chose. Or il ne se passe rien : on fuit une situation pour une autre. De nos jours, il n'y a que des situations, toutes les histoires sont dépassées, elles sont devenues lieux communs, elles sont dissoutes en elles-mêmes. Il ne reste que le temps. La seule chose qui soit réelle, c'est probablement le temps. "
Les plans séquences dans ELEPHANT mesurent le temps qu’il reste (les ralentis du film mettant en valeur ce temps éphémère), ils sont funéraires. Inévitablement, les longues images de ELEPHANT se terminent toujours de la même manière (dont la systématique renforce l’horreur secrète): par la sortie d’un des personnages par une porte. Et lorsque celui-ci, ou celle-ci, ne disparaît pas par une porte, il ou elle disparaît invariablement du champ de l’image ne laissant plus qu’un grand flou sinistre.
Ainsi (par exemple):
- au début sur le terrain de sport: Michelle entre et disparaît du cadre (elle ne fera que passer comme un fantôme) puis, Nathan (sportif) entre à son tour dans l’image, part du terrain, traverse la pelouse et disparaît derrière la porte du lycée au fond.
- on suit Michelle (qui est réprimandée en off de ne pas porter de short) puis elle disparaît elle aussi par une porte dérobée (à l’image d’un drame shakespearien au théâtre).
- on accompagne Elias (photographe) dans les couloirs du lycée jusque dans la chambre noire où la porte se referme devant nous jusqu’au noir complet (difficile d’être plus clair!).
- on entre dans les vestiaires des filles, Michelle se déshabille pudiquement (on entend des ricanements en off), puis elle disparaît du champ laissant un vide flou.
Cette disparition finale au sein de chaque image (chacune représentant en soi un mini-film et une autre cavité interne au film) est un des secrets du film. Chaque plan séquence est comme la longue mise à mort du personnage, annonçant son destin et sa disparition du temps et de ce monde. Tout le film est ainsi cette danse collective macabre où chacun(e) va à sa perte. La fin de l’image : c’est ici paradoxalement la fin des personnages… et non nécessairement la cause de leur mort !
ELEPHANT : Le regard tourné vers le ciel
Ouverture et final en Ciel
La mort est déjà au commencement de ELEPHANT. C’est un épouvantail qui ouvre ELEPHANT : un pilonne électrique et téléphonique perdu, seul, sur fond de ciel mouvant. Un pilonne, une croix ou épouvantail : en tout cas, il ne bouge pas et effraie autant qu’il fascine. Le ciel au fond remue, change de couleurs, s’assombrit et est parcouru de traces d’avions voyageurs et de voix de jeunes en off. Cette cadavérique mascotte de la communication et du progrès semble, elle, bien paumée, immobilisée, morte et comme brûlée. Un spectre shakespearien au commencement du récit, abandonné dans une vision céleste. La tragédie est en route ou : déjà là.
Ce fragment-mère est aussi la toute première contre-plongée du film. Il y en aura d’autres. Ce regard tourné vers le ciel reviendra en effet à différents moments du film: au centre du film : un ciel s’assombrit, un épais nuage noir s’épaissit comme l’avancée d’un cancer irrémédiable, d’une gangrène lente et menaçante. Cette image à dimension biblique précède le massacre. Il est le poumon ou le cœur malade du film en un sens. Il est l’image ineffable d’une violence trop longtemps contenue et frustrée qui finit par se libérer. Ce ciel est un espace de liberté travesti en menace étouffante.
Le générique de fin représentera aussi un ciel. Mais à l’inverse de la première image : le pilonne électrique a disparu, reste le ciel. Disparition aussi des voix de jeunes, il ne reste que quelques bruits et croassements de jungle. Des volées de grues se font entendre. Les animaux ont gagné, l’épouvantail a perdu. L’humanité semble avoir complètement disparu. Mais le ciel sera aussi convoqué par les regards de ces élèves.
Quatre regards vers le ciel
- au tout début : une jeune fille un peu gauche, Michelle, s’arrête de marcher pour regarder vers le ciel. Elle semble entendre l’air musical que nous entendons nous aussi dans la salle, " Clair de Lune " de Beethoven, et y trouve réconfort. Le temps ralenti.
- plus tard : John (le blondinet) se recueille un moment dans une pièce du lycée, regarde vers le haut en prière. L’ange blond semble en appeler à Dieu.
- un peu plus tard encore : Alex (le tueur) prend des notes dans la cantine et inspecte partout vers le plafond pour peut-être repérer des caméras de surveillance. Caméras que nous ne verrons jamais, laissées hors champ – mais dont certains spectateurs soupçonnent alors l’existence en mémoire des images de caméras de surveillance lors du massacre au lycée de Columbine.
- Enfin : le jeune photographe, Elias, lève les yeux et ausculte ses négatifs. Il découvre ses images à la lumière. Que révèleront-elles ? On le saura jamais.
Quatre regards vers le ciel, quatre visages différents, quatre sentiments distincts. Mais l’appel de l’au-delà est bien là. Déjà. Pesant. Présent. Ils rappellent aussi les regards tournés vers le ciel des personnages de Gus Van Sant tout le long de sa carrière : Mat Dillon à la fin de Drugstore Cowboy (1990) River Phoenix dans My Own Private Idaho (1991) ou encore Matt Damon dans Will Hunting (1997). Trois regards, trois attentes, trois hors champs, trois " ailleurs " à venir que la caméra ne peut pas filmer, ne veut pas filmer, mais tente de regarder et de traverser à travers les visages.
C’est au fond un rapport solaire, parfois lunaire, avec la nature (on se rappelle l’injustement décrié Even Cowgirls get the Blues (1993) et ses images de Lune). Gus Van Sant, même dans ses films urbains, y insère toujours le couple nature/culture et ramène ses protagonistes d’où ils viennent, les confrontant à leurs racines et leurs pulsions primitives, mais aussi à leur peurs et désirs. ELEPHANT est, après GERRY en 2002 (film tourné entièrement dans la nature), une continuation logique dans la carrière de Gus Van Sant : on n’échappe pas à son origine, la nature revient toujours au galop. Alors : comment vivre avec ?
ELEPHANT : qu’est-ce que la civilisation ?
Evocation de la guerre
Entre 1997 et 1999, 8 cas de massacre en lycée aux USA. Le jeune Alex de ELEPHANT aurait-il pu dire : " Je ne doutais plus que la civilisation comme on la nomme, ne fût une barbarie savante et je résolus de devenir un sauvage. " ? (10) La conversation entre un père et son fils se résume dans ELEPHANT à évoquer la guerre (conversation dans la voiture au tout début du film). Le film fait un état des lieux d’un pays, les USA, en guerre civile. La fumée sorti du lycée, la panique des élèves, la jungle sonore, c’est la guerre qui recommence. Les républicains et leur mascotte éléphantesque y sont-ils pour quelque chose ? Peut-être pas, mais Gus Van Sant ne filme pas ce monde sans y parler fort à travers multitudes de détails. Nous ne croyons pas à l’objectivité du film comme certains l’ont prétendu ; " Elephant s’impose à nous par son audacieux souci de montrer le plus objectivement possible le comportement de ces jeunes gens soudain frappés de folie meurtrière… " (11) La bombe à spirale qu’agite Elias, le jeune photographe, dans sa chambre noire, ne serait-elle pas en réalité un cœur qui bat ?
Quel triomphe ?
Encore moins de regard objectif lorsqu’on remarque le T-shirt rouge d’Alex où est marqué : " Triomphe " ! Exprime-t-il le film nazi " Le Triomphe de la volonté " de Leni Riefenstahl (1937) ? ou encore l’Arc de Triomphe Antique ou l’Arc de Triomphe de Paris en l’honneur de Bonaparte ? Il évoque la civilisation et sa violence. Il évoque le triomphe souillé de sang (le T-Shirt est rouge-sang). Et il évoque ironiquement la défaite d’Alex face à cette même civilisation, une civilisation trop quadrillée, blasée.
Ce triomphe n’est pas une victoire, tout comme la 5ème Symphonie n’est pas synonyme de victoire, mais conçue par Beethoven comme les coups du destin frappés à la porte. Eric (un des tueurs) tapera justement à la lucarne de la chambre d’Alex alors que celui-ci interprète Beethoven au piano. Le Minotaure est devenu chacun d’entre nous, à l’intérieur. La représentation a implosé, les codes aussi. ELEPHANT s’attarde sur ce qui passe trop vite, s’attarde là où l’attention devrait se porter et le film d’hurler sans qu’un son ne sorte vraiment : Qu’est-ce que la civilisation ? Où réside son triomphe ? Comment regarder et aimer à nouveau ? Réécouter Elise peut-être…
Alexandre Tylski a participé au CDRom pédagogique national consacré au film ELEPHANT de Gus Van Sant.[/quote]
C'est un film assez déroutant avec d'interminables plans séquences (qui rappelleront ceux de l'Overlook Hotel dans "Shinning"... le film est truffé de références au cinéma de Kubrick) et des dialogues minimalistes. Mais c'est un film cinématographement intéressant dont on sort un peu vaseux...
J'ai trouvé une analyse assez originale du film sur le site cadrage.net A ne pas lire si on n'a pas vu le film et qu'on souhaite le voir
GUS VAN SANT ET LE MINOTAURE
par Alexandre Tylski
Le dernier film de Gus Van Sant a reçu la Palme d’Or et le Prix de la Mise en Scène à Cannes 2003 ainsi que le Prix Pédagogique de l’Education Nationale Française, ce qui ne plaira pas à tout le monde.* Voici notre analyse du film ELEPHANT.
ELEPHANT de Gus Van Sant n’est pas un film qui " dénonce " (par ailleurs limite de cinéaste du pourtant passionnant Michael Moore – même s’il en questionne sans cesse les rouages et dangers). Le terme " dénoncer " est employé à tort et à travers par les médias. Ceux-là voient fréquemment dans l’action d’une association sociale, un livre fort ou un film engagé, la " dénonciation " d’un problème ou la " dénonciation " d’un certain système. Un bon film ne dénonce pas, il ne s’abaisse pas à cela, heureusement, il " énonce " comme on le verra. La dénonciation est revenue à la mode en France par certaines lois remises au goût du jour, espérons que ce mot de sinistre mémoire soit de moins en moins employé à propos des films et des cinéastes.
ELEPHANT de Gus Van Sant n’est pas non plus un film qui " sensibilise. " Ici nul pathos, ni démagogie entendue, ni voix off explicative ou étalage de chiffres. Le film de Gus Van Sant est un film avant tout sensible mais précisément pas " sensibilisant ". Le cinéaste évite soigneusement l’écueil du film militant (il a d’ailleurs toujours refusé d’en faire) – le genre militant dénonçant et sensibilisant trop souvent à coups de marteau. Le verbe " sensibiliser " sonne à nos oreilles comme " annihiler ", " aliéner ", " étouffer ", " diriger ". Quel spectacle que celui qui cherche à tout prix à sensibiliser en tirant sur la corde sensible. Godard rappelle ainsi à juste raison qu’un film n’a pas à séduire, ni à chercher à faire " adhérer " (à fédérer), mais plutôt à " convaincre " éventuellement. Non par la rhétorique du politique, mais par la dialectique.
Plan de l’analyse de film de ELEPHANT de Gus Van Sant :
1. ELEPHANT : un film animalier
Le titre du film/Le lycée comme un zoo/L’ange taureau/Les trois petits cochons
2. ELEPHANT : la bulle sonore
Les fantômes errants/Ecouter le photographe/Alex et Beethoven/La jungle
3. ELEPHANT : le crâne, la prison & la spirale
La cité de verre/Trajectoires/Tourner en rond
4. ELEPHANT : le plan séquence & la disparition
Filmer de dos/Tout doit disparaître
5. ELEPHANT : Le regard tourné vers le ciel
Ouverture et final en Ciel/Quatre regards vers le haut
6. ELEPHANT : le triomphe de la civilisation
Evocation de la guerre/Quel triomphe ?
________________________
ELEPHANT : un film animalier
Le titre du film
Le titre du film ELEPHANT est au départ une référence consciente au téléfilm du même nom réalisé par le cinéaste (depuis disparu) Alan Clark sur la violence en Irlande du Nord (un titre évoquant aussi l’impossibilité pour un aveugle à se représenter la forme d’un éléphant). Le titre ELEPHANT est aussi une référence à la mascotte des Républicains aux USA: l’éléphant. Gus Van Sant avoue : " On s’est amusé avec la dimension politique que peut représenter le titre, et donc sa charge satirique envers, bien sûr, l’aspect aliénant du système d’éducation américain. (…) Elephant, c’est ce qui se voit comme le nez au milieu de la figure, mais ce que tout le monde souhaiterait bien occulter. " (1)
Mais nous pouvons aussi décrypter le titre " ELEPHANT " en tant que symbole culturel, voire parfois cultuel. Ainsi, il ne s’agirait pas d’oublier que l’éléphant est la monture du Dieu de la Foudre Indra (on entendra dans le film la foudre gronder avant le massacre). C’est aussi un animal aux grandes oreilles (Alex, le tueur, souffre de surdité lors de la scène de la cantine et toute la bande sonore du film se décompose de résonances et de réverbérations très sensibles). C’est aussi " l’éléphant spirituel et sacré " (le Christ) qui relève Adam après sa chute. L’éléphant est cet animal que l’on dit sage, sans agressivité et solidement ancré au sol ; dans les rêves il représente une réalité terrestre avec laquelle certaines personnes n’arrivent pas toujours à garder le contact.
Bref, autant d’éléments en rapport direct avec le récit et l’esthétique de ELEPHANT de Gus Vant Sant. Un titre pour le moins emblématique des figures animales qui traversent son film : un sweat-shirt représentant une tête de tigre, un T-Shirt jaune représentant un taureau noir, un chien sautillant au ralenti, un éléphant représenté en croquis sur le mur de la chambre des tueurs, le son d’oiseaux pendant la tuerie dans les couloirs du lycée et la scène finale dans la chambre froide remplie de viande animale. Il fallait donc prendre ELEPHANT dans son sens premier : un film animalier. Nous ne sommes pas dans une ménagerie gitane à la Kusturica, mais dans une impossible Arche de Noé déguisée en lycée. Un parc animalier aux accents apocalyptiques. Un retour au monde sauvage.
Le lycée comme un zoo
LE TIGRE. Michelle est une jeune fille timide et rondelette, et visiblement complexée dans les vestiaires. Elle ne semble pas assumer sa féminité. Elle fait figure de garçon manqué. Gus Van Sant nous la présente pour la première fois portant un sweat-shirt sportif arboré d’un tigre (l’emblème même du lycée mais que seule, elle, porte). On sait que le tigre a pour particularité dans les rêves et les mythes d’être un félin gracieux et puissant : tour à tour féminin (longs cils autour des yeux) et masculin (grondement grave). C’est aussi la bête noire rampante (Michelle rase les murs) des premiers hommes, autre retour aux peurs primaires et barbares. Gus Van Sant nous indique la nature foncièrement hybride de Michelle. Mais la nature tout aussi hybride et sauvage des autres personnages.
LE TAUREAU. John est un blondinet habillé de jaune. Cet ange blond marque l’esthétique du film (une sorte de cousin de Tazzio ?) et la mémoire des personnes ayant vu le film (les images illustrant par exemple les critiques de film parues sur ce film mettent presque toujours en valeur ce blondinet). Lui aussi fait figure d’hybride. Car en effet, son T-shirt si particulier y fait représenter un taureau noir sur fond jaune (2) et l’on connaît l’attachement de Van Sant pour les costumes, notamment dans Prête à Tout (1995) avec Nicole Kidman. Le contraste est fort (phrase reprise d’ailleurs dans le film) et nourrira l’esthétique entière du film. Taureau rappelant les peintures pariétales et à la fois symbolique de vie et de mort, on ne voit littéralement que cela lorsque Gus Van Sant filme John déambulant dans les labyrinthes du lycée.
John, l’ange taureau
John est ainsi une sorte d’ange taureau (dont l’écho se fera à la fin avec Benny, son double, jeune noir au T-shirt jaune). Une créature hybride, voire androgyne, que nous soupçonnons un moment d’être le tueur (Gus Van Sant insiste sur lui dans le premier mouvement du film comme s’il s’agissait de son héros principal). Les apparences sont trompeuses (il sera d’ailleurs question d’apparence dans un débat lycéen du film) : le simulacre de l’image est ici au cœur.
Ce jeune homme taureau serpentant dans les labyrinthes rappelle alors inévitablement le mythe même du Minotaure. L’origine de la représentation. Retour aux sources des légendes initiatiques (et de l’art pariétal). Questionnement alors de Gus Van Sant sur " Comment évoluent les mythes et les contes aujourd’hui ? " mais aussi " Qu’est-ce qu’une image ? " et " Comment la jeunesse vit-elle avec les images ? " Comment sont-ils piégés par elles comme dans un labyrinthe de signes ? – pas étonnant de voir ainsi plusieurs scènes se dérouler dans la chambre noire du lycée, Gus Van Sant scrute précisément la création photographique et l’imago.
Les 7 jeunes filles et jeunes garçons offerts au Minotaure sont représentés dans le film par les cartons (retour au cinéma muet) indiquant les noms de ces jeunes (muets ?) – liste létale d’une morte annoncée, ils sont comme jetés aux lions. Les cartons sont autant de plaques mortuaires, de tombeaux ouverts. Gus Van Sant détourne le mythe du Minotaure et questionne une époque, ou plutôt : la représentation d’une époque. Dans le monde décrit dans ELEPHANT, les enfants ne sont plus uniquement les chassés, il sont aussi les bourreaux.
Les Trois Petits Cochons
La présence du conte et de l’animal se poursuit et s’achève jusque dans la dernière scène, tournée dans la chambre froide des cuisines du lycée. Et sur une contine détournée en air de croquemitaine. Alex a passé plusieurs portes pour trouver deux amoureux dans une chambre froide. Comme dans Les Trois Petits Cochons (et SHINING de Kubrick, 1980), il traverse les portes. Alex pointe son arme sur le couple amoureux et récite: " Amstramgram, pic et pic et colegram, bourre et bourre… Si tu prends un tigre par la patte… et qu’il bouge… laisse-le filer… " Des morceaux d’animaux froids pendent au fond alors que les jeunes amoureux sont laissés hors champ, déjà " disparus. " Les corps en mouvement constant du début du film se gèlent. Le zoo est mort.
ELEPHANT : la bulle sonore
Les fantômes errants
A la fin du film, juste après la scène finale de la chambre froide, c’est un ciel qui nous est montré avec, en fond sonore, des grues fantomatiques (nous ne ferons que les entendre). Gus Van Sant termine le film avec ces volatiles errants fuyant le massacre sur la terre. Il nous invite à rêver, à sortir du labyrinthe de la mort. Labyrinthe qu’il aura pris soin de " sonoriser ". Gus Van Sant raconte : " On a travaillé pendant tout le film avec un MS stéréo, un appareil équipé de deux micros, l'un tourné vers le haut, l'autre vers le bas, qui donne une sorte de son en 3D. Pour ce qui est de l'atmosphère sonore générale, tous les comédiens étaient équipés d'un micro." (3)
Les effets de réverbérations indiquent une présence omnipotente, céleste, confinant au religieux (nous pensons ainsi à la scène réverbérée où le blondinet pleure et semble en prière). Les échos démultiplient, décomposent, encore l’espace et le vide glacial. Mais personne ne semble répondre aux échos, personne ne semble vivre ici. Et, si nous tendons l’oreille, aucun pas ne se fait même entendre. Tout le film consiste ainsi à filmer de jeunes lycéens marcher dans des couloirs et aucun bruit de pas pourtant, ne s’entend. Tous sont là, fantomatiques, déjà morts. Idée forte de " mise en son " d’un vide béant prêt à avaler tout le monde, à l’image des perspectives vertigineuses.
Ecouter le photographe
ELEPHANT décrit ainsi un monde du silence où il n’y a pas exactement de silence mais une infinité de micro-bruits et dans lequel chacun crée son monde. Elias, le jeune photographe, Gus Van Sant le décrit d’un point de vue sonore. Lorsque Elias est dans la chambre noire, il place sa pellicule dans une spirale elle-même enfermée dans une boîte révélateur. Il agite consciencieusement sa boîte et Gus Van Sant en gros plan visuel et sonore scrute ce moment. Le bruit de la boîte est semblable à une horloge ou à une bombe. Et ce son de libérer " d’un coup " l’imagination. La révélation des images en cours auront peut-être l’effet elles aussi d’une bombe. Un son évoquant le terrorisme ou la guerre mais aussi cette arme meurtrière qu’est l’image… et son développement.
Cette scène de boîte est aussi symptomatique de ce photographe, Elias, qui, lorsqu’il traverse le couloir, est accompagné, en off, d’une musique flottante qui semble tout droit sortir de sa boîte crânienne ou de son état d’esprit. Les sons de couloirs et des lycéens présents disparaissent. Il vit dans son monde et déambule ainsi au gré des notes. Au moment où Elias salut une amie, le son réel revient un instant, la musique s’adoucit, puis, aussitôt, Elias reprend son chemin et son monde intérieur et sonore revient à nous. Dans ELEPHANT, l’un ne vas pas sans l’autre : pas d’image sans musique. Pas d’image sans monde intérieur complexe.
Alex et Beethoven
Le cinéaste révèle aussi le monde sonore intérieur d’Alex, le jeune tueur. Nous savons que les vrais tueurs de Columbine écoutaient beaucoup de musique, en particulier Marilyn Manson (interviewé dans BOWLING FOR COLUMBINE), qui lui vaut encore de vives attaques. Gus Van Sant détourne alors les faits et prend le contre-pied en filmant le tueur jouer du Beethoven. (4) L’ironie est d’autant plus intéressante qu’Alex (l’acteur s’appelle aussi Alex) se trouve être aussi le prénom du jeune tueur dans ORANGE MECANIQUE (1971), un film que Gus Van Sant vénère pour son traitement de la violence dans la société et dont il s’est ouvertement inspiré pour ce film.
" La Lettre à Elise " de Beethoven est utilisé mais également la Sonate op. 27 n. 2 (appelé Clair de Lune par le poète Rellstab) qui fut dédiée à Giuletta Guicciardi et dont Beethoven était amoureux. Une déclaration d’amour s’est ainsi glissée au cœur de ce film a priori froid. Rappelons ici que la partition de Le Clair de Lune doit se jouer " senza sordini " (c’est à dire avec pédale) et mène ainsi à la fusion constante des basses, à la " fluidité d’une coulée sonore continue… " (5) Le choix de Gus Van Sant pour ce morceau s’entremêle parfaitement avec la coulée visuelle du film, l’état de flottement y est saisissant, le film comme un liquide amniotique. Un monde en gestation, mais un mode déjà mort pourtant.
Néanmoins, la force est de remarquer que le protagoniste du jeune " tueur pianiste " (l’association est plus qu’hybride), Alex n’est pas nécessairement lié à ce liquide amniotique. S’il joue en effet Beethoven, il " massacre " quelque peu les morceaux du maître (avec saturation sonore) et alors qu’il interprète Beethoven dans sa chambre, Alex " dérape " sur le piano et Gus Van Sant alors de couper le grand mouvement circulaire dans la chambre. Il coupe et revient sur un plan d’Alex. La coupure est infime mais bien là. Alex est dans une coquille ronde percée (comme sa voiture a un pare-brise brisé). Une fissure est en lui et est évoque par le montage (Gus Van Sant est ici aussi le monteur du film). Cette cassure du montage avec Alex sera également présente dans la scène de la cantine où Gus Van Sant coupe, à nouveau, sur Alex alors que nous étions dans un long plan séquence. Alex est en rupture avec l’étouffant ballet imposé par les lignes rectiligne de ce lycée.
La jungle
Alors qu’Alex tire sur les élèves du lycée dans les couloirs, Gus Van Sant perce (métaphoriquement) le plafond du lycée en utilisant un hors champ sonore pour le moins étonnant : nous entendons de l’eau, du vent et des oiseaux. La panique se fait sentir par les corps en off dont on aperçoit furtivement quelques parties (le cadrage ici découpe les corps en choisissant de ne reste que sur le tueur et de ne révéler des autres corps que quelques extrémités passant furtivement dans l’image). C’est la loi de la jungle. Mais une presque reposante en contre-pied avec l’action. Une scène qui détonne avec celle de la cantine dans laquelle Alex semblait ne pas supporter le brouhaha général de cris d’adolescent (presque semblables aux oiseaux d’Hitchcock).
Alors qu’il est retourné au stade animal, Alex dira presque à moi-voix (se parlant à lui-même): " Je n'ai jamais vu de jour si immonde et si beau " Une phrase shakespearienne (tirée de Macbeth par ailleurs) qu’affectionne Gus Van Sant (on se rappelle les emprunts de vers shakespearien dans MY OWN PRIVATE IDAHO). Un gramme de poésie dans le massacre. Gus Van Sant nous rappelle que la monstruosité n’est pas nécessairement à opposer à la sensibilité ou la culture. Nature et culture pas toujours distincts. " L’art n’est pas le contraire de la barbarie. La raison n’est pas la contradictoire de la violence. " (6) C’est une des formules paradoxales et secrètes, hybrides, de ELEPHANT.
ELEPHANT : le crâne, l’orthonormé et la spirale
La cité de verre
ELEPHANT est un film crâne où l’on entend la jungle dans la tête d’un adolescent et que nous voyons à l’écran, un aquarium géant multicolore. Dans le film de Gus Van Sant donc, chacun est enfermé dans sa boîte, son bocal, sa bulle et le lycée lui-même d’apparaître comme une véritable cité de verre décomposée en cavités internes. Le rapport du corps au décor dans ELEPHANT est ainsi fondamental. ELEPHANT a été " photographié en 35mm, au format 1 : 33, qui évoque souvent les documentaires de Frederick Wiseman (Domestic Violence et High School) et les photographies de William Eggleston, qui, comme lui, ne dissocient jamais les êtres des décors où ils évoluent, des situations qui les façonnent. " (7).
Gus Van Sant a tourné dans un lycée qui venait de fermer, tournant ainsi aisément 5 semaines avec de vrais lycéens de Portland (ville où habite par ailleurs le cinéaste). Le cinéaste a fait de ce lycée un lieu nourri de chambres noires, de chambres froides, et dans lequel les couloirs semblent ne jamais finir. Une grotte post-historique. Beaucoup de vitrines de verre longent les couloirs eux-même souvent faits de murs de verre. Bref, un aquarium audiovisuel - lié au champ lexical animalier. Un monde animal domestiqué (nous verrons plus tard la question de l’architecture orthonormé).
Mais le monde extérieur (mis entre parenthèses du film) ressemble lui aussi à une bulle : quand ils ne sont pas au lycée, nous voyons ces jeunes évoluer dans leur chambre (Alex et Eric), une chambre fermée comme un bocal (lucarne en verre au-dessus du piano où apparaîtra en spectre Eric une cagoule noire sur la tête), leur cuisine étouffante (on ne voit même pas le visage des parents comme dans un Tex Avery), leur salon (avec le bocal téléviseur et au fond une vitre donnant vers le livreur), ou leur voiture (scène introductive entre John et son père).
Trajectoires
Quelques rares moments fugitifs nous sortent du bocal : en particulier ce ciel mystérieux qui finit par devenir nettement menaçant et annonçant la mort. La nature aussi préfigure une sorte de mort et de déclin : c’est l’automne. Mais tout ce monde là supposé être libérateur et reposant est marqué par la cassure (voiture heurtant le rétroviseur d’une autre voiture dès le commencement du film). Le père de John est perdu, brisé, et les routes, elles aussi sont orthonormé, quadrillées, comme dans une caserne.
" Trajets, parcours, topologie, quadrillage, lignes de fuite, lignes de désirs… Espace complexe donc, multitude de points de fuit singuliers, la perspective tourne. Rien d’irrémédiable. Cheminements. On ne choisit pas sa mort ? (…) Troupeau d’éléphants en marche, sans lieu précis, en errance. Chacun son allure, sa vitesse donc. Son désir… (…) Dehors, l’ange d’ELEPHANT fait sortir les corps encore en vie, aide le père à sortir de son absence, sans pathos, dans le silence des grandes catastrophes… Le ciel est vide, inquiet et beau. Une Saison en enfer ". (8)
Le film se lance sur une route, se poursuit avec un plan séquence suivant un jeune sportif dont le sweat-shirt rouge laisse apparaître, au dos donc, une croix blanche où il est noté " Lifeguard " (mot ironique quand nous connaissons le destin de ce protagoniste). Mais toute la visée est cette croix, semblable à une cible toute désignée dans la chasse à venir. Chercher l’erreur, chercher le centre, le cœur ou, comme le dira un des professeurs (un des rares adultes du film) : " le noyau de l'atome ".
Ces signes sont autant de codes de la route pour le voyage du film. Film de codes, de routes et de carrefours. Un monde de codes, carcéral. Un des acteurs (non-professionnels) du film dira à la presse : Il y a une pression terrible sur les élèves, déplore John, afin qu'ils aient les meilleurs résultats possibles en vue d'entrer à l'université." Sans oublier la discrimination sociale que "les élèves reproduisent au lycée le plus naturellement du monde, sans même s'en rendre compte, ajoute Alex. Gus filme le lycée comme s'il était une prison. Moi, je ressens ça en permanence. " (9)
Dans la chambre des tueurs, de la brique et des dessins au mur comme dans une cellule. Le champ est bouché. Mais la profondeur de champ des longs couloirs étouffent autant, avalent en spirale et les trajectoires des élèves à moitié éveillés fait figure de danse macabre comme à l’époque des grandes épidémies. Au Moyen-Age, cette danse était évoquée ainsi : " media vita in morte sumus " (au milieu de la vie nous sommes déjà dans la mort). Elèves fantômes, morts-vivants, le flottement est celui d’une déambulation morbide et sans quête.
Tourner en rond : figure de la spirale
Dans cette esthétique rectiligne, Gus Van Sant apporte néanmoins une sorte de contrepoint : les panoramiques. Un panoramique circulaire est utilisé dans la scène du groupe de discussion, mais leur propos étant vite convenu et sans profondeur, la caméra " tourne en rond " à l’image peut-être des protagonistes décrits à l’écran. De la même manière ce mouvement circulaire étouffant, en spirale, avalera les deux tueurs, Eric et Alex dans leur chambre. L’Eternel retour. La musique reviendra aussi, la nature reviendra aussi comme un retour barbare. Un mouvement de caméra de surveillance finira par dépeindre les deux tueurs endormis (morts ?) : la caméra pivote en panoramique comme une caméra de surveillance dans une vision panoptique digne des cellules d’observation.
4. ELEPHANT : le plan séquence et la disparition
Filmer de dos
Gus Van Sant filme ce monde carcéral de dos. Ce dispositif cinématographique, en méta-discours, mène à la réflexion. Pourquoi filmer si souvent les personnages de dos ? On aura parlé de référence aux images de jeux vidéo, mais cet inversement, ce questionnement hybride, de l’endroit et de l’envers mêlés, du positif et du négatif (qui chasse ? qui est chassé ? que se trame-t-il donc derrière les crânes ?), va plus loin. Ces images de dos font aussi référence à la peinture, par exemple à Giandomenico Tiepolo et son "Nouveau Monde".
Gus Van Sant, dans tous ses films, ramène toujours ses personnages à l’origine (leur foyer natal dans Drustore Cowboy (1990) ou My own private Idaho (1992), leur enfance dans Will Hunting (1997), etc.). Et cela est d’autant plus vrai ici que sa manière de filmer évoque un retour aux premiers portraits peints, égyptiens, qui ne peignaient jamais personne de face (même si ELEPHANT se permet de filmer aussi de face) s’accordant avec le souci des Egyptiens d’une continuité parfaite de la vie après la mort.
Or, Gus Van Sant fait revenir sa caméra à un endroit stratégique du lycée (où passeront tous ses personnages et où se déroule la pause photo du blondinet): un couloir. Un couloir dont un des murs est peint d’une fresque aux couleurs primaires (couleurs que portent les élèves pendant tout le film). Des élèves y sont peints (mortifiés) et on y voit une jeune fille représentée, de profil, les mains placées comme les Egyptiens. Ce clin d’œil de Gus Van Sant n’est pas le fruit du hasard, il désigne le portrait peint égyptien (origine du portrait) qui fut d’abord funéraire puis identitaire – les questions mêmes soulevées dans ELEPHANT.
Tout doit disparaître
Gus Van Sant avoua s’être fortement inspirer des films de Bela Tarr pour ELEPHANT. A la question que Libération en 1987 avait posée au cinéaste : " Pourquoi filmez-vous ? " Bela Tarr répondit : " Parce que je déteste les histoires, puisque les histoires font croire qu'il s'est passé quelque chose. Or il ne se passe rien : on fuit une situation pour une autre. De nos jours, il n'y a que des situations, toutes les histoires sont dépassées, elles sont devenues lieux communs, elles sont dissoutes en elles-mêmes. Il ne reste que le temps. La seule chose qui soit réelle, c'est probablement le temps. "
Les plans séquences dans ELEPHANT mesurent le temps qu’il reste (les ralentis du film mettant en valeur ce temps éphémère), ils sont funéraires. Inévitablement, les longues images de ELEPHANT se terminent toujours de la même manière (dont la systématique renforce l’horreur secrète): par la sortie d’un des personnages par une porte. Et lorsque celui-ci, ou celle-ci, ne disparaît pas par une porte, il ou elle disparaît invariablement du champ de l’image ne laissant plus qu’un grand flou sinistre.
Ainsi (par exemple):
- au début sur le terrain de sport: Michelle entre et disparaît du cadre (elle ne fera que passer comme un fantôme) puis, Nathan (sportif) entre à son tour dans l’image, part du terrain, traverse la pelouse et disparaît derrière la porte du lycée au fond.
- on suit Michelle (qui est réprimandée en off de ne pas porter de short) puis elle disparaît elle aussi par une porte dérobée (à l’image d’un drame shakespearien au théâtre).
- on accompagne Elias (photographe) dans les couloirs du lycée jusque dans la chambre noire où la porte se referme devant nous jusqu’au noir complet (difficile d’être plus clair!).
- on entre dans les vestiaires des filles, Michelle se déshabille pudiquement (on entend des ricanements en off), puis elle disparaît du champ laissant un vide flou.
Cette disparition finale au sein de chaque image (chacune représentant en soi un mini-film et une autre cavité interne au film) est un des secrets du film. Chaque plan séquence est comme la longue mise à mort du personnage, annonçant son destin et sa disparition du temps et de ce monde. Tout le film est ainsi cette danse collective macabre où chacun(e) va à sa perte. La fin de l’image : c’est ici paradoxalement la fin des personnages… et non nécessairement la cause de leur mort !
ELEPHANT : Le regard tourné vers le ciel
Ouverture et final en Ciel
La mort est déjà au commencement de ELEPHANT. C’est un épouvantail qui ouvre ELEPHANT : un pilonne électrique et téléphonique perdu, seul, sur fond de ciel mouvant. Un pilonne, une croix ou épouvantail : en tout cas, il ne bouge pas et effraie autant qu’il fascine. Le ciel au fond remue, change de couleurs, s’assombrit et est parcouru de traces d’avions voyageurs et de voix de jeunes en off. Cette cadavérique mascotte de la communication et du progrès semble, elle, bien paumée, immobilisée, morte et comme brûlée. Un spectre shakespearien au commencement du récit, abandonné dans une vision céleste. La tragédie est en route ou : déjà là.
Ce fragment-mère est aussi la toute première contre-plongée du film. Il y en aura d’autres. Ce regard tourné vers le ciel reviendra en effet à différents moments du film: au centre du film : un ciel s’assombrit, un épais nuage noir s’épaissit comme l’avancée d’un cancer irrémédiable, d’une gangrène lente et menaçante. Cette image à dimension biblique précède le massacre. Il est le poumon ou le cœur malade du film en un sens. Il est l’image ineffable d’une violence trop longtemps contenue et frustrée qui finit par se libérer. Ce ciel est un espace de liberté travesti en menace étouffante.
Le générique de fin représentera aussi un ciel. Mais à l’inverse de la première image : le pilonne électrique a disparu, reste le ciel. Disparition aussi des voix de jeunes, il ne reste que quelques bruits et croassements de jungle. Des volées de grues se font entendre. Les animaux ont gagné, l’épouvantail a perdu. L’humanité semble avoir complètement disparu. Mais le ciel sera aussi convoqué par les regards de ces élèves.
Quatre regards vers le ciel
- au tout début : une jeune fille un peu gauche, Michelle, s’arrête de marcher pour regarder vers le ciel. Elle semble entendre l’air musical que nous entendons nous aussi dans la salle, " Clair de Lune " de Beethoven, et y trouve réconfort. Le temps ralenti.
- plus tard : John (le blondinet) se recueille un moment dans une pièce du lycée, regarde vers le haut en prière. L’ange blond semble en appeler à Dieu.
- un peu plus tard encore : Alex (le tueur) prend des notes dans la cantine et inspecte partout vers le plafond pour peut-être repérer des caméras de surveillance. Caméras que nous ne verrons jamais, laissées hors champ – mais dont certains spectateurs soupçonnent alors l’existence en mémoire des images de caméras de surveillance lors du massacre au lycée de Columbine.
- Enfin : le jeune photographe, Elias, lève les yeux et ausculte ses négatifs. Il découvre ses images à la lumière. Que révèleront-elles ? On le saura jamais.
Quatre regards vers le ciel, quatre visages différents, quatre sentiments distincts. Mais l’appel de l’au-delà est bien là. Déjà. Pesant. Présent. Ils rappellent aussi les regards tournés vers le ciel des personnages de Gus Van Sant tout le long de sa carrière : Mat Dillon à la fin de Drugstore Cowboy (1990) River Phoenix dans My Own Private Idaho (1991) ou encore Matt Damon dans Will Hunting (1997). Trois regards, trois attentes, trois hors champs, trois " ailleurs " à venir que la caméra ne peut pas filmer, ne veut pas filmer, mais tente de regarder et de traverser à travers les visages.
C’est au fond un rapport solaire, parfois lunaire, avec la nature (on se rappelle l’injustement décrié Even Cowgirls get the Blues (1993) et ses images de Lune). Gus Van Sant, même dans ses films urbains, y insère toujours le couple nature/culture et ramène ses protagonistes d’où ils viennent, les confrontant à leurs racines et leurs pulsions primitives, mais aussi à leur peurs et désirs. ELEPHANT est, après GERRY en 2002 (film tourné entièrement dans la nature), une continuation logique dans la carrière de Gus Van Sant : on n’échappe pas à son origine, la nature revient toujours au galop. Alors : comment vivre avec ?
ELEPHANT : qu’est-ce que la civilisation ?
Evocation de la guerre
Entre 1997 et 1999, 8 cas de massacre en lycée aux USA. Le jeune Alex de ELEPHANT aurait-il pu dire : " Je ne doutais plus que la civilisation comme on la nomme, ne fût une barbarie savante et je résolus de devenir un sauvage. " ? (10) La conversation entre un père et son fils se résume dans ELEPHANT à évoquer la guerre (conversation dans la voiture au tout début du film). Le film fait un état des lieux d’un pays, les USA, en guerre civile. La fumée sorti du lycée, la panique des élèves, la jungle sonore, c’est la guerre qui recommence. Les républicains et leur mascotte éléphantesque y sont-ils pour quelque chose ? Peut-être pas, mais Gus Van Sant ne filme pas ce monde sans y parler fort à travers multitudes de détails. Nous ne croyons pas à l’objectivité du film comme certains l’ont prétendu ; " Elephant s’impose à nous par son audacieux souci de montrer le plus objectivement possible le comportement de ces jeunes gens soudain frappés de folie meurtrière… " (11) La bombe à spirale qu’agite Elias, le jeune photographe, dans sa chambre noire, ne serait-elle pas en réalité un cœur qui bat ?
Quel triomphe ?
Encore moins de regard objectif lorsqu’on remarque le T-shirt rouge d’Alex où est marqué : " Triomphe " ! Exprime-t-il le film nazi " Le Triomphe de la volonté " de Leni Riefenstahl (1937) ? ou encore l’Arc de Triomphe Antique ou l’Arc de Triomphe de Paris en l’honneur de Bonaparte ? Il évoque la civilisation et sa violence. Il évoque le triomphe souillé de sang (le T-Shirt est rouge-sang). Et il évoque ironiquement la défaite d’Alex face à cette même civilisation, une civilisation trop quadrillée, blasée.
Ce triomphe n’est pas une victoire, tout comme la 5ème Symphonie n’est pas synonyme de victoire, mais conçue par Beethoven comme les coups du destin frappés à la porte. Eric (un des tueurs) tapera justement à la lucarne de la chambre d’Alex alors que celui-ci interprète Beethoven au piano. Le Minotaure est devenu chacun d’entre nous, à l’intérieur. La représentation a implosé, les codes aussi. ELEPHANT s’attarde sur ce qui passe trop vite, s’attarde là où l’attention devrait se porter et le film d’hurler sans qu’un son ne sorte vraiment : Qu’est-ce que la civilisation ? Où réside son triomphe ? Comment regarder et aimer à nouveau ? Réécouter Elise peut-être…
Alexandre Tylski a participé au CDRom pédagogique national consacré au film ELEPHANT de Gus Van Sant.[/quote]
"La citoyenneté réduite au droit du sang consiste à dire que la République est génétique et non pas spirituelle", Waddle, 2013.
Mon blog
Mon blog
-

Waddle - Enculeur de moucheS
- Messages: 24109
- Inscription: 10 Mai 2003, 18:05
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
Tu nous fais quoi, Wad' ?
Ouais_supère a écrit:Stef, t'es chiant
- Stéphane
- Le.
- Messages: 50710
- Inscription: 16 Déc 2004, 23:19
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von

Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
Stéphane a écrit:Tu nous fais quoi, Wad' ?
Bah rien. Des bêtises, vu que c'est un topic de bêtises.
"La citoyenneté réduite au droit du sang consiste à dire que la République est génétique et non pas spirituelle", Waddle, 2013.
Mon blog
Mon blog
-

Waddle - Enculeur de moucheS
- Messages: 24109
- Inscription: 10 Mai 2003, 18:05
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
Stéphane a écrit:Tu nous fais quoi, Wad' ?

Il se tape un délire.
Le fascisme au fait, c'était pas déjà l'histoire d'un mec en marche qui fascinait les foules avec son culte de la personnalité ?
-

von Rauffenstein - ultima ratio regum
- Messages: 46968
- Inscription: 20 Fév 2003, 18:01
- Localisation: Auteuil
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
von Rauffenstein a écrit:

Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
silverwitch a écrit:von Rauffenstein a écrit:

Le fascisme au fait, c'était pas déjà l'histoire d'un mec en marche qui fascinait les foules avec son culte de la personnalité ?
-

von Rauffenstein - ultima ratio regum
- Messages: 46968
- Inscription: 20 Fév 2003, 18:01
- Localisation: Auteuil
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von

Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von

Le fascisme au fait, c'était pas déjà l'histoire d'un mec en marche qui fascinait les foules avec son culte de la personnalité ?
-

von Rauffenstein - ultima ratio regum
- Messages: 46968
- Inscription: 20 Fév 2003, 18:01
- Localisation: Auteuil
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von

Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
von Rauffenstein a écrit:
(arrête de polluer ce topic waddie !)
Ca me fait trop marrer ces trucs !
"c'est quoi le blues". Toujours les mêmes histoires, celles qui font vaciller les mondes et les empires.
John Lee Hooker
John Lee Hooker
- Shoemaker
- Messages: 22441
- Inscription: 24 Nov 2003, 12:11
- Localisation: Out of Africa
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
silverwitch a écrit:
Yes, indeed.
The amount of energy necessary to refute bullshit is an order of magnitude bigger than to produce it.
-

Sylex - Messages: 2544
- Inscription: 20 Avr 2012, 14:29
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
Sylex a écrit:Yes, indeed.

Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
On peut critiquer MArlaga comme on veut, mais faut lui reconnaître un truc : Il a transformé le forum en vaisseau spatial livré à lui-même, fonçant vers nulle part à la vitesse de la lumière. EN SOI, c'est ... presque une œuvre d'art ! 

"c'est quoi le blues". Toujours les mêmes histoires, celles qui font vaciller les mondes et les empires.
John Lee Hooker
John Lee Hooker
- Shoemaker
- Messages: 22441
- Inscription: 24 Nov 2003, 12:11
- Localisation: Out of Africa
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
Shoemaker a écrit:On peut critiquer MArlaga comme on veut, mais faut lui reconnaître un truc : Il a transformé le forum en vaisseau spatial livré à lui-même, fonçant vers nulle part à la vitesse de la lumière. EN SOI, c'est ... presque une œuvre d'art !
Jefferson Starhip !
Le fascisme au fait, c'était pas déjà l'histoire d'un mec en marche qui fascinait les foules avec son culte de la personnalité ?
-

von Rauffenstein - ultima ratio regum
- Messages: 46968
- Inscription: 20 Fév 2003, 18:01
- Localisation: Auteuil
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
silverwitch a écrit:
Faut que je lui réponde quand même.
(trois coups de piqueratte en terrasse au Mirabeau dans le pif et il est paf, le panzie. Pffff.)

(tiens, je vais me mater Paris, Texas ce soir)
Le fascisme au fait, c'était pas déjà l'histoire d'un mec en marche qui fascinait les foules avec son culte de la personnalité ?
-

von Rauffenstein - ultima ratio regum
- Messages: 46968
- Inscription: 20 Fév 2003, 18:01
- Localisation: Auteuil
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von

Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
Oh c'est trop kawaï ! 
Bon... Faut que j'aille à "Kaboul" (Loca Images, à Barbès) tout à l'heure racheter un cable XLR qu'on a perdu (on les perd... Et on n'en rachète qu'un à la fois. Quand on en prend deux, on perd les deux
Et on n'en rachète qu'un à la fois. Quand on en prend deux, on perd les deux  ) pour le micro canon.
) pour le micro canon.

Pourvu qu'ils en aient encore en 50cm et pas en rouleau de 5 mètres !
Bon... Faut que j'aille à "Kaboul" (Loca Images, à Barbès) tout à l'heure racheter un cable XLR qu'on a perdu (on les perd...

Pourvu qu'ils en aient encore en 50cm et pas en rouleau de 5 mètres !
Le fascisme au fait, c'était pas déjà l'histoire d'un mec en marche qui fascinait les foules avec son culte de la personnalité ?
-

von Rauffenstein - ultima ratio regum
- Messages: 46968
- Inscription: 20 Fév 2003, 18:01
- Localisation: Auteuil
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
von Rauffenstein a écrit:Oh c'est trop kawaï !
N'est-ce pas !
von Rauffenstein a écrit:Bon... Faut que j'aille à "Kaboul" (Loca Images, à Barbès) tout à l'heure racheter un cable XLR qu'on a perdu (on les perd...Et on n'en rachète qu'un à la fois. Quand on en prend deux, on perd les deux
) pour le micro canon.
Tu travailles avec quoi comme matériel ??
von Rauffenstein a écrit:
Pourvu qu'ils en aient encore en 50cm et pas en rouleau de 5 mètres !

Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
silverwitch a écrit:von Rauffenstein a écrit:Bon... Faut que j'aille à "Kaboul" (Loca Images, à Barbès) tout à l'heure racheter un cable XLR qu'on a perdu (on les perd...Et on n'en rachète qu'un à la fois. Quand on en prend deux, on perd les deux
) pour le micro canon.
Tu travailles avec quoi comme matériel ??
Là, avec deux Sony EX3. des micros HF seinnheser et un (oui, un) micro canon Audio Technica.
silverwitch a écrit:von Rauffenstein a écrit:
Pourvu qu'ils en aient encore en 50cm et pas en rouleau de 5 mètres !
Bon, uniquement sur commande chez Loca Images (pfff). Je vais essayer chez Conectic dans le 11e

Le fascisme au fait, c'était pas déjà l'histoire d'un mec en marche qui fascinait les foules avec son culte de la personnalité ?
-

von Rauffenstein - ultima ratio regum
- Messages: 46968
- Inscription: 20 Fév 2003, 18:01
- Localisation: Auteuil
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
von Rauffenstein a écrit:Là, avec deux Sony EX3. des micros HF seinnheser et un (oui, un) micro canon Audio Technica.
Elles enregistrent sur des cartes propriétaires Sony ?
von Rauffenstein a écrit:Bon, uniquement sur commande chez Loca Images (pfff). Je vais essayer chez Conectic dans le 11e
Il y a(vait?) une boutique spécialisée dans le 17è... Le nom m'échappe.
von Rauffenstein a écrit:




Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
Oui. des cartes SxSsilverwitch a écrit:von Rauffenstein a écrit:Là, avec deux Sony EX3. des micros HF seinnheser et un (oui, un) micro canon Audio Technica.
Elles enregistrent sur des cartes propriétaires Sony ?
von Rauffenstein a écrit:Bon, uniquement sur commande chez Loca Images (pfff). Je vais essayer chez Conectic dans le 11e
Il y a(vait?) une boutique spécialisée dans le 17è... Le nom m'échappe.
Bah, je vais me ballader dans le 11e. Pendant que le padawan monte
von Rauffenstein a écrit:

Le fascisme au fait, c'était pas déjà l'histoire d'un mec en marche qui fascinait les foules avec son culte de la personnalité ?
-

von Rauffenstein - ultima ratio regum
- Messages: 46968
- Inscription: 20 Fév 2003, 18:01
- Localisation: Auteuil
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
von Rauffenstein a écrit:Oui. des cartes SxS
Ok... Je ne connais pas, sinon de nom. C'est pas mal employé à la télévision.
Bah, je vais me ballader dans le 11e. Pendant que le padawan monte
Et comment il t'appelle, toi ?

Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
silverwitch a écrit:von Rauffenstein a écrit:Oui. des cartes SxS
Ok... Je ne connais pas, sinon de nom. C'est pas mal employé à la télévision.
C'est fiable en tout cas. On n'a crashé qu'une fois en trois ans. Et on va dans des endroits merdiques pourtant. Froid, chaleur, humidité, poussière, etc. C'est mon genou qui a crashé par contre.
Bah, je vais me ballader dans le 11e. Pendant que le padawan monte

Et comment il t'appelle, toi ?
Obi Wan. Pfff... Quelle question...


Le fascisme au fait, c'était pas déjà l'histoire d'un mec en marche qui fascinait les foules avec son culte de la personnalité ?
-

von Rauffenstein - ultima ratio regum
- Messages: 46968
- Inscription: 20 Fév 2003, 18:01
- Localisation: Auteuil
Re: Topic cinéma sans Silver et Hugues et Von
von Rauffenstein a écrit:C'est fiable en tout cas. On n'a crashé qu'une fois en trois ans. Et on va dans des endroits merdiques pourtant. Froid, chaleur, humidité, poussière, etc. C'est mon genou qui a crashé par contre.
Sony, ils savent faire ! Mais ça enregistre sur quel format et quel échantillonnage ? Enfin, toi tu ne t'occupes du montage, c'est ça ? Si j'ai bien compris, le montage ce n'est pas ton souci...
Obi Wan. Pfff... Quelle question...
Ah ! J'avais peur que ce ne soit un truc du genre, bwana !

Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

