Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer space
Modérateurs: Garion, Silverwitch
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
De toute façon tu mets des smileys approbateurs dès que quelqu'un me contredit.
Généralement c'est pour oublier que tu viens de te faire torcher le cul par Hugues.
Généralement c'est pour oublier que tu viens de te faire torcher le cul par Hugues.
- Ouais_supère
- Messages: 25821
- Inscription: 20 Juil 2005, 11:54
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
De ce que j'ai vu, Spielberg n'est PAS de ton côté.
Il condamne le 7 octobre... ET le massacre de Gaza, ET l'islamophobie.
Si tu as vu Munich tu sais que c'est pas ton pote, Spielberg.
Il condamne le 7 octobre... ET le massacre de Gaza, ET l'islamophobie.
Si tu as vu Munich tu sais que c'est pas ton pote, Spielberg.
- Ouais_supère
- Messages: 25821
- Inscription: 20 Juil 2005, 11:54
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
On a souvent réduit *Munich* à un “thriller politique” bien fabriqué. C’est passer à côté de sa proposition éthique : un cinéaste juif américain, pétri d’attachement à Israël, fabrique un film qui fragilise toute tentation de croire que la violence d’État — fût-elle dite “préventive” ou “rétributive” — puisse produire autre chose que l’érosion des consciences et la perpétuation du cycle des représailles. Spielberg n’a jamais défendu une équivalence morale plate entre terrorisme et contre-terrorisme ; il fait plus dérangeant pour un “faucon” : il humanise l’ennemi, dissout les certitudes opérationnelles dans le scrupule, et montre que l’assassinat ciblé, même réussi, est politiquement stérile et spirituellement corrosif. Lui-même, lors de la sortie, a refusé le procès en “moral equivalence” d’un revers de main très clair : comprendre n’est pas excuser, “comprendre ne veut pas dire pardonner” — et son film est “une prière pour la paix”, l’ennemi principal s’appelant “l’intransigeance”. Ces mots ne sont pas de la rhétorique promotionnelle ; ils posent une borne. On ne peut pas, d’un côté, affirmer que l’intransigeance est l’ennemi commun et, de l’autre, cautionner la dépossession d’un peuple, qui en est la forme politique la plus nue.
Le récit est connu : après Munich 1972, une équipe clandestine reçoit mandat d’éliminer, un à un, ceux que l’on tient pour responsables. Ce que le film fait à ce canevas, c’est l’exact opposé d’une fable d’efficacité souveraine. Chaque opération, au lieu de resserrer le monde, l’encrasse de risques et de dommages collatéraux, et, surtout, elle fissure l’âme des exécutants. Avner, mari et père, se défait à vue ; ses compagnons se replient sur des maximes morales vacillantes, puis meurent ; le “succès” tactique ne produit ni sécurité, ni paix, ni apaisement. La forme épouse ce programme : mise en scène de proximité, mécanique du suspense constamment sabotée par le scrupule, montage qui superpose l’intime au politique. La résolution du film n’est pas stratégique, elle est négative : la vengeance ne libère rien. A.O. Scott, Roger Ebert et d’autres contemporains l’avaient bien vu : *Munich* n’absout pas, il rend la vengeance illisible comme solution — ce qui, en retour, interdit l’idéologie de la domination durable.
Le cœur du film n’est pas dans l’action, mais dans les scènes de parole où Spielberg empêche la déshumanisation. La séquence dite de la “maison sûre” — Israéliens et Palestiniens cohabitant par erreur une nuit, Avner dialoguant avec un militant palestinien qui parle de sa terre — fait précisément ce que refusent les faucons : elle installe, au centre, la subjectivité de l’autre, son lexique du “chez soi”, son horizon de justice, sans jamais blanchir la violence. Ce n’est pas une indulgence, c’est une méthode : si la politique commence par l’inquiétude pour l’autre, la dépossession comme programme devient moralement impossible. On a souvent noté que Spielberg, ici, “empêche le spectateur de haïr confortablement”. C’est un choix d’écriture (Tony Kushner) et de mise en scène consonant avec les déclarations publiques du cinéaste : tout en condamnant fermement les massacres — ceux de Munich hier, ceux du 7 octobre aujourd’hui — il refuse la déshumanisation symétrique qui rend la paix impensable.
Que fait alors *Munich* au logiciel mental du “faucon” ? D’abord, il renvoie la supériorité morale autoproclamée à sa responsabilité : “ce que nous faisons à l’âme juive”, semblent dire les personnages, compte autant que l’efficacité supposée des opérations. Ensuite, il montre que l’État, si sûr de sa souveraineté clandestine, se prend au piège des intermédiaires, des mensonges, des erreurs d’identité — la puissance est une dépendance. Enfin, il élargit l’aire du dommage : famille, exil, paranoïa, perte de la maison, impossibilité du retour. À la fin, Avner n’a plus de “chez lui” — motif qui fait écho au motif palestinien de la maison perdue. Un faucon ne raconte pas cela ; il resserre la morale autour de la nécessité, pas autour du doute. Spielberg, lui, creuse le doute jusqu’à en faire le seul acquis durable de l’expérience.
Même la fameuse image terminale — la skyline new-yorkaise où l’on distingue les tours du World Trade Center — est un geste politique discret : inscrire la série des représailles dans une histoire plus vaste des violences, suggérer que la logique des “frappes justes” n’immunise personne et prépare d’autres catastrophes. Certains y ont vu une analogie trop directe ; Spielberg l’a niée, non pour effacer le sens, mais pour refuser la tentation d’une clé unique. L’effet demeure : *Munich* ferme sur un plan qui refuse le confort de la clôture nationale. C’est l’antonyme d’une imagerie de domination.
Reste l’objection : Spielberg n’est pas un pacifiste, il a soutenu Israël, il condamne sans ambiguïté les crimes du Hamas. Tout cela est vrai, et c’est précisément pourquoi *Munich* pèse si lourd. Quand le cinéaste réaffirme, en 2023-2024, son horreur devant les massacres du 7 octobre et, dans le même mouvement, son inquiétude devant les morts massives à Gaza et l’embrasement de la haine, il ne parle pas “au-dessus” de son œuvre, il en parle depuis son œuvre. Sa phrase la plus nette — l’intransigeance est l’ennemi et la paix l’horizon — interdit logiquement tout soutien à une politique de dépossession structurelle et de domination sans frein, lesquelles sont des formes institutionnelles de l’intransigeance. Un “faucon” accepte la déshumanisation comme prix de l’ordre ; *Munich* la refuse comme prix de l’âme.
On dira que tout cela n’est “que du cinéma”. Justement : chez Spielberg, le cinéma n’est pas une brochure, c’est une fabrique d’expérience morale. Il met le spectateur dans des situations où l’évidence tactique s’inverse en aporie éthique. Il invente une grammaire — focales serrées, découpage qui épouse le tremblement de l’hésitation, contrepoints sonores qui scrutent la peur des innocents pris autour des cibles — qui ôte à la violence sa séduction, à l’État sa majesté punitive, aux personnages leur statut d’outils. Ce langage, cohérent avec ses prises de parole, ne peut pas cohabiter avec une vision “faucon” du conflit israélo-palestinien. *Munich* n’argumente pas contre la légitime défense, il argumente contre la tentation de faire de la privation de droits, de la dépossession et de la force un ordre du monde. C’est pourquoi, loin d’être un film d’équivalences, c’est un film d’incompatibilités : entre dignité et domination, entre sécurité et vengeance, entre maison et exil, entre mémoire et obstination. Et c’est aussi pourquoi il ferme la porte — esthétiquement et moralement — à toute adhésion à la dépossession des Palestiniens.
Hugues
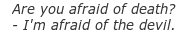
-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel
- Messages: 12535
- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
On peut lire l’œuvre de Spielberg comme une mise en garde obstinée contre l’ivresse de la puissance et ses avatars contemporains : sécurité préventive sans limites, état d’exception permanent, secret d’État sanctuarisé, réduction de l’“ennemi” à une fonction. Une telle grammaire de cinéma n’est pas compatible avec un programme de mainmise concrète et durable : accaparement territorial, expulsions, maintien sous blocus, régime de permissions et de checkpoints, punition collective, hiérarchie civique et juridique d’un peuple sur un autre. Elle les rend politiquement impraticables parce qu’elle reconduit partout la même exigence : redonner des visages, replacer le droit avant la force, et faire de l’empathie une méthode plutôt qu’un luxe.
Dans "Minority Report", la promesse de sécurité totale (Precrime) démonte, de l’intérieur, la logique du préventif absolu : déterminisme, surveillance, détention sans procès, tout ce que raffole une culture de l’“ordre à tout prix”. Le film remet le spectateur du côté des libertés publiques et de l’incertitude consentie : la paix civile n’est pas un produit d’algorithme, c’est une éthique du risque mesuré.
"Bridge of Spies" déplace la focale sur la procédure et la dignité : un espion soviétique reçoit un procès équitable, un avocat défend le droit sans exception, et la mise en scène refuse toute diabolisation. Le message est limpide : le droit protège d’abord quand il protège ceux que l’on aime le moins. On ne peut pas, dans le même mouvement, célébrer cette architecture du respect et avaliser un régime d’exception chroniquement appliqué à un peuple.
Avec "The Post", Spielberg réarme un autre contre-pouvoir : la presse face au secret d’État ("Pentagon Papers"). Transparence, responsabilité, droit du public à savoir : l’éthique du film est l’antidote exact d’une politique de domination qui exige la confiance aveugle pour des “mesures nécessaires”. Le choix de héros civils (plutôt que d’hommes de guerre) et d’un récit institutionnel (plutôt que d’un récit d’élimination) indique où se situe, chez lui, la vraie “force”.
Plus en amont, "E.T." résume l’intuition fondatrice : l’appareil étatique, filmé comme une machinerie d’intrusion, face à un enfant qui refuse la chosification de l’Autre. Cette matrice irrigue "Amistad" (l’habeas corpus arraché contre l’évidence de la force), "Lincoln" (convertir la puissance en droit), "Saving Private Ryan" (montrer la guerre comme dette morale, non comme spectacle), "A.I." (accorder une âme à l’être “jetable”). Partout, Spielberg entrave la logique qui rend possibles l’expulsion, l’infériorisation civique, l’assignation à résidence politique : il rétablit des personnes là où dominent des catégories.
Ses propos publics vont dans le même sens. À propos de "Munich" et au-delà, il répète qu’essayer de comprendre n’est ni excuser ni renoncer à agir : “Understanding does not mean to forgive… Understanding is a very muscular act.” Cette position n’autorise ni la déshumanisation ni l’indifférence aux souffrances infligées à des innocents, où qu’ils soient.
C’est dans ce cadre que "Munich" devient la pierre de touche, non le point de départ. Le film refuse la fable de l’efficacité souveraine : “nous tuons pour l’avenir, pour la paix”, dit-on aux exécutants ; mais au terme du trajet, Avner constate l’évident : “There’s no peace at the end of this, no matter what you believe” (“il n’y a pas de paix au bout de [ce chemin], quoi que tu croies”). Cette phrase n’est pas décorative : elle invalide précisément la promesse selon laquelle l’élimination ciblée, la punition exemplaire, la démonstration de force produiraient, à elles seules, la sécurité et l’apaisement.
La méthode de "Munich" est constante : Spielberg et Kushner ne “démonisent” personne ; chaque cible est présentée comme un individu, avec une histoire et des proches ; “il n’y a pas une seule mort que le film nous donne le droit de savourer”, résume Kushner. Autrement dit, la mécanique qui facilite l’accaparement et l’exclusion — réduire l’autre à une abstraction dangereuse — est méthodiquement empêchée. Le résultat, c’est un thriller où la “victoire” tactique corrompt l’âme, détruit les foyers, et ne livre ni paix ni sécurité.
Ce fil rejoint la manière dont Spielberg a caractérisé le projet : “une prière pour la paix”, face à “l’intransigeance” érigée en système. Replacée en fin de parcours, cette formule éclaire l’ensemble : si le véritable adversaire est la rigidité qui nie la réciprocité des droits, alors il devient impossible de tenir pour légitime une politique d’emprise concrète — appropriation de terres, déplacements forcés, siège indéfini, régime d’exception et de punitions collectives — exercée sur un autre peuple. L’œuvre entière prépare cette impossibilité ; "Munich" en fournit la démonstration dramatique, la filmographie alentour en assure la cohérence morale.
Garion a écrit:Ou pas.
Hugues
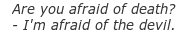
-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel
- Messages: 12535
- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Ce que le cinéma de Spielberg met inlassablement en scène, c’est la fragilité des vies ordinaires face à des appareils de puissance — militaires, policiers, bureaucratiques, technologiques — et la manière dont ces appareils, même lorsqu’ils prétendent “protéger”, abîment ceux qui les servent et ceux qui les subissent. L’œuvre dans son ensemble incline nettement contre l’idéologie de la force rédemptrice.
Dès les films de “menace” fondatrice, la violence n’apparaît pas comme une solution propre mais comme une logique qui se nourrit d’elle-même. Dans "Duel" et "Jaws", la pulsion sécuritaire fabrique de la panique, des boucs émissaires, et une gouvernance du réflexe. Spielberg y apprend à cadrer le pouvoir : réunions municipales, uniformes, phrasé technocratique de la sécurité… Ces micro-rituels, souvent filmés au téléobjectif ou en compositions collectives, ont une fonction constante dans son cinéma : montrer comment l’institution se légitime en promettant la maîtrise du risque tout en perdant de vue les personnes. Cette grammaire se radicalise dans "Close Encounters" et "E.T.", où la réponse étatique à l’altérité est la militarisation de l’espace intime : tentes pressurisées, combinaisons, scellage des maisons. Le “problème” est cadré depuis la sécurité, pas depuis la vie humaine.
La période “historique” confirme ce biais éthique. "Empire of the Sun" regarde l’enfant pris dans la logique impériale ; "Schindler’s List" met en crise la rationalité de spoliation — listes, quotas, wagons, registres — à laquelle Spielberg oppose gestes de sauvetage individuels et micro-alliances concrètes. La mise en scène associe régulièrement machines et domination (train, usine, caméra-mitrailleuse) et réserve aux visages, aux mains, aux corps, la vérité du sens moral. "Amistad" inscrit le conflit non dans un fantasme de pureté mais dans un combat procédural pour la dignité, où l’issue “juste” n’est possible qu’en résistant aux automatismes de propriété et de raison d’État. "Saving Private Ryan", souvent brandi comme film de “vertu martiale”, n’est pas le triomphe de la violence : c’est l’hécatombe, l’incapacité de la guerre à donner un sens autre que la survie d’un seul nom propre. Le fameux échange — sauver un homme pour “gagner” quelque chose de moral — inverse le calcul froid de la force : une vie singulière pèse plus qu’un raisonnement stratégique.
La veine “libertés publiques” prolonge cette défiance. "Minority Report" est un réquisitoire contre la prévention totalisante : l’anticipation du crime (pré-crime) et le ciblage préventif détruisent la liberté et fabriquent leurs propres erreurs. Or la logique préventive et les assassinats ciblés sont précisément la rhétorique des politiques de “sécurité absolue”. "War of the Worlds" resitue le spectateur du côté des déplacés : exode, checkpoints, hystérie collective, et surtout déshumanisation réciproque. "Lincoln" et "The Post" soutiennent que le conflit se résout — quand il se résout — par des procédures, du droit, de la presse, c’est-à-dire par des contre-pouvoirs à la souveraineté de l’exécutif. "Bridge of Spies" pousse plus loin : même l’ennemi a droit au procès équitable ; l’éthique ne se suspend pas aux frontières ni aux passions nationales. Ce motif de l’“ennemi humanisé” est un fil rouge chez Spielberg ; il ruine toute éthique d’exception permanente.
Reste "Munich", pivot inévitable dès qu’on interroge l'éthique du cinéaste à partir des films seuls. Tout y est filmé comme une spirale d’efficacité tactique et de faillite morale. Les assassinats réussissent et pourtant n’accomplissent rien qui ressemble à une pacification ; au contraire, ils multiplient les ripostes, dissocient les agents d’eux-mêmes, et contaminent l’intime (paranoïa, insomnie, hallucination de l’ennemi jusque dans l’étreinte). La mise en scène s’acharne moins sur la culpabilité des cibles que sur la corrosion des exécutants et l’auto-poisonnement d’une cause quand elle se laisse gouverner par l’élimination. Le film met en contact des justifications antagonistes, des souffrances et des légitimités concurrentes sans jamais accorder à la force le statut de solution durable. Ce n’est pas un procès de l’autodéfense ; c’est la déconstruction d’un fantasme d’exception — celui d’un droit qui se place au-dessus de tout, hiérarchise les vies et ne produit, à terme, que de la dette de sang. Face à la prétention d’une justice d’exception, d'un droit suprême, Munich est un contre-exemple structurel.
On objectera que Spielberg sait filmer la compétence militaire, l’héroïsme, l’appareil étatique ; qu’il travaille souvent avec les institutions ; qu’il n’est ni anarchiste ni révolutionnaire. Justement : son classicisme le rend d’autant plus lisible. Il n’a pas besoin de démonter frontalement l’État pour montrer ses angles morts. Sa morale est réformiste, libérale au sens politique : elle place la dignité individuelle, le due process, la presse, le droit, la responsabilité devant la tentation d’une force illimitée se proclamant auto-juste. Dans ses récits, la domination durable d’un groupe sur un autre n’est jamais un horizon ; la spoliation est archétypalement du côté du Mal (expropriations nazies, traite, nettoyages) ; les “victoires” obtenues par sur-violence se paient d’une perte de monde. Même quand la force paraît nécessaire, elle ne légitime pas l’emprise : elle est tragédie, pas doctrine.
Transposé au conflit israélo-palestinien, ce système de valeurs peut difficilement soutenir un soutien à la dépossession, à la domination ou à la violence de masse. Il s’y oppose par sa structure : humanisation des adversaires, refus de l’exception perpétuelle, centralité du droit, suspicion envers la prévention totale et les ciblages létaux, primat de la vie singulière sur les abstractions stratégiques, et conscience aiguë des dégâts moraux infligés par la force même lorsqu’elle est victorieuse.
Game over.
Hugues
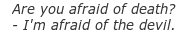
-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel
- Messages: 12535
- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Ouais_supère a écrit:De toute façon tu mets des smileys approbateurs dès que quelqu'un me contredit.
Généralement c'est pour oublier que tu viens de te faire torcher le cul par Hugues.
Non.
Je mets des smileys quand je suis d accord.
Ne te donne pas cette importance dans ma vie
.
Je me balance complètement des commentaires d Hugues sur mon approche des choses.
-

Ghinzani - Messages: 29327
- Inscription: 12 Sep 2005, 18:38
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Tes interventions sont des commentaires. Mais ne prends pas ton cas pour une généralité.
Mes interventions sont des argumentations.
Hugues
Mes interventions sont des argumentations.
Hugues
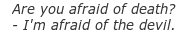
-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel
- Messages: 12535
- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Hugues a écrit:Tes interventions sont des commentaires. Mais ne prends pas ton cas pour une généralité.
Mes interventions sont des argumentations.
Hugues
Non ce sont des briques indigestes
Un
Peu le monologue du vagin.
-

Ghinzani - Messages: 29327
- Inscription: 12 Sep 2005, 18:38
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Feyd, Garion te le disent…
Même eux ne t incitent à aucune remise en question.
Ton approche n est pas réelle ni réaliste.
Palestiniens et israéliens doivent avoir un etat avec l obligation réciproque de se respecter.
Évidemment sans le hamas…
Même eux ne t incitent à aucune remise en question.
Ton approche n est pas réelle ni réaliste.
Palestiniens et israéliens doivent avoir un etat avec l obligation réciproque de se respecter.
Évidemment sans le hamas…
-

Ghinzani - Messages: 29327
- Inscription: 12 Sep 2005, 18:38
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Ghinzani a écrit:Hugues a écrit:Tes interventions sont des commentaires. Mais ne prends pas ton cas pour une généralité.
Mes interventions sont des argumentations.
Hugues
Non ce sont des briques indigestes
Un
Peu le monologue du vagin.
Entre le pilier de bar et des argumentations, tu choisis l'un moi je chosis l'autre
Sauf que l'avis du pilier de bar, on s'en branle si il nous explique pas pourquoi ...
Mais continue tes absurdités, parler de ta croyance dont on se branle... il y a une réalité, rattache ton propos à des faits sinon il est nul et non avenu
J'ajoute que il te reste 5h environ, voir l'autre sujet.
Genre je dis "j'aime la crème au caramel", ça donne quoi rien...
Genre je dis "La Palestine a été créé par des extraterrestr", ça donne quoi rien...
C'est une croyance non prouvée, et on peut raconter n'importe quoi en prouvant rien...
Comme le fait que la Palestine a été créé par des extraterrestre et que tous les dentistes de Belgique sont nuls en argumentations...
Oui on peut raconter ce genre d'idioties en ne prouvant rien
Et puis si on argumente, bah on parle déjà de quelque chose de plus réel. Point.
Ca gêne, je comprends quand on veut rester dans sa croyance...
Hugues
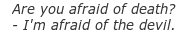
-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel
- Messages: 12535
- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Ghinzani a écrit:Ton approche n est pas réelle ni réaliste.
Elle est les deux, tout est argumenté.
Si c'est faux démontrez le ... faut le faire de lire ça de quelqu'un qui a toujours eu sa croyance détaché de tout fait ...
Si c'est si faux, n'importe quoi que j'ai écrit, démonrtez le...
J'attends que ça.. c'est mon plaisir rhétorique de voir où mon propos est faible ...
J'attends que ça !
Hugues
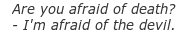
-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel
- Messages: 12535
- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Je ne suis hérétique que de toi et ta bande de hamassiens.
Tu sais, ma vie à moi est réelle.
Relis les propos de Feyd et Garion, ton seul
Modérateur.
Tu sais, ma vie à moi est réelle.
Relis les propos de Feyd et Garion, ton seul
Modérateur.
-

Ghinzani - Messages: 29327
- Inscription: 12 Sep 2005, 18:38
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Ghinzani a écrit:Palestiniens et israéliens doivent avoir un etat avec l obligation réciproque de se respecter.
Évidemment sans le hamas…
Démonstration? Pourquoi?
Pourquoi pas un seul état?
Pourquoi pas zéro et on donne tout au Japon ?
Et pourquoi mon idée débile que je viens d'exprimer est pas mieux que la tienne en fait?
C'est de la croyance. Rien n'est démontré. Rien.
C'est du "doive" mais ça dit rien..
Les fromagers du lait de chèvre doivent avoir un état sur le territoire de Palestine mandataire.
Voilà moi aussi j'ai dit "doivent"
C'est une suite de doivent, d'opinon de croyance et rien n'est étayé... rien n'est prouvé. Rien...
Dans un monde qui croit que toute opinion se vaut (or non toute opinion ne se vaut pas, oui oui Garion, rolala je te contredis, mais je peux l'étayer moi ..)
“Toutes les opinions se valent?”
Non. Ce n’est pas de la tolérance, c’est un abandon de poste. Une opinion commence à valoir quand elle s’expose : raisons publiques, risque de tomber, possibilité d’être corrigée. Sinon, c’est de la doxa — la croyance qui s’aime elle-même. Voir Platon
République V, 476e–480a : Doxa vs épistémè
« Ce qui est entièrement, on le connaît; ce qui n’est en rien, on ne peut que l’ignorer. Entre les deux, il y a ce qui tantôt est, tantôt n’est pas : à cela convient l’opinion. Car les belles choses, les justes, les bonnes, nous les voyons multiples, et chacune paraît à la fois telle à certains, autrement à d’autres; mais le Beau en lui-même, le Juste, le Bon, ils sont un et ne varient pas. Celui qui aime les spectacles et les sons a des opinions, car il se nourrit du multiple; le philosophe, lui, est ami du vrai, car il vise ce qui est. Ainsi, à l’être revient la science; au non-être l’ignorance; à l’entre-deux, à ce qui oscille, revient l’opinion. »
Ménon 97e–98a : Vraie opinion ( au sens de vérité ) “liée” par la cause
« Les opinions vraies ne sont pas de moindre utilité pour l’action que la science… tant qu’elles se maintiennent. Mais elles ne veulent pas rester longtemps en place : elles s’échappent de l’âme, si l’on ne les a pas liées en les rattachant à la cause. Une fois liées, pour la première fois elles deviennent science, et elles demeurent. C’est pour cela que la science est plus estimable que l’opinion droite : parce qu’elle est attachée par le raisonnement de la cause. »
République VI, 509d–511e
« Figure-toi une ligne partagée en deux grandes sections, l’une pour le visible, l’autre pour l’intelligible; et partage encore chacune selon la même proportion. Dans le visible, l’inférieur : les images, ombres et reflets; au-dessus : les choses qui en sont l’original. Dans l’intelligible, l’inférieur : ce sur quoi l’âme raisonne à partir d’hypothèses, comme avec les figures géométriques; au-dessus : ce que l’intellect saisit sans hypothèses, en remontant jusqu’au principe non hypothétique. Aux premiers correspondent l’imagination puis la croyance; aux seconds la pensée discursive puis l’intellection. Et chaque degré a plus ou moins de clarté et de vérité que celui qui est au-dessous. »
Théétète 201c–202c et 206c–210a) : Savoir = opinion vraie + logos (?) (logos étant ici le "parce que")
« Dire que la science n’est pas la perception, nous l’avons établi… Mais si ce n’est pas cela, que sera-t-elle ?… Peut-être l’opinion vraie ? — Mais l’opinion vraie, sans raison, comment serait-elle science ? Car il arrive que celui qui a l’opinion vraie, si on l’interroge, ne puisse rendre compte de ce qu’il croit. Dès lors, n’est-ce pas en ajoutant le logos à l’opinion vraie qu’on obtient la science ? — C’est du moins ce que beaucoup disent. — Examinons donc ce qu’est ce logos, et si, en l’ajoutant, nous faisons de celui qui opine véritablement un homme de savoir. »
Vous tenez à l’égalité des opinions ? Très bien : exprimez qui vous feraient changer d’avis. Si vous ne le pouvez pas, ce n'est même pas une croyance, c'est plutôt une identité (voilà pourquoi on le défend jusqu'à l'absurde, on ne recherche pas la vérité, on recherche à défendre quelque chose auquel on s'identifie). Popper l’a écrit en gros caractères : un énoncé qui prend le risque d’être réfuté pèse plus lourd qu’un caoutchouc qui rebondit sur tout. Lakatos ajoute dans Proofs and Refutations: il y a des programmes qui prédisent du neuf et gagnent en pouvoir explicatif, et d’autres qui rafistolent après coup . Les deux ne “se valent” pas ; l’un met sa peau en jeu, l’autre non.
Il n'y a pas de relativisme, il n'y a pas d'opinions égales. Il y a des vérités absolues. À trouver.
Ce n'est pas moi qui l'écrit c'est Platon, c'est Popper, Gettier, de Finetti, Joyce, Kant, Pettit, Habermas, Rawls.. Mais je peux développer mais on va me dire rolalallala c'est un pavé..
Bref, ras le cul du n'importe quoi..
Et des assertions énoncé comme des vérités quand ils sont hors de toute réalité.
(même sur l'égalité des opinions, on lit du n'importe quoi sur ce forum puisqu'on s'abstient d'argumenter)
Et de se voir agresser juste quand on a eu le malheur de faire partager son raisonnement de A à Z.
D'essayer de faire ce qu'il faut pour se rapprocher le plus de la vérité.. (on se trompe peut être, je me trompe peut être, mais en tout cas j'ai tout fait pour m'en rapprocher... )
Prout.
Hugues
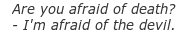
-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel
- Messages: 12535
- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Ghinzani a écrit:Je ne suis hérétique que de toi et ta bande de hamassiens.
Tu sais, ma vie à moi est réelle.
Relis les propos de Feyd et Garion, ton seul
Modérateur.
Qui sont les hamassiens?
Qu'est-ce qu'un hamassien.
Est-ce une insulte?
Tu as là aussi 3 jours, à la minute près.
Hugues
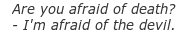
-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel
- Messages: 12535
- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Tout ceux qui adhèrent à leurs idées.
Arrete tu ne me fais pas peur, pauvre type.
Seul Garion est modérateur.
Arrete tu ne me fais pas peur, pauvre type.
Seul Garion est modérateur.
-

Ghinzani - Messages: 29327
- Inscription: 12 Sep 2005, 18:38
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
On ouvre pas un dancing en
Interdisant les rousses.
Interdisant les rousses.
-

Ghinzani - Messages: 29327
- Inscription: 12 Sep 2005, 18:38
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Je ne suis hérétique que de toi et ta bande de hamassiens.
Tu n’es pas hérétique.
Un hérétique s'oppose à un dogme ou une doxa.
C’est toi qui as une doxa, pas moi.
Ce n’est pas moi qui l’écris : c’est Platon.
Je suis ton hérétique ; toi, tu t’en tiens à la doxa.
Tu as un dogme. J'ai le logos.
Je ne peux être que ton hérétique. Et pas toi.
C'est fou de ne pas savoir de quoi on parle en fait.
Hugues
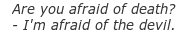
-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel
- Messages: 12535
- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Ghinzani a écrit:pauvre type
Pauvre type est une insulte? Ou non?
Tu as 3 jours.
Hugues
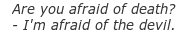
-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel
- Messages: 12535
- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Hugues a écrit:Ghinzani a écrit:pauvre type
Pauvre type est une insulte? Ou non?
Tu as 3 jours.
Hugues
J attends la demande de Garion, seul
Modérateur…
-

Ghinzani - Messages: 29327
- Inscription: 12 Sep 2005, 18:38
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Ghinzani a écrit:On ouvre pas un dancing en
Interdisant les rousses.
On a ouvert un lieu de débat.
Un débat nait du logos.
Tu n'exprimes jamais le logos.
La question est donc: que fais-tu là?
Hugues
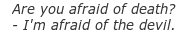
-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel
- Messages: 12535
- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Je répète : si tu ouvres un dancing, tu dois accepter les rousses…
-

Ghinzani - Messages: 29327
- Inscription: 12 Sep 2005, 18:38
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Ghinzani a écrit:Hugues a écrit:Ghinzani a écrit:pauvre type
Pauvre type est une insulte? Ou non?
Tu as 3 jours.
Hugues
J attends la demande de Garion, seul
Modérateur…
Il y a 4 modérateurs sur le forum:
3 "administrateurs" Silverwitch, Ouais_supère et moi-même
1 "modérateur"
La modération te demande des comptes, conformément à la charte que tu t'es engagée à respecter (sans jamais le faire).
Hugues
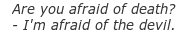
-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel
- Messages: 12535
- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Ghinzani a écrit:Je répète : si tu ouvres un dancing, tu dois accepter les rousses…
Accès libre aux personnes, exigences sur les contenus : pas d’attaques, des arguments sourcés. Si tu en as, je lis.
Oh wait.. tu as sorti des noms d'oiseau envers des interlocuteurs, tout à fait gratuitement, et tu refuses de t'expliquer (alors que peut être ça pourrait bien se passer à l'amiable.. qui sait.. )
C'est la rousse que je vire ou c'est le hooligan?
Hugues
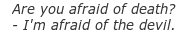
-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel
- Messages: 12535
- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Ghinzani a écrit:Tu sais, ma vie à moi est réelle.
Qui n'a pas de vie réelle?
Et selon quelle argumentation?
3 jours.
Hugues
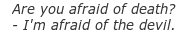
-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel
- Messages: 12535
- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Hugues a écrit:Ghinzani a écrit:Tu sais, ma vie à moi est réelle.
Qui n'a pas de vie réelle?
Et selon quelle argumentation?
3 jours.
Hugues
Tu n es pas modo, je m
En cogne.
-

Ghinzani - Messages: 29327
- Inscription: 12 Sep 2005, 18:38
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Qui a décidé des hiéarchies de la modération de ce forum. Pas toi.
Mais pas moi non plus.
Silverwitch en 2004.
Hiérarchie que j'applique à la lettre.
Incroyable.
Toujours ce droit divin de ne pas respecter les règles comme tout le monde
Hugues
Mais pas moi non plus.
Silverwitch en 2004.
Hiérarchie que j'applique à la lettre.
Incroyable.
Toujours ce droit divin de ne pas respecter les règles comme tout le monde
Hugues
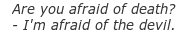
-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel
- Messages: 12535
- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Ghinzani a écrit:Hugues a écrit:Ghinzani a écrit:Tu sais, ma vie à moi est réelle.
Qui n'a pas de vie réelle?
Et selon quelle argumentation?
3 jours.
Hugues
Tu n es pas modo, je m
En cogne.
Ce qu'il faut saluer c'est ta remarquable cohérence.
Hugues a bâti ce forum, il en est propriétaire, c'est le sien, il y est donc chez lui.
Toi, des années après, tu débarques, et tu décides que Hugues n'est pas légitime pour revendiquer quoi que ce soit,tu déclares que tu es chez toi, et tu fais ta loi.
Bordel ça me rappelle un truc... deux trucs d'ailleurs.
Mais quoi ?
- Ouais_supère
- Messages: 25821
- Inscription: 20 Juil 2005, 11:54
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Au fait, Galaxy F1 que j'ai fréquenté, n'était ce pas déjà à l'époque des dissidents de F1 express ?
Une histoire de plus de 20 ans en somme. Déjà à l'époque certains ont pris leur clique et leur claque.
Une histoire de plus de 20 ans en somme. Déjà à l'époque certains ont pris leur clique et leur claque.
-

Feyd - Harkonnen
- Messages: 15552
- Inscription: 01 Sep 2005, 18:35
- Localisation: Giedi Prime
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Le temps est un grand maître, il règle bien des choses.
Look on my Works, ye Mighty, and despair! … Nothing beside remains.
La chétive pécore
S’enfla si bien qu’elle creva
Parturient montes, nascetur ridiculus mus.
J'ai jamais scissionné quoique ce soit moi... une de mes grande fierté, j'ai jamais claqué la porte, divisé le lieu commun pour mon seul orgueil, ni n'ait disparu du jour au lendemain sans avoir dit merci, ou à bientôt, comme si nous étions des étrangers, comme si on était rien du tout, qu'on se connaissait pas.
J'avais compris qu'il ne devait y avoir qu'un seul lieu, et que toute division était néfaste...
On a fixé des principes et on a essayé d'y être fidèle invariablement pendant plus de 20 ans. Quitte à défendre les Ghinzani, les Nicklaus, les Feyd, les Porcaro et les Fouad... (bien ingrats d'ailleurs, mais c'était attendu).
Les ceusses qui le firent (scissionner) peuvent pas en dire autant... ils ne peuvent même pas rêver de 20 ans...
It was in the reign of George III that the aforesaid personages lived and quarrelled; good or bad, handsome or ugly, rich or poor, they are all equal now.
Our works in stone, in paint, in print, are spared, some of them, for a few decades or a millennium or two, but everything must finally fall in war, or wear away into the ultimate and universal ash - the triumphs, the frauds, the treasures and the fakes. A fact of life: we're going to die. "Be of good heart," cry the dead artists out of the living past. "Our songs will all be silenced, but what of it? Go on singing." Maybe a man's name doesn't matter all that much.'
Hugues
Look on my Works, ye Mighty, and despair! … Nothing beside remains.
La chétive pécore
S’enfla si bien qu’elle creva
Parturient montes, nascetur ridiculus mus.
J'ai jamais scissionné quoique ce soit moi... une de mes grande fierté, j'ai jamais claqué la porte, divisé le lieu commun pour mon seul orgueil, ni n'ait disparu du jour au lendemain sans avoir dit merci, ou à bientôt, comme si nous étions des étrangers, comme si on était rien du tout, qu'on se connaissait pas.
J'avais compris qu'il ne devait y avoir qu'un seul lieu, et que toute division était néfaste...
On a fixé des principes et on a essayé d'y être fidèle invariablement pendant plus de 20 ans. Quitte à défendre les Ghinzani, les Nicklaus, les Feyd, les Porcaro et les Fouad... (bien ingrats d'ailleurs, mais c'était attendu).
Les ceusses qui le firent (scissionner) peuvent pas en dire autant... ils ne peuvent même pas rêver de 20 ans...
It was in the reign of George III that the aforesaid personages lived and quarrelled; good or bad, handsome or ugly, rich or poor, they are all equal now.
Our works in stone, in paint, in print, are spared, some of them, for a few decades or a millennium or two, but everything must finally fall in war, or wear away into the ultimate and universal ash - the triumphs, the frauds, the treasures and the fakes. A fact of life: we're going to die. "Be of good heart," cry the dead artists out of the living past. "Our songs will all be silenced, but what of it? Go on singing." Maybe a man's name doesn't matter all that much.'
Hugues
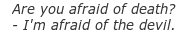
-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel
- Messages: 12535
- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Je n'ai pas besoin d'être défendu car j'ai tout le temps été dans la mesure. 
-

Feyd - Harkonnen
- Messages: 15552
- Inscription: 01 Sep 2005, 18:35
- Localisation: Giedi Prime
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Ouais_supère a écrit:Ghinzani a écrit:Hugues a écrit:Ghinzani a écrit:Tu sais, ma vie à moi est réelle.
Qui n'a pas de vie réelle?
Et selon quelle argumentation?
3 jours.
Hugues
Tu n es pas modo, je m
En cogne.
Ce qu'il faut saluer c'est ta remarquable cohérence.
Hugues a bâti ce forum, il en est propriétaire, c'est le sien, il y est donc chez lui.
Toi, des années après, tu débarques, et tu décides que Hugues n'est pas légitime pour revendiquer quoi que ce soit,tu déclares que tu es chez toi, et tu fais ta loi.
Bordel ça me rappelle un truc... deux trucs d'ailleurs.
Mais quoi ?
Hugues est intelligent ( je pense) toi pas
J ai dit : tu ouvres un dancing, tu acceptes les rousses
-

Ghinzani - Messages: 29327
- Inscription: 12 Sep 2005, 18:38
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Hugues a écrit:Accès libre aux personnes, exigences sur les contenus : pas d’attaques, des arguments sourcés. Si tu en as, je lis.
Oh wait.. tu as sorti des noms d'oiseau envers des interlocuteurs, tout à fait gratuitement, et tu refuses de t'expliquer (alors que peut être ça pourrait bien se passer à l'amiable.. qui sait.. )
C'est la rousse que je vire ou c'est le hooligan?
Hugues
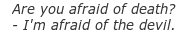
-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel
- Messages: 12535
- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Rien de surprenant. Les guignols pourront bloquer l'arrivée de La Vuelta, prendre la mer sur des sardiniers pour apporter de l'aide humanitaire à Gaza, continuer à brailler dans les rues en brandissant des drapeaux avec une serviette noire et blanche autour du cou, personne ne fera rien car les USA sont derrière. Tout comme personne ne fera rien si c'était la Chine ou la Russie. Bienvenue dans le monde des carnivores.
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20250915-rubio-rencontre-netanyahu-%C3%A0-j%C3%A9rusalem-pour-parler-des-cons%C3%A9quences-de-la-frappe-au-qatar
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20250915-rubio-rencontre-netanyahu-%C3%A0-j%C3%A9rusalem-pour-parler-des-cons%C3%A9quences-de-la-frappe-au-qatar
-

Feyd - Harkonnen
- Messages: 15552
- Inscription: 01 Sep 2005, 18:35
- Localisation: Giedi Prime
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Hugues a écrit:Le temps est un grand maître, il règle bien des choses.
Look on my Works, ye Mighty, and despair! … Nothing beside remains.
La chétive pécore
S’enfla si bien qu’elle creva
Parturient montes, nascetur ridiculus mus.
J'ai jamais scissionné quoique ce soit moi... une de mes grande fierté, j'ai jamais claqué la porte, divisé le lieu commun pour mon seul orgueil, ni n'ait disparu du jour au lendemain sans avoir dit merci, ou à bientôt, comme si nous étions des étrangers, comme si on était rien du tout, qu'on se connaissait pas.
J'avais compris qu'il ne devait y avoir qu'un seul lieu, et que toute division était néfaste...
On a fixé des principes et on a essayé d'y être fidèle invariablement pendant plus de 20 ans. Quitte à défendre les Ghinzani, les Nicklaus, les Feyd, les Porcaro et les Fouad... (bien ingrats d'ailleurs, mais c'était attendu).
Les ceusses qui le firent (scissionner) peuvent pas en dire autant... ils ne peuvent même pas rêver de 20 ans...
It was in the reign of George III that the aforesaid personages lived and quarrelled; good or bad, handsome or ugly, rich or poor, they are all equal now.
Our works in stone, in paint, in print, are spared, some of them, for a few decades or a millennium or two, but everything must finally fall in war, or wear away into the ultimate and universal ash - the triumphs, the frauds, the treasures and the fakes. A fact of life: we're going to die. "Be of good heart," cry the dead artists out of the living past. "Our songs will all be silenced, but what of it? Go on singing." Maybe a man's name doesn't matter all that much.'
Hugues
Moi je suis ingrat ? Envers qui ? Toi ? Que ce soit en public ou en privé je ne t’ai jamais insulté , juste reproché d’avoir laissé pourrir la situation avec des Edité par la modération comme Manu Edité par la modération ou d’autres qui ont pris des libertés puis t’ont planté un couteau dans le dos en faisant un groupe privé, je préfère taire Edité par la modération dont j’ai pu mesurer Edité par la modération.
Je sors provisoirement de ma réserve pour mettre vite fait les choses au point.
Edité par la modération qui chouine qu’on lui tape dessus alors qu’il dit ne plus être administrateur mais continue à faire Edité par la modération , bah Edité par la modération.
Pareil aux 2 ou 3 antifas qui Edité par la modération alors Edité par la modération. Ils se reconnaîtront, comme Edité par la modération. Connard inculte ( lui, pas toi). Je ne poste plus depuis des mois mais c'est toujours la même rengaine, donc le problème, c’est pas moi et ça me fait bien rire.
Bon et si certains veulent m’envoyer des mp, je les reçois plus depuis pas loin d’un an....Ceux qui veulent rester en contacts, vous pouvez me trouver je pense.
Sur ce, je vais bien , j’emmerde les gauchistes, et faute de Max champion, forza Piastri pour le titre et le rookie de l’année, c’est Bortoletto .
Le forum n'est pas un lieu pour régler ses comptes
-

Nicklaus - Je vous emmerde et je rentre à ma maison
- Messages: 65907
- Inscription: 21 Fév 2003, 09:19
- Localisation: Trump Tower, Moscou, Fédération de Russie
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
La Commission d’enquête internationale indépendante de l’ONU sur le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et Israël (mandatée par le Conseil des droits de l’homme et présidée par Navi Pillay) a conclu, dans un rapport présenté ce 16 septembre 2025, qu’Israël commet un génocide à Gaza:
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session60/advance-version/a-hrc-60-crp-3.pdf
https://apnews.com/article/israel-gaza-genocide-palestinians-c9d40ab3714b46957c5716132f9eb2a6
https://www.lemonde.fr/international/article/2025/09/16/selon-une-commission-d-enquete-du-conseil-des-droits-de-l-homme-de-l-onu-israel-commet-un-genocide-dans-la-bande-de-gaza_6641360_3210.html
Ce rapport, d'une telle commission, a une valeur juridique indirecte mais non contraignante en droit international.
Ce type de commission est un organe d’enquête mandaté par le Conseil des droits de l’homme. Elle établit des faits, analyse le droit applicable et qualifie juridiquement (ici, “génocide”).
Mais elle n’est pas une juridiction. Ses rapports sont donc des avis d’experts mandatés par un organe politique.
Juridiquement:
Ce n’est pas une décision judiciaire, donc aucune obligation légale directe ne découle du rapport.
En revanche, il sert de source probante devant les juridictions internationales (CIJ, CPI), les instances régionales ou nationales. Les juges peuvent s’y référer comme élément de preuve ou comme analyse juridique spécialisée.
Le rapport a aussi une valeur en termes de jurisprudence émergente, car il contribue à fixer l’interprétation de la Convention de 1948 sur le génocide.
Politiquement :
Ces rapports alimenteronnt les débats à l’ONU (Assemblée générale, Conseil de sécurité).
Et ça accroira la pression sur les États (tant Israel, en principe, que tous les autres états) pour qu’ils remplissent leur obligation de prévention du génocide prévue par la Convention de 1948 (tout pays doit tout faire ce qui est en son pouvoir, même de l'autre bout du monde, pour prévenir un génocide dont il a connaissance)
Et bien entendu ça pourra être utilisé pour déclencher des procédure devant la Cour pénal internationale ou la CIJ, par des ONG, des États ou des procureurs.
Ca a donc une certiane importance, ça peut avoir des conséquences sérieuses si cet outil est utilisé (car c'est en fait un outil qui est désormais à disposition en quelque sorte)... c'est pas juste "oh mais c'est une commission infesté de pro-palestiniens", comme on l'entendra certainement..
Hugues
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session60/advance-version/a-hrc-60-crp-3.pdf
https://apnews.com/article/israel-gaza-genocide-palestinians-c9d40ab3714b46957c5716132f9eb2a6
https://www.lemonde.fr/international/article/2025/09/16/selon-une-commission-d-enquete-du-conseil-des-droits-de-l-homme-de-l-onu-israel-commet-un-genocide-dans-la-bande-de-gaza_6641360_3210.html
Ce rapport, d'une telle commission, a une valeur juridique indirecte mais non contraignante en droit international.
Ce type de commission est un organe d’enquête mandaté par le Conseil des droits de l’homme. Elle établit des faits, analyse le droit applicable et qualifie juridiquement (ici, “génocide”).
Mais elle n’est pas une juridiction. Ses rapports sont donc des avis d’experts mandatés par un organe politique.
Juridiquement:
Ce n’est pas une décision judiciaire, donc aucune obligation légale directe ne découle du rapport.
En revanche, il sert de source probante devant les juridictions internationales (CIJ, CPI), les instances régionales ou nationales. Les juges peuvent s’y référer comme élément de preuve ou comme analyse juridique spécialisée.
Le rapport a aussi une valeur en termes de jurisprudence émergente, car il contribue à fixer l’interprétation de la Convention de 1948 sur le génocide.
Politiquement :
Ces rapports alimenteronnt les débats à l’ONU (Assemblée générale, Conseil de sécurité).
Et ça accroira la pression sur les États (tant Israel, en principe, que tous les autres états) pour qu’ils remplissent leur obligation de prévention du génocide prévue par la Convention de 1948 (tout pays doit tout faire ce qui est en son pouvoir, même de l'autre bout du monde, pour prévenir un génocide dont il a connaissance)
Et bien entendu ça pourra être utilisé pour déclencher des procédure devant la Cour pénal internationale ou la CIJ, par des ONG, des États ou des procureurs.
Ca a donc une certiane importance, ça peut avoir des conséquences sérieuses si cet outil est utilisé (car c'est en fait un outil qui est désormais à disposition en quelque sorte)... c'est pas juste "oh mais c'est une commission infesté de pro-palestiniens", comme on l'entendra certainement..
Hugues
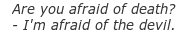
-

Hugues - Michel Desjoyeaux virtuel
- Messages: 12535
- Inscription: 26 Fév 2003, 06:14
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Si le hamas souhaitait un etat palestinien, il relâcherait les otages sans condition. Israël devrait baisser pavillon.
Si les palestiniens souhaitaient un etat et une vie plus normale, ils se révolteraient et feraient libérer les otages qui est le noeud du problème.
N oublions pas qu un civil devient un terroriste en passant du salon à la cuisine et inversement.
La famine ? Le genocide soit disant est de la responsabilité du hamas.
Quand on a gardé le silence lors du pogrome du 7 octobre, on garde ce silence lorsqu Israël se venge…
Si les palestiniens souhaitaient un etat et une vie plus normale, ils se révolteraient et feraient libérer les otages qui est le noeud du problème.
N oublions pas qu un civil devient un terroriste en passant du salon à la cuisine et inversement.
La famine ? Le genocide soit disant est de la responsabilité du hamas.
Quand on a gardé le silence lors du pogrome du 7 octobre, on garde ce silence lorsqu Israël se venge…
-

Ghinzani - Messages: 29327
- Inscription: 12 Sep 2005, 18:38
Re: Conflit israelo-palestinien 4: so you’re back, from outer sp
Ce rapport 
Je vois d'ici les accusations habituelles sur l'antisémitisme supposée venant d'israel et de ses soutiens.

Je vois d'ici les accusations habituelles sur l'antisémitisme supposée venant d'israel et de ses soutiens.
-

Maverick - Bête de sexe
- Messages: 41561
- Inscription: 22 Fév 2003, 00:02
- Localisation: Dans ton cul !!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Feyd et 20 invités





