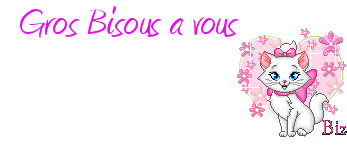von Rauffenstein a écrit:J'entends bien. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que tu n'entends pas ce que te dit Cortese. Sur le point de vue qui se veut universel mais qui ne correspond peut-être pas à sa propre vision de l'universalité. Un film beaucoup plus simple, "Au-Delà De La Gloire" (The Big Red One) de Samuel Fuller y arrive peut-être mieux parce qu'il n'a pas la prétention au départ de présenter une universalité, parce que forcément à travers la façon dont les Américains font et montrent la guerre. Pourtant, il y touche peut-être plus au final en ne montrant que l'homme confronté et entraîné dans l'effroyable et gigantesque (qui le dépasse sans qu'individuellement il parvienne à en changer le rythme et la marche, à part peut-être dans la solution "Catch 22" de Nichols ?) mécanique de la guerre. Pas de réflexion sur la guerre en ce jardin mais juste le spectacle intrinsèque de la guerre avec ses jeunes recrues et leur vieux mentor poursuivi par ses fantomes de celle d'avant. Fuller ne veut pas montrer la guerre en général, moderne et mécanisée. Il montre la sienne tout simplement. La même au final qu'Akira dans le Pacifique, qu'Helmut dans le saillant de Koursk, Mamud dans les Aurès ou de Jean sur la côte 304. Juste une histoire d'hommes sans savoir qui sera défait ou vainqueur au final.
A part Kubrick et Fuller, peut-être Schœndœrffer dans certains de ses films avant qu'il ne tombe dans le pathos, je ne vois pas qui a bien pu toucher à l'universel de l'homme, du combattant, c'est à dire de n'importe qui, sans condition de nationalité et d'idéologie, et ce qu'il peut ressentir quand il est pris dans la tourmente de l'orage d'acier. L'obus est apatride. Il tombe. Et gare en dessous.
Aucune représentation ne peut épuiser la réalité, puisque toute représentation est une réduction de la réalité, une simplification, une schématisation. Le point de vue d'un film est la traduction esthétique de la
fragmentation de la réalité, soit la définition d'une image. Je t'accorde volontiers que de nombreux films recherchent obstinément un regard
synoptique, et c'est bien ce qui caractérise des films aussi différents que ceux de Fuller ou de Malick.
En creux, tu proposes un critère d'appréciation d'un film, celui de
l'édification. Un film nous fait la leçon, non pas de manière scolaire, mais au sens d'une leçon de vie. Ainsi, tu décris ce que tu interprètes comme la qualité principale du film
The Big Red One, l'expérience de la guerre, ce que nous pourrions éprouver si nous étions à la place des combattants. Ce critère est valide, pourvu qu'il soit bien compris. En français, le mot
expérience a un double sens, à la fois
l'épreuve d'une situation, d'une action ou d'un sentiment qui nous transforme, et
l'expérimentation, soit l'observation d'une situation provoquée artificiellement. Un film, c'est une expérimentation qui provoque une épreuve chez le spectateur. Cela signifie que l'épreuve dont tu parles est un moyen, et non une fin, tout comme le réalisme documentaire, la qualité des uniformes, des armes est un moyen en vue d'une fin. Quelle est cette fin ? L'épreuve a vocation à répondre au précepte du temple de Delphes: "Gnothi seauton", Connais-toi toi même.
La représentation propose un dispositif de connaissance spéculaire, à travers un dispositif en miroir qui permet à travers un décentrement du regard d'atteindre l'essence de la vue, c'est-à-dire un trajet entre le singulier et l'abstrait, il faut donc un miroir pour représenter une portion de la réalité qui permet à travers un objet singulier (le visage d'un acteur, par exemple) de découvrir la généralité (l'humanité). L'esthétique, c'est la relation dialectique entre l'intelligible et le sensible. Si aucune représentation, au moins depuis Homère, ne peut épuiser la réalité, il nous faut néanmoins reconnaître ce que seule la représentation peut montrer, dans l'articulation entre ce qui est dit et ce qui est représenté.
Le cinéma a représenté dans des dizaines de films singuliers tout ce qui tenait dans une épopée chez Homère:
- L'individualité et l'honneur de l'ennemi, qu'il soit allemand avec "Croix de fer" de Peckinpah, ou japonais avec "Tora, tora, tora", qui trente ans avant Clint Eastwood et de manière plus audacieuse, traite à égalité les deux antagonismes, scindant le film en deux.
- La satire anti-militariste, avec des films aussi différents que "MASH", "Catch 22", "Qu'as-tu fait à la guerre, papa ?"
- La dénonciation de l'aventure coloniale avec "La Canonnière du Yang-Tse", aussi bien dans sa version plus nihiliste "Apocalypse Now".
- L'épreuve de la guerre que tu décris plus haut, avec les films de Fuller, d'Aldrich ou Anthony Mann (le splendide "Men in war"), sans oublier John Irvin ("Hamburger Hill")
- Le carnage et l'horreur avec les films d'Oliver Stone ("Platoon"), De Palma ("Outrages").
- Le cauchemar du vétéran ou du vaincu (du "Deer hunter", à "Rambo", en passant par "Né un 4 juillet")
- Les films à visée patriotique, les films à visée documentaire, les films de formation (de "Sergent la terreur", à "Tigerland", et évidemment "Full Metal Jacket")
Tous ces films représentent une portion du réel et les meilleurs se complètent sans s'opposer. Attention donc à ne pas transformer l'interprétation d'un film en utilisation. Ainsi, par exemple, le film de Fuller que tu mets en exergue nous montre autre chose que ce que tu décris, et son titre original le résume très bien, il a une vocation plus large, symbolique, figurée par le personnage de Lee Marvin et représenté à l'écran par les scènes d'ouverture et de conclusion du film. Ou bien encore par une séquence comme celle-ci:
C'est Kubrick ou c'est Fuller ?
Une approche critique du film de Malick contraint donc à s'interroger d'abord sur le
sens du film (ce qu'il veut dire) plutôt que sa
signification (la valeur de ce qu'il dit). On ne pourra donc faire l'économie d'un certain nombre de critères comme celui de l'originalité, celui de la cohérence, celui de la pertinence, une fois que l'on aura compris le point de vue du film. Et pour ma part, je l'ai compris tout de suite en lisant les mots inoubliables de Teilhard de Chardin:
La nostalgie du frontJe cite deux courts extraits:
Qu’est-ce que j’ai donc vu au front, moi ? et qu’est-ce que je veux donc tant y retrouver, malgré mon effroi de la peine et du mal ?
Sont-ce de nouveaux déserts, de nouveaux volcans ? — une harmonie nouvelle de lumières et de sons déchaînés ?
Est-ce la grande étendue muette des Flandres, où les armées affrontées semblent dormir parmi les eaux mortes ?
Est-ce la cime funèbre des crassiers parmi les corons en ruine ?
Est-ce le ravin brûlé des Hauts-de-Meuse, où les lourds éclatements font fumer de partout la terre comme par d’innombrables solfatares ?…
— Oui, sans doute, c’est cela. Mais c’est autre chose surtout, de plus subtil et de plus substantiel, dont tout ce grand appareil n’est que l’écorce et comme l’appât — autre chose que je ne puis me définir que par une atmosphère unique, pénétrante et dense, où baigne tout ce luxe de violence et de majesté —, ou encore par un état surhumain auquel l’âme se retrouve uniformément portée, en lignes, malgré la diversité des secteurs et les vicissitudes de la lutte.
L’expérience inoubliable du front, à mon avis, c’est celle d’une immense liberté.
En vérité, sans cette âme nouvelle et surhumaine qui vient relayer la nôtre, au front, il y aurait là-haut des épreuves et des spectacles qui ne se supporteraient pas — et qui semblent tout simples, cependant —, et qui laissent même, c’est un fait, une trace impérissable de plénitude et d’épanouissement.
J’affirme, pour moi, que, sans la guerre, il est un monde de sentiments, que je n’aurais jamais connus ni soupçonnés. Personne, hormis ceux qui y auront été, ne saura le souvenir chargé d’émerveillement qu’un homme peut garder de la plaine d’Ypres, en avril 1915, quand l’air des Flandres sentait le chlore et que les obus coupaient les peupliers, le long de l’Yperlé, — ou bien des côtes calcinées de Souville, en juillet 1916, quand elles fleuraient la mort. Ces heures plus qu’humaines imprègnent la vie d’un parfum tenace, définitif, d’exaltation et d’initiation, —comme si on les avait passées dans l’absolu.
Tous les enchantements de l’Orient, toute la chaleur spirituelle de Paris ne valent pas, dans le passé, la boue de Douaumont.
Lors donc que viendra la paix désirée des nations (et de moi tout le premier), quelque chose comme une lumière s’éteindra brusquement sur la terre. Par la guerre, une déchirure s’était faite dans la croûte des banalités et des conventions. Une « fenêtre » s’était ouverte sur les mécanismes secrets et les couches profondes du devenir humain. Une région s’était formée où il était possible aux hommes de respirer un air chargé de ciel. A la paix, toutes choses se recouvriront du voile de la monotonie et des mesquineries anciennes. Ainsi, autour de Lassigny, par exemple, les régions évacuées par l’ennemi paraissent-elles déjà mornes, vides et flasques, — la vie du front s’étant propagée plus loin.
Heureux, peut-être, ceux que la mort aura pris dans l’acte et l’atmosphère même de la guerre, quand ils étaient revêtus, animés d’une responsabilité, d’une conscience, d’une liberté plus grandes que la leur, quand ils étaient exaltés jusqu’au bord du monde, — tout près de Dieu !
Cette méditation que l'on trouve déjà chez Homère, on la retrouve pour la première fois de manière aussi explicite dans un film américain (les Soviétiques ont fait ce pas de côté dès la fin des années 50 avec quelques films géniaux). Cela on ne le voit que si l'on accepte de se confronter à l'altérité du film et qu'on se refuse à réduire le film à une simplification politique ou moralisante. Sinon, on ne voit pas le film, on se fait un film.










 )
)