La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Modérateurs: Garion, Silverwitch
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Désolé si je ne parle pas de "The tree of life", je vais m'attarder quelques secondes sur The Dark Knight rise que j'ai enfin pu voir avec un ami hier soir. Que dire sans être trop méchant, j'en attendait beaucoup, particulièrement après le film précédant.
Mais au final quelle déception pour moi, le film est très très lent dans son rythme (en plus d'être inutilement long), le scénario s'emmêle lui même et veut tellement en dire qu'il en devient brouillon. Puis Gotham City qui se trouve au final être une ville moderne et lumineuse, non cela ne passe pas, Gotham aurait du être sombre, sale. Seul le méchant ressort à mes yeux au niveau du caractère, mais il n'est pas assez exploité.
Je ne comprend pas trop le consensus positif des critiques sur ce film, j'avoue.
Mais au final quelle déception pour moi, le film est très très lent dans son rythme (en plus d'être inutilement long), le scénario s'emmêle lui même et veut tellement en dire qu'il en devient brouillon. Puis Gotham City qui se trouve au final être une ville moderne et lumineuse, non cela ne passe pas, Gotham aurait du être sombre, sale. Seul le méchant ressort à mes yeux au niveau du caractère, mais il n'est pas assez exploité.
Je ne comprend pas trop le consensus positif des critiques sur ce film, j'avoue.
-

lovecraft - Apérobic
- Messages: 8689
- Inscription: 19 Fév 2003, 17:26
- Localisation: Château-Thierry
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Vu ce soir: le documentaire "Into the abyss" de Werner Herzog. Une bien jolie histoire texane.
-

Madcad - Messages: 9062
- Inscription: 28 Fév 2003, 05:25
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Shunt a écrit:C'est sur le "comment" que je tique, car dans le film, elle se limite à une simple introspection nostalgique.
Non, pas du tout, il y a bien un voyage intérieur, mais il ne t'aura pas échappé que le personnage de Sean Penn est très secondaire dans le film. En revanche, le trajet mental est une expérience. Sur la forme, on peut trouver à redire, mais il faut s'entendre sur ce qui est représenté.
Sauf que l'astronaute et le toubib sont mis à l'epreuve, il y a un trajet, un voyage, une confrontation à leurs propres démons qui ne se résume pas à la seule introspection. Le personnage de Sean Penn reste immobile, replié sur lui-même, ses souvenirs, sa tristesse, sa nostalgie.
Tu oublies que le voyage se fait aussi bien par la pensée que par le corps ! En quelque sorte, seul le dépaysement physique ou géographique serait recevable. Mais quand tu regardes un film, Shunt, n'est-ce pas un voyage que tu fais ? Quand tu es dans un avion, n'es-tu pas immobile sur ton siège, ta ceinture de sécurité attachée, et pourtant en mouvement ? Un labyrinthe, c'est une figure géométrique, et c'est une figure qui peut se déployer dans l'espace comme dans le temps.
Le temps comme l'espace se plient:
Même si le personnage de Sean Penn renvoie à la propre vie de Malick, il n'est pas Malick dans le film. C'est là que le bât blesse à mon sens. Le film est une rêverie, celle du personnage de Sean Penn, c'est son deuil, sa vision subjective, sa vision du monde. Mais il n'est pas l'artiste, le médiateur. En tout cas, ce n'est pas par ce biais qu'il fait son deuil et touche du doigt ce "temps retrouvé". Il n'y a pas de processus à l'oeuvre chez lui, autre que cette introspection.
Que le personnage de Sean Penn renvoie ou non à la biographie de Terrence Malick n'a aucune importance, et pas le moindre intérêt. Oublie donc un peu ces histoires, et oublie un peu Sean Penn pour t'intéresser à la place du spectateur. C'est à travers les yeux de Sean Penn que nous faisons un voyage, dans le temps et dans l'espace. Le regard introspectif de Sean Penn est une fenêtre où se déploie notre regard projectif. Le dispositif cinématographique est celui d'un triangle: le regard du cinéaste, le regard du personnage, le regard du spectateur. Et j'ai essayé de montrer que le film propose une métaphore de la Création. Citons Baudelaire qui paraphrase Poe qui paraphrase Platon:
C’est cet admirable, cet immortel instinct du Beau qui nous fait considérer la Terre et ses spectacles comme un aperçu, comme une correspondance du Ciel. La soif insatiable de tout ce qui est au delà, et que révèle la vie, est la preuve la plus vivante de notre immortalité. C’est à la fois par la poésie et à travers la poésie, par et à travers la musique, que l’âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau ; et quand un poème exquis amène les larmes au bord des yeux, ces larmes ne sont pas la preuve d’un excès de jouissance, elles sont bien plutôt le témoignage d’une mélancolie irritée, d’une postulation des nerfs, d’une nature exilée dans l’imparfait et qui voudrait s’emparer immédiatement, sur cette terre même, d’un paradis révélé.
Si créer et reconnaître la Création, c'est la même chose, si faire un film et voir un film se nourrissent de la même source, l'aptitude à déployer un monde imaginaire avec des images, il y a une seconde métaphore déployée dans le film, la métaphore de la résurrection. Imagine-t-on Hamlet sans le spectre ? Et si la forme rêvée de Malick, c'était de rendre visible cette épiphanie, à animer la continuité entre l'immanence (les éléments, le corps, le vent) et la transcendance, de la finitude à l'éternité, de la matière à l'esprit, de l'humain au divin en l'homme ? Reconnaître le divin en l'homme, c'est identifier cette musique de l'âme qui résonne en nous, à travers nous, ce qui est d'ailleurs la racine du mot personne, per-sonare, ce qui résonne à travers nous.
Reprenons l'exemple de la séquence finale de 2001:
En miroir avec Malick:
Proposons une thèse, le film de Malick est une réponse à la souffrance de l'existence séparée, souffrance que tous les hommes connaissent et éprouvent dès lors qu'ils ont conscience d'être mortels. Rien de très surprenant jusque là, puisque c'est la thèse de l'acte créatif comme miroir de la Création dont je parlais plus haut. Ce qui est plus intéressant, c'est que si l'on envisage la place du monde, de la nature et des éléments dans le cinéma de Malick, c'est qu'il pose la souffrance de l'existence séparée comme un universel du vivant. C'est la souffrance qui par excès produit ce qui sauve. Souffrance du règne animal, souffrance du règne végétal, souffrance de Job, et irruption de la transcendance, que même un dinosaure peut éprouver, mais sans la résoudre, puisqu'il n'accède pas à la représentation, à la médiation, au logos (ou tout simplement au Verbe).

Job et sa femme
La souffrance ne peut-être vaincue que par l'amour (le divin en l'homme) qui s'exprime par la compassion (souffrir avec). La certitude de la mort, l'amour de la vie, l'épreuve du temps et de la finitude, tout ça ne peut se résoudre que dans un double acte: l'amour et la résurrection dans la représentation. Je vais mourir, mais la mort est vaincue par le divin en l'homme, que l'on ne peut reconnaître que dans un parfait miroir, celui de l'oeuvre d'art ou dans la pupille des êtres aimés. La lumière du beau nous attire et nous métamorphose, nous nous illuminons:
Et la beauté quotidienne, ineffable, sensible, immanente est un rappel discret de cet appel vers la lumière de la connaissance. La fin est un commencement: c'est toujours l'aurore du monde. Pourvu que nous regardions avec les yeux de l'âme.
Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
le dernier film de tom cruise est hyper nul. 
http://www.toilef1.com/IMG/jpg/140107spa.jpg
au revoir mon ami,continue a regarder les grands prix la haut au paradis des fans de sport auto.
au revoir mon ami,continue a regarder les grands prix la haut au paradis des fans de sport auto.
-
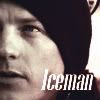
iceman46 - Iceman
- Messages: 11648
- Inscription: 14 Avr 2010, 21:03
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Shunt a écrit:Sur ce point, je ne suis pas d'accord. L'introspection du personnage de Sean Penn, celle qui va le conduire vers la lumière en quelque sorte, l'apaiser et le réconcilier avec lui même, débute avec la mort de la mère. C'est à partir de là qu'il rembobine le film de sa vie. La mort du frère est évoquée la plupart du temps "en creux". L'image du frère reste celle du petit blond sensible, gentil et débonnaire. Les balises de la période véritablement réexplorée dans le film renvoie à la propre expérience du narrateur, de sa genèse à son passage au monde adulte, marqué par le déménagement et "la mort symbolique" du père qui chute de son piédestal en perdant son job.
La mort de la mère n'est pas présente dans le film..
Sinon que nous savons d'entrée qu'elle est morte (sans que nous sachions si c'est récent ou bien antérieur), et que ce sont les morts aimés qui ont éclairé le chemin qui va nous être montré :
"Brother, mother, it was they that led me to your door."
Mais la flamme qui est allumée par Penn, l'est pour le frère.
Cette journée n'est pas plus particulière qu'une autre.. A part par le fait qu'il est suggéré que c'est une journée où l'on pense au frère ... (appel téléphonique "I think about him every day", la flamme, est-ce son anniversaire, l'anniversaire de sa mort ? le regard sur l'arbre de la ville qui provoque le voyage parce qu'il fait écho à l'arbre planté pour la naissance du frère.. )
"How did I lose you ?" souffle Jack, à l'éternel, dans les minutes précédents ce regard sur l'arbre. Cet éternel qu'il avait su finalement percevoir plus jeune, il l'a perdu bien avant la mort de sa mère, à la mort du frère...
Le message du film c'est celui d'un chemin de deuil.. Le cheminement de l'âme vers la paix face à la finitude en laquelle est est jetée, face à la mort...
Sauf qu'on apprend rien sur ce cheminement. On en reste à l'introspection et à l'exaltation mystique nourries par la nostalgie d'un passé idéalisé.
C'est exprimé esthétiquement et silverwitch l'a déjà décrypté.
C'est aussi exprimé dans quelques voix.
La voix du père Haynes dont tout le bref sermon est une adaptation de plusieurs pages des Quatre discours édifiants de Søren Kierkegaard[/i]... Pages d'un chapitre en lequel ce dernier souligne que Job prononce les mots "Dieu a donné, Dieu a repris" dans un ordre décisif. Autrement dit que Job choisit la gratitude, avant le ressentiment. Job voit l'offrande du monde, le présent éternel en son existence, avant même de considérer les conséquences même d'être plongé en ce monde.
Si l'on ignore que Haynes s'attarde sur ces mots, la grand-mère (Fiona Shaw) les a prononcé au début du film, face à Jessica Chastain.
Et cela fait écho au "I give it to you. I give you my son". Percevoir le miracle de l'instant vécu, percevoir le miracle de chacun aussi grand que le miracle de l'univers tout entier, voir l'éternel dans le présent, dans ce miracle extrême de son âme.
Enfin, je n'ai cessé de me promettre depuis juin d'écrire ici l'exégèse de nombreux plans mais qui ne font que dire ce que silverwitch sait dire de façon si poétique, et moi bien plus maladroitement.
Une fois posé le constat, je trouve que ça reste dans les derniers films de Malick une posture relativement stérile, voire un brin "régressive" si je peux me permettre l'expression. C'est le personnage de Sean Penn qui tente de retrouver la fraîcheur de l'enfance, c'est Pocahontas qui, au crépuscule de sa vie, joue dans le jardin comme lorsqu'elle était enfant... j'ai vu aussi dans la bande-annonce du dernier, une image où Olga Kurylenko danse comme une gosse insouciante et rêveuse dans les rayons d'un supermarché. Il y a cette idée que le retour en grâce, la régénérescence, passe irrémédiablement par un retour en arrière, à une forme de pureté et de naïveté originelle avec lesquelles il faudrait renouer pour toucher du doigt l'Eternel.
En premier lieu, je ne crois pas qu'il faille considérer l'instant du supermarché comme une attitude montrée en exemple. Marina est alors bien loin d'avoir trouvé le chemin vers ce plus grand amour, celui qui sauve.
Marina un personnage presque bipolaire, extrêmement désespérée, qui se réfugie dans l'espoir d'un amour qui ne fonctionne pas. Une fusion qu'elle est la seule à ressentir. Alors les moments où elle se force à voir les choses mieux qu'elles ne sont, elle est presque trop entière... Un désespoir que l'amour peut masquer, la passion peut masquer, mais qui est toujours là, près à se révéler quand surgit le maheur. Texte caché : cliquez sur le cadre pour l'afficher
Par ailleurs retrouver le premier regard, celui qui fait percevoir le présent éternel, n'est-ce pas retrouver l'émerveillement... The Wonder.
Hugues
- Hugues
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
silverwitch a écrit:Il y a bien un voyage intérieur, mais il ne t'aura pas échappé que le personnage de Sean Penn est très secondaire dans le film.
C'est contradictoire. On ne peut pas dire que le film évoque un voyage intérieur et affirmer celui qui effectue ce voyage intérieur n'a aucune importance. Certes, c'est un parmi d'autres, le film a valeur de démonstration universelle pour Malick, mais c'est ce personnage qui nous donne à voir, c'est sa subjectivité, ses visions, ses souvenirs. Le récit s'articule autour de lui.
Tu oublies que le voyage se fait aussi bien par la pensée que par le corps ! En quelque sorte, seul le dépaysement physique ou géographique serait recevable. Mais quand tu regardes un film, Shunt, n'est-ce pas un voyage que tu fais ?
Quand je regarde un film, je me confronte à l'autre, à un regard, à un discours, qui va m'ébranler, m'amuser, m'émouvoir, me passionner, m'ennuyer ou m'indifférer. Dans "Tree of Life", le narrateur n'est confronté qu'à lui-même, à ses propres souvenirs, sa propre subjectivité. On en reste finalement à une sorte d'auto-révélation et d'auto-élévation. Il n'y a pas d'élément exogène qui vient corriger son regard. Le narrateur s'auto-suffit. La vérité est déjà en lui, il lui faut juste la (re)trouver. On reste en circuit fermé.
Que le personnage de Sean Penn renvoie ou non à la biographie de Terrence Malick n'a aucune importance, et pas le moindre intérêt. Oublie donc un peu ces histoires, et oublie un peu Sean Penn pour t'intéresser à la place du spectateur.
Sauf que Malick mise - un peu facilement à mon goût - sur l'empathie du spectateur avec le personnage de Sean Penn. La scène finale sur la plage est un tire-larme absolu parce qu'elle titille notre propre détresse face à la mort et à la perte d'un être cher, face à l'absence. Elle est quasi-fantasmatique. Et à titre personnel, je la trouve assez malhonnête. Soit on en fait une lecture littérale, premier degré, et on y voit un au-delà qui à l'issue de notre vie terrestre nous réunit avec les êtres chers. Mais on en reste à du spéculatif et, in fine, à du consolatoire. Soit on en fait une lecture symbolique et on comprend que toutes ces personnes qui ont marqué notre existence survivent en nous-mêmes, qu'elles ont contribué à forger de ce que nous sommes et que c'est notre être épanoui qui les réunit dans un présent éternel. Mais dans ce cas, je trouve qu'il y a un décalage énorme entre la force émotionnelle véhiculée par cette séquence et ce qu'elle est censée symboliser. Par ailleurs, Malick élude totalement la question de notre mémoire, qui n'a rien d'une constante, car le temps et les épreuves peuvent l'éroder, l'altérer voire la déformer.
Comme le chantait Renaud (désolé
- Shunt
- Messages: 15282
- Inscription: 21 Fév 2003, 11:58
- Localisation: Lilleshire
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
En plus, il s'est fait griller par Lost, pour la scène finale.
Ouais_supère a écrit:Stef, t'es chiant
- Stéphane
- Le.
- Messages: 50710
- Inscription: 16 Déc 2004, 23:19
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Hugues a écrit:La mort de la mère n'est pas présente dans le film..
Sinon que nous savons d'entrée qu'elle est morte (sans que nous sachions si c'est récent ou bien antérieur), et que ce sont les morts aimés qui ont éclairé le chemin qui va nous être montré :
"Brother, mother, it was they that led me to your door."
Mais la flamme qui est allumée par Penn, l'est pour le frère.
Cette journée n'est pas plus particulière qu'une autre.. A part par le fait qu'il est suggéré que c'est une journée où l'on pense au frère ... (appel téléphonique "I think about him every day", la flamme, est-ce son anniversaire, l'anniversaire de sa mort ? le regard sur l'arbre de la ville qui provoque le voyage parce qu'il fait écho à l'arbre planté pour la naissance du frère.. )
"How did I lose you ?" souffle Jack, à l'éternel, dans les minutes précédents ce regard sur l'arbre. Cet éternel qu'il avait su finalement percevoir plus jeune, il l'a perdu bien avant la mort de sa mère, à la mort du frère...
En même temps, il est assez explicitement montré que c'est sa mère qui avait cette capacité à percevoir le divin en chaque chose... c'est son legs, son héritage. Il a perdu lui même cette capacité à l'émerveillement en passant de l'enfance à l'âge adulte, en sortant du giron maternel. Ce n'est pas le frère qui a sert d'aiguillon, c'est la mère. Le frère, c'est l'alter-ego. Et ce n'est pas du tout cette relation là qui est explorée dans le film. Le film s'intéresse davantage à la filiation, à la transmission.
Percevoir le miracle de l'instant vécu, percevoir le miracle de chacun aussi grand que le miracle de l'univers tout entier, voir l'éternel dans le présent, dans ce miracle extrême de son âme.
Oui, ça on le comprend assez bien dans le film. Ce qu'on comprend moins en revanche, c'est le processus par lequel le narrateur renoue les fils. Ce qui déclenche cette prise de conscience. Le simple souvenir de la mère aujourd'hui décédée ? A-t-il fallu qu'elle meurt pour qu'il comprenne (et retrouve) enfin ce qu'elle lui a laissé en héritage ?
Par ailleurs retrouver le premier regard, celui qui fait percevoir le présent éternel, n'est-ce pas retrouver l'émerveillement...
N'est-ce pas au contraire une chimère ou même une forme inconsciente de renoncement ? C'est la question qu'abordait très subtilement Malick à travers le personnage de John Smith dans "Le Nouveau Monde" et surtout celui du soldat Witt dans "la Ligne Rouge". Le sacrifice final de ce dernier relève à la fois du sublime (l'acte héroïque et généreux au service d'une cause supérieure) et du désespéré (devant l'incapacité à renouer avec son innocence originelle).
Dernière édition par Shunt le 14 Jan 2013, 01:38, édité 1 fois.
- Shunt
- Messages: 15282
- Inscription: 21 Fév 2003, 11:58
- Localisation: Lilleshire
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Stéphane a écrit:En plus, il s'est fait griller par Lost, pour la scène finale.
La honte
- Shunt
- Messages: 15282
- Inscription: 21 Fév 2003, 11:58
- Localisation: Lilleshire
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Shunt a écrit:C'est contradictoire. On ne peut pas dire que le film évoque un voyage intérieur et affirmer celui qui effectue ce voyage intérieur n'a aucune importance. Certes, c'est un parmi d'autres, le film a valeur de démonstration universelle pour Malick, mais c'est ce personnage qui nous donne à voir, c'est sa subjectivité, ses visions, ses souvenirs. Le récit s'articule autour de lui.
Il n'y a rien de contradictoire, Shunt. Tu confonds la place du spectateur et la place du personnage. Il n'y a aucune différence de nature entre le personnage de Tom Cruise dans Eyes Wide Shut et le personnage de Sean Penn dans Tree of life, sinon qu'une Odyssée se déroule dans l'espace quand la seconde se déroule dans le temps. Les deux sont dans la situation du voyageur immobile, ou de la flèche en vol, si tu préfères.
Quand je regarde un film, je me confronte à l'autre, à un regard, à un discours, qui va m'ébranler, m'amuser, m'émouvoir, me passionner, m'ennuyer ou m'indifférer. Dans "Tree of Life", le narrateur n'est confronté qu'à lui-même, à ses propres souvenirs, sa propre subjectivité. On en reste finalement à une sorte d'auto-révélation et d'auto-élévation. Il n'y a pas d'élément exogène qui vient corriger son regard. Le narrateur s'auto-suffit. La vérité est déjà en lui, il lui faut juste la (re)trouver. On reste en circuit fermé.
Non. Un récit filmique n'a aucune nécessité d'être exactement le miroir de son propre dispositif cinématographique. Le narrateur n'a pas besoin d'être un second spectateur.
Sauf que Malick mise - un peu facilement à mon goût - sur l'empathie du spectateur avec le personnage de Sean Penn. La scène finale sur la plage est un tire-larme absolu parce qu'elle titille notre propre détresse face à la mort et à la perte d'un être cher, face à l'absence. Elle est quasi-fantasmatique. Et à titre personnel, je la trouve assez malhonnête. Soit on en fait une lecture littérale, premier degré, et on y voit un au-delà qui à l'issue de notre vie terrestre nous réunit avec les êtres chers. Mais on en reste à du spéculatif et, in fine, à du consolatoire. Soit on en fait une lecture symbolique et on comprend que toutes ces personnes qui ont marqué notre existence survivent en nous-mêmes, qu'elles ont contribué à forger de ce que nous sommes et que c'est notre être épanoui qui les réunit dans un présent éternel. Mais dans ce cas, je trouve qu'il y a un décalage énorme entre la force émotionnelle véhiculée par cette séquence et ce qu'elle est censée symboliser. Par ailleurs, Malick élude totalement la question de notre mémoire, qui n'a rien d'une constante, car le temps et les épreuves peuvent l'éroder, l'altérer voire la déformer.
Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ?
Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
silverwitch a écrit:Il n'y a rien de contradictoire, Shunt. Tu confonds la place du spectateur et la place du personnage. Il n'y a aucune différence de nature entre le personnage de Tom Cruise dans Eyes Wide Shut et le personnage de Sean Penn dans Tree of life, sinon qu'une Odyssée se déroule dans l'espace quand la seconde se déroule dans le temps. Les deux sont dans la situation du voyageur immobile, ou de la flèche en vol, si tu préfères.
Je me suis peut-être mal exprimé. Dans Eyes Wide Shut, il y a épreuve, échange, confrontation avec autrui qui vont conduire à une prise de conscience. Le personnage de Sean Penn n'est confronté à personne d'autre qu'à lui-même, il se confronte à ses propres souvenirs.
Non. Un récit filmique n'a aucune nécessité d'être exactement le miroir de son propre dispositif cinématographique. Le narrateur n'a pas besoin d'être un second spectateur.
Je ne dis pas le contraire. Le narrateur dans "Tree of Life" est celui qui nous donne à montrer. Ce qui nous est montré, ce sont ses projections mentales. Ce qui justifie d'ailleurs la forme extrêmement elliptique du film, qui s'affranchit du temps et de l'espace.
Sauf que Malick mise - un peu facilement à mon goût - sur l'empathie du spectateur avec le personnage de Sean Penn. La scène finale sur la plage est un tire-larme absolu parce qu'elle titille notre propre détresse face à la mort et à la perte d'un être cher, face à l'absence. Elle est quasi-fantasmatique. Et à titre personnel, je la trouve assez malhonnête. Soit on en fait une lecture littérale, premier degré, et on y voit un au-delà qui à l'issue de notre vie terrestre nous réunit avec les êtres chers. Mais on en reste à du spéculatif et, in fine, à du consolatoire. Soit on en fait une lecture symbolique et on comprend que toutes ces personnes qui ont marqué notre existence survivent en nous-mêmes, qu'elles ont contribué à forger de ce que nous sommes et que c'est notre être épanoui qui les réunit dans un présent éternel. Mais dans ce cas, je trouve qu'il y a un décalage énorme entre la force émotionnelle véhiculée par cette séquence et ce qu'elle est censée symboliser. Par ailleurs, Malick élude totalement la question de notre mémoire, qui n'a rien d'une constante, car le temps et les épreuves peuvent l'éroder, l'altérer voire la déformer.
Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça ?
Je m'interroge simplement sur cette représentation, sa pertinence et sa portée. Parce que Malick nous dit in fine qu'il suffit de prendre conscience que ces êtres chers vivent "en nous" pour nous consoler de leur absence physique. Or il ne parvient à illustrer cela qu'au travers... de retrouvailles physiques. Soit il s'agit d'une facilité, soit il s'agit d'un aveu d'échec. Dans les deux cas, permets moi de ne pas être convaincu...
- Shunt
- Messages: 15282
- Inscription: 21 Fév 2003, 11:58
- Localisation: Lilleshire
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Shunt a écrit:Je me suis peut-être mal exprimé. Dans Eyes Wide Shut, il y a épreuve, échange, confrontation avec autrui qui vont conduire à une prise de conscience. Le personnage de Sean Penn n'est confronté à personne d'autre qu'à lui-même, il se confronte à ses propres souvenirs.
C'est ce que j'essayais de t'expliquer dans mes précédents messages, avec la métaphore de la flèche en vol. Sean Penn est un voyageur immobile, comme tu l'es dans un avion en vol. Le regard introspectif de Sean Penn est la condition du regard projectif du spectateur. L'épreuve a lieu dans une spirale du temps, très similaire à la figure géométrique de l'espace dans Eyes Wide Shut et directement comparable à la séquence finale de 2001:
Il n'y a pas moins d'action dans le film de Malick que dans un film de Kubrick, mais elle a lieu avec un décentrement, le corps qui agit n'est pas celui du personnage de Sean Penn, mais sera par exemple celui du personnage de Sean Penn enfant, de son frère, de son père, de sa mère, etc...
Je ne dis pas le contraire. Le narrateur dans "Tree of Life" est celui qui nous donne à montrer. Ce qui nous est montré, ce sont ses projections mentales. Ce qui justifie d'ailleurs la forme extrêmement elliptique du film, qui s'affranchit du temps et de l'espace.
Oui et non. Qu'est-ce qui regarde la Création dans Tree of life ? Le film déploie un regard abstrait.
Je m'interroge simplement sur cette représentation, sa pertinence et sa portée. Parce que Malick nous dit in fine qu'il suffit de prendre conscience que ces êtres chers vivent "en nous" pour nous consoler de leur absence physique. Or il ne parvient à illustrer cela qu'au travers... de retrouvailles physiques. Soit il s'agit d'une facilité, soit il s'agit d'un aveu d'échec. Dans les deux cas, permets moi de ne pas être convaincu...
Ce n'est pas ce que nous dit le film ! La figure est celle d'une spirale, ou à tout le moins d'un pli. Ce qu'illustre la double métaphore de la Création et de la résurrection. Que tu sois gêné par la forme du film, par certains choix esthétiques ou narratifs de Terrence Malick, je ne vais pas te le reprocher, puisqu'à un certain degré, je partage ton point de vue; il me semble cependant que le film est parfois dans le sentiment océanique décrit par Romain Rolland. Le problème, c'est que ta critique du film est trop superficielle, et que tu tombes dans le reproche que tu fais au film: c'est un peu auto-centré. Tu ne peux quand même contredire l'allégorie de la Caverne en disant au prisonnier incarné par Sean Penn qu'il lui suffirait de sortir de la caverne, quand le film illustre au contraire que c'est le regard de l'âme qui voyage par la fenêtre !
Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
silverwitch a écrit:C'est ce que j'essayais de t'expliquer dans mes précédents messages, avec la métaphore de la flèche en vol. Sean Penn est un voyageur immobile, comme tu l'es dans un avion en vol. Le regard introspectif de Sean Penn est la condition du regard projectif du spectateur. L'épreuve a lieu dans une spirale du temps, très similaire à la figure géométrique de l'espace dans Eyes Wide Shut et directement comparable à la séquence finale de 2001:
Il n'y a pas moins d'action dans le film de Malick que dans un film de Kubrick, mais elle a lieu avec un décentrement, le corps qui agit n'est pas celui du personnage de Sean Penn, mais sera par exemple celui du personnage de Sean Penn enfant, de son frère, de son père, de sa mère, etc...
Sauf que cette introspection a lieu à un instant t... à l'issue de cette introspection, le narrateur est passé d'un état x et un état y... ce n'est pas le parcours de sa vie dans sa globalité qui lui permet de toucher du doigt la Vérité et d'atteindre une forme de plénitude... c'est la relecture de ce parcours effectuée à un certain stade de sa vie, dans un contexte particulier, qui débouche sur cet éveil, cette renaissance. J'ai du mal à voir le personnage de Sean Penn enfant, son frère, sa mère, son père ou son frère comme des "corps agissants"... ce sont les figures d'un souvenir, d'une rêverie... l'agissant dans ce processus reste le personnage de Sean Penn adulte.
Ce qui me gêne dans le film de Malick, c'est que j'ai le sentiment qu'il nous dit "il nous suffit de...". Tout ce qu'il nous montre à l'écran relève de l'évidence, coule de source. Tout ce qu'il nous montre dès le départ est déjà beau, déjà sublime... sa démonstration est donc finalement assez vaine.
Oui et non. Qu'est-ce qui regarde la Création dans Tree of life ? Le film déploie un regard abstrait.
Pour moi, les scènes de Création font écho à l'existence du narrateur, à la vie humaine en général. Le monde est comme nous, il naît, il vit, il meurt. Une façon finalement de nous exhorter à accepter le cycle de la vie mais aussi la transcendance. La disparition physique de notre monde étant inéluctable - ce qu'illustre à la fin du film - détachons notre regard de cet immédiat pour aller plus loin, au-delà.
Tu ne peux quand même contredire l'allégorie de la Caverne en disant au prisonnier incarné par Sean Penn qu'il lui suffirait de sortir de la caverne, quand le film illustre au contraire que c'est le regard de l'âme qui voyage par la fenêtre !
Sauf que dans l'allégorie de Platon, les hommes enfermés n'ont jamais vu directement la lumière. Dans "Tree of Life", le narrateur se souvient de l'avoir déjà vue. C'est une différence notoire. La quête de vérité dans "Tree of Life" s'apparente à un retour aux sources, le sublime étant à la base évident. Contrairement à Platon, Malick célèbre la vérité des sens, de l'instinct naturel. C'est la contradiction même de l'allégorie de la caverne.
- Shunt
- Messages: 15282
- Inscription: 21 Fév 2003, 11:58
- Localisation: Lilleshire
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Oui c'est bien beau tout ça ..mais le dinosaure, il vient faire quoi là dedans ?
la démocratie et la souveraineté nationale sont comme l’avers et le revers d’une même médaille.
-

Rainier - Messages: 16919
- Inscription: 26 Mar 2003, 22:46
- Localisation: Guyancourt for ever
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Shunt a écrit:Hugues a écrit:La mort de la mère n'est pas présente dans le film..
Sinon que nous savons d'entrée qu'elle est morte (sans que nous sachions si c'est récent ou bien antérieur), et que ce sont les morts aimés qui ont éclairé le chemin qui va nous être montré :
"Brother, mother, it was they that led me to your door."
Mais la flamme qui est allumée par Penn, l'est pour le frère.
Cette journée n'est pas plus particulière qu'une autre.. A part par le fait qu'il est suggéré que c'est une journée où l'on pense au frère ... (appel téléphonique "I think about him every day", la flamme, est-ce son anniversaire, l'anniversaire de sa mort ? le regard sur l'arbre de la ville qui provoque le voyage parce qu'il fait écho à l'arbre planté pour la naissance du frère.. )
"How did I lose you ?" souffle Jack, à l'éternel, dans les minutes précédents ce regard sur l'arbre. Cet éternel qu'il avait su finalement percevoir plus jeune, il l'a perdu bien avant la mort de sa mère, à la mort du frère...
En même temps, il est assez explicitement montré que c'est sa mère qui avait cette capacité à percevoir le divin en chaque chose... c'est son legs, son héritage. Il a perdu lui même cette capacité à l'émerveillement en passant de l'enfance à l'âge adulte, en sortant du giron maternel. Ce n'est pas le frère qui a sert d'aiguillon, c'est la mère. Le frère, c'est l'alter-ego. Et ce n'est pas du tout cette relation là qui est explorée dans le film. Le film s'intéresse davantage à la filiation, à la transmission.
C'est un tout. Je ne sais pas si il est utile de séparer qui prévaut parmi les morts. Et le rapport que cela avec tes affirmations de départ.
Le film va du deuil à la perception de l'éternel dans le présent. C'est tout ce qui compte. A qui que ce soit que ce deuil se rattache, peu importe.
Bon il reste tout de même que quand tu affirmes que ça n'est pas exploré, je dois te faire souvenir de l'eau renversée sur la peinture, de la jalousie de la complicité du frère à la guitare avec le père au piano, de la confiance offerte, d'abord méritée, puis dans un second temps trahie, la punition qu'il veut que lui inflige son frère, la boite enterrée et les larmes du départ ( scène qui pour l'anecdote n'avait pas été tournée en rapport avec le déménagement, mais pour une séparation de la fratrie qui n'est pas finalement dans le film )
Le film nait du deuil déjà très ancien du frère, le deuil de la mère qui est survenu depuis (un deuil anti-historique, sa place dans le temps n'importe pas, et d'ailleurs on l'ignore) il est presque indifférent, il ne change pas la défiance vis à vis du Monde, le désespoir qu'avait déjà Jack. Mais évidemment, bien sûr aucun deuil ne prévaut sur l'autre, ressusciter les êtres aimés, c'est tant pour le frère que la mère, qu'on le désire.
Mais si on s'en tient au détail du film, c'est la première perte, la première blessure, celle qui rend toutes les autres indifférentes, parce qu'on a déjà perdu qui va pouvoir refermer, qui est celle qui déclenche le film, celle que Jack veut refermer.
"Find me" (Qui répond directement au "How did I lose you? Wandered. Forgot you.")
"Brother, keep us, guide us, to the end of time"
"I think to him every day"
"How did you come to me? In what shape? What disguise? I see the child I was. I see my brother. True. Kind. He died when he was 19." 1
"How did she bear it?" 2
Et puis le fils, le frère perdu inonde tout le début du film. Avant même que le voyage ne commence, avant même que nous ne rencontrions Jack, nous avons vu le deuil naître dans la famille ( un "He's in God's hands now." qui ne soigne rien : mais pourtant "he was in God's hands the whole time. Wasn't he?".. alors pourquoi? un "What did you gain?" qui répond plus fort à la prière simultanée qui espère éloigner ces doutes "I shall fear no evil. Fear no evil, for you are with me. Be not far from me, for trouble is near.", la grand-mère qui essaie de trouver les mots, "Shouln't have your memories of him. You have to be strong now. I know, the pain will, it will pass in time. [...]Life goes on. People pass along. Nothing stays the same. You still got the other two", en prononçant aussi les mots de Job, le père qui regrette les coups qu'il a pu donner sans raison)
Tout le film est bien autour de ce fils ou frère perdu.
Mais cela n'a pas d'importance finalement, cela concerne tous les morts de Jack ("Brother, mother, it was they that led me to your door."). Cela concerne tous nos morts.
1: "How did you come to me?", comme si le film naissait non de l'introspection en elle même, mais d'une réflexion, d'une réminiscence, d'une introspection sur l'introspection qui aurait déjà eu lieu)
2: Qui nous fait remonter à la Création même, comme si les mots d'incompréhension, d'égarement de Mrs O'Brien s'adressaient, étaient entendus depuis la Création même où tout était déjà écrit. Implicitement dès lors, le chemin de deuil de la mère pour son fils sera aussi celui de Jack pour ses morts.
Shunt a écrit:Percevoir le miracle de l'instant vécu, percevoir le miracle de chacun aussi grand que le miracle de l'univers tout entier, voir l'éternel dans le présent, dans ce miracle extrême de son âme.
Oui, ça on le comprend assez bien dans le film. Ce qu'on comprend moins en revanche, c'est le processus par lequel le narrateur renoue les fils. Ce qui déclenche cette prise de conscience. Le simple souvenir de la mère aujourd'hui décédée ? A-t-il fallu qu'elle meurt pour qu'il comprenne (et retrouve) enfin ce qu'elle lui a laissé en héritage ?
D'abord par l'ensemble du voyage, la dialectique de la Nature et la Grace, les deux faces du même Monde, des temps les plus reculés aux temps futurs les plus lointains avec les manifestation de la Nature et la Grace en sa propre vie. Nature et Grace sont les deux faces d'un même Monde, l'une n'est pas malfaisante et l'autre bienfaisante. Le Monde donne et le Monde reprend. Il est ainsi. (Pour paraphraser Fiona Shaw). En les deux cas, c'est la main de la Création. Au regard de percevoir donc qu'on ne peut pleurer la perte de ce qu'on a eu la chance d'avoir eu.
Mais aussi plus particulièrement par la réminiscence des deux (trois?) épiphanies de l'enfance, presque enchaînée dans le film.
- "What I want to do I can't do. I do what I hate3. ... You can hit me if you want. I'm sorry, you're my brother."
- "What was it you showed me? I didn't know how to name you then. But I know it was you. Always you were calling me."
- "Look, the glory around us. Trees and birds. I lived in shame. I dishonored it all and didn't notice the glory. A foolish man."
3: Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains, chapitre 7,verset 15:
"En effet, je ne comprends pas ce que j'accomplis, car ce que je voudrais faire, ce n'est pas ce que je réalise ; mais ce que je déteste, c'est cela que je fais."
Par ailleurs retrouver le premier regard, celui qui fait percevoir le présent éternel, n'est-ce pas retrouver l'émerveillement...
N'est-ce pas au contraire une chimère ou même une forme inconsciente de renoncement ? C'est la question qu'abordait très subtilement Malick à travers le personnage de John Smith dans "Le Nouveau Monde" et surtout celui du soldat Witt dans "la Ligne Rouge". Le sacrifice final de ce dernier relève à la fois du sublime (l'acte héroïque et généreux au service d'une cause supérieure) et du désespéré (devant l'incapacité à renouer avec son innocence originelle).
John Smith est au contraire dans la quotidienneté. Il ne parvient pas à en sortir. Il poursuit un autre monde, un paradis à venir au lieu de regarder le monde tel qu'il est, de trouver l'éternel, le paradis dans le présent.
"Did you find your indies John?
- I may have sailed pass them.
- You shall" (Tu les trouveras)
Quant à Witt, bien sûr qu'il y a une ambiguité.
Elle n'est d'ailleurs pas éludée.
"Where's your spark now ?" demande Welsh après l'avoir mis en terre à celui qui voyait encore une étincelle en lui"
Mais justement, c'est aussi une incitation à se remémorer la scène passée:
"- You ' still believing in the beautiful light, are you? How do you do that? You're a magician to me.
- I still see a spark in you.
(Voix off anonyme, suivant Welsh qui rejoint Witt endormi dans la nuit) : "One man looks at a dying bird and thinks there's nothing but unanswered pain. But death's got the final word. It's laughing at him.
Another man sees that same bird, feels the glory. Feels something smiling through him."
Tout est question de regard, la question est, quel est le regard qui sauve, celui qui fait vivre, qui fait trouver l'éternel dans le présent, suffisamment pour pouvoir se dire un jour que son temps est passé, qu'il est temps de retrouver cette seule et grande âme qui s'incarne en chacun de nous, et qui en s'incarnant nous fait éprouver la séparation, nous laisse rechercher seul ce qui sauve, comme une braise retirée du feu.
Ce qui est remarquable, finalement à mes yeux, c'est que chaque nouveau film fait les précédents films éclairer différemment, fait découvrir que c'était déjà dit, sans être audible.
Hugues
PS: Pour finir sur quelques mots plus anecdotiques, et hors sujet, mais qui me sont venu à l'esprit dans cet échange pour rester sur l'inaudible, la force innée, implicite à l'âme de certaine scènes devient intelligible, explicite à la conscience quand il cesse de l'être :
Ce monologue du soldat Dale moquant un Japonais mourant et ânonnant.
" I'm gonna sink my teeth into your liver. You're dying. See the birds up there? You know they eat you raw? Where you're going, you're not coming back from. What are you to me? Nothing. "
Ce que lui crie, lui répète sans cesse, de la force du désespoir, le Japonais, tout au long c'est "Un jour, tu vas mourir aussi.."
Tout comme les derniers instants de Witt..
"Rends-toi, c'est toi qui a tué nos compagnons, mais je n'ai aucun désir de te tuer. Tu es cerné, s'il te plait, rends-toi."
Le choix même, de ne pas sous-titrer, quand tout bon producteur l'aurait suggéré, réaffirme qu'il s'agit de parler avant tout aux âmes.
- Hugues
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Shunt a écrit:Sauf que cette introspection a lieu à un instant t... à l'issue de cette introspection, le narrateur est passé d'un état x et un état y... ce n'est pas le parcours de sa vie dans sa globalité qui lui permet de toucher du doigt la Vérité et d'atteindre une forme de plénitude... c'est la relecture de ce parcours effectuée à un certain stade de sa vie, dans un contexte particulier, qui débouche sur cet éveil, cette renaissance. J'ai du mal à voir le personnage de Sean Penn enfant, son frère, sa mère, son père ou son frère comme des "corps agissants"... ce sont les figures d'un souvenir, d'une rêverie... l'agissant dans ce processus reste le personnage de Sean Penn adulte.
Pfiou... Bon, je recommence. Quand tu regardes un tableau, un film, tu es immobile, ton corps ne se déplace pas, c'est ton âme qui fait un voyage par la fenêtre du cadre (l'articulation de ce qui est dit et de ce qui est montré). Si l'espace et le temps se plient, c'est que le passé n'est pas passé.
Shunt a écrit:Ce qui me gêne dans le film de Malick, c'est que j'ai le sentiment qu'il nous dit "il nous suffit de...". Tout ce qu'il nous montre à l'écran relève de l'évidence, coule de source. Tout ce qu'il nous montre dès le départ est déjà beau, déjà sublime... sa démonstration est donc finalement assez vaine.
J'ai déjà répondu, plusieurs fois, à cette objection. Tu n'as pas compris la démarche, la lumière du Beau est un appel vers l'illumination (tu comprends que les deux sont liés ?), et je te renvoie à Baudelaire qui paraphrase Poe qui paraphrase Platon:
C’est cet admirable, cet immortel instinct du Beau qui nous fait considérer la Terre et ses spectacles comme un aperçu, comme une correspondance du Ciel. La soif insatiable de tout ce qui est au delà, et que révèle la vie, est la preuve la plus vivante de notre immortalité. C’est à la fois par la poésie et à travers la poésie, par et à travers la musique, que l’âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau ; et quand un poème exquis amène les larmes au bord des yeux, ces larmes ne sont pas la preuve d’un excès de jouissance, elles sont bien plutôt le témoignage d’une mélancolie irritée, d’une postulation des nerfs, d’une nature exilée dans l’imparfait et qui voudrait s’emparer immédiatement, sur cette terre même, d’un paradis révélé.
Si tu veux une explication plus analytique, il suffit de lire Plotin.
Pour moi, les scènes de Création font écho à l'existence du narrateur, à la vie humaine en général. Le monde est comme nous, il naît, il vit, il meurt. Une façon finalement de nous exhorter à accepter le cycle de la vie mais aussi la transcendance. La disparition physique de notre monde étant inéluctable - ce qu'illustre à la fin du film - détachons notre regard de cet immédiat pour aller plus loin, au-delà.
Un écho, d'accord, mais quel écho ? Plutôt qu'écho, j'emploierais d'ailleurs le mot résonne de même racine que per-sonne. Ce qui résonne à travers nous, c'est le divin en l'homme, et reconnaître la Création, c'est créer. Je développerai si ça t'intéresse.
Sauf que dans l'allégorie de Platon, les hommes enfermés n'ont jamais vu directement la lumière. Dans "Tree of Life", le narrateur se souvient de l'avoir déjà vue. C'est une différence notoire. La quête de vérité dans "Tree of Life" s'apparente à un retour aux sources, le sublime étant à la base évident. Contrairement à Platon, Malick célèbre la vérité des sens, de l'instinct naturel. C'est la contradiction même de l'allégorie de la caverne.

C'est Platon qui parle de la lumière du Beau ! Comment tirer l'homme hors de la Caverne (avant qu'il n'y revienne) ? Grâce à la lumière du Beau, identifiée au Soleil.
Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
silverwitch a écrit:Pfiou... Bon, je recommence. Quand tu regardes un tableau, un film, tu es immobile, ton corps ne se déplace pas, c'est ton âme qui fait un voyage par la fenêtre du cadre (l'articulation de ce qui est dit et de ce qui est montré). Si l'espace et le temps se plient, c'est que le passé n'est pas passé.
Ca j'ai très bien compris. Je pose simplement la question du medium. Regarder un tableau ou un film, c'est échanger avec l'artiste. Certes, on va chercher en nous les clés qui nous permettrons de voir, d'analyser, de comprendre. Le film comme le tableau agissent comme des stimuli extérieurs, ils servent de supports et accompagnent notre propre introspection. C'est l'artiste et son oeuvre qui vont dévier notre regard et nous aider à voir le monde différemment. Dans le cas du personnage de Sean Penn, il n'y a pas d'élément extérieur qui déclenche et accompagne cette introspection. Tout s'accomplit spontanément, comme si ça coulait de source.
Tu comprends ma remarque ?
J'ai déjà répondu, plusieurs fois, à cette objection. Tu n'as pas compris la démarche, la lumière du Beau est un appel vers l'illumination (tu comprends que les deux sont liés ?)
Bien sûr. Mais encore faut-il savoir la capter. Si la lumière du Beau est une évidence comment se fait-il qu'on puisse l'ignorer ?
Un écho, d'accord, mais quel écho ? Plutôt qu'écho, j'emploierais d'ailleurs le mot résonne de même racine que per-sonne. Ce qui résonne à travers nous, c'est le divin en l'homme, et reconnaître la Création, c'est créer.
Et il crée quoi Sean Penn dans "Tree of Life" ?
C'est Platon qui parle de la lumière du Beau ! Comment tirer l'homme hors de la Caverne (avant qu'il n'y revienne) ? Grâce à la lumière du Beau, identifiée au Soleil.
S'il suffit de suivre la lumière pour accéder au monde et à la connaissance, tout le monde devrait en être capable. Or, il n'en est rien.
- Shunt
- Messages: 15282
- Inscription: 21 Fév 2003, 11:58
- Localisation: Lilleshire
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Hugues a écrit:Bon il reste tout de même que quand tu affirmes que ça n'est pas exploré, je dois te faire souvenir de l'eau renversée sur la peinture, de la jalousie de la complicité du frère à la guitare avec le père au piano, de la confiance offerte, d'abord méritée, puis dans un second temps trahie, la punition qu'il veut que lui inflige son frère, la boite enterrée et les larmes du départ ( scène qui pour l'anecdote n'avait pas été tournée en rapport avec le déménagement, mais pour une séparation de la fratrie qui n'est pas finalement dans le film )
Je n'ai pas dit que la relation au frère n'était pas explorée dans le film. J'ai dit que la fonction du frère dans le récit n'était pas la même que celles du père et de la mère. Le frère, c'est l'alter-ego, le double, un autre moi possible. D'où la complicité, mais aussi la confrontation inéluctable. L'enjeu de la relation au frère, c'est aussi le regard, l'amour des parents. Le frère artiste, dans un sens, c'est celui qui est touché par la grâce, qui n'avait pas "perdu l'éternel" au contraire du narrateur. C'est l'héritier spirituel de la mère en même temps que le fils préféré du père. Mais le pivot, celle qui montre la lumière, à l'origine, c'est la mère. Le frère n'était que le prolongement spirituel de la mère.
Le film nait du deuil déjà très ancien du frère, le deuil de la mère qui est survenu depuis (un deuil anti-historique, sa place dans le temps n'importe pas, et d'ailleurs on l'ignore) il est presque indifférent, il ne change pas la défiance vis à vis du Monde, le désespoir qu'avait déjà Jack. Mais évidemment, bien sûr aucun deuil ne prévaut sur l'autre, ressusciter les êtres aimés, c'est tant pour le frère que la mère, qu'on le désire.
Si la mort du frère est l'évènement pivot, qu'est-ce qui conduit le narrateur à faire le réexamen critique de son existence 30 ou 40 ans plus tard ? Quel est l'élément déclencheur de cette introspection ?
D'abord par l'ensemble du voyage, la dialectique de la Nature et la Grace, les deux faces du même Monde, des temps les plus reculés aux temps futurs les plus lointains avec les manifestation de la Nature et la Grace en sa propre vie.
Oui mais on ne voyage pas spontanément. Il y a un point de départ et d'arrivée. Or seul le point d'arrivée est clair dans "Tree of Life".
John Smith est au contraire dans la quotidienneté. Il ne parvient pas à en sortir.
Mais il cherche à s'en extraire, il cherche à échapper à sa condition... il est en quête. En quête permanente.
Il poursuit un autre monde, un paradis à venir au lieu de regarder le monde tel qu'il est, de trouver l'éternel, le paradis dans le présent.
C'est ce qui est intéressant dans ce personnage. Il veut mais n'y parvient pas. Trouver l'éternel dans le présent ne coule pas de source.
Quant à Witt, bien sûr qu'il y a une ambiguité.
Elle n'est d'ailleurs pas éludée.
"Where's your spark now ?" demande Welsh après l'avoir mis en terre à celui qui voyait encore une étincelle en lui"
Mais justement, c'est aussi une incitation à se remémorer la scène passée:
"- You ' still believing in the beautiful light, are you? How do you do that? You're a magician to me.
- I still see a spark in you.
(Voix off anonyme, suivant Welsh qui rejoint Witt endormi dans la nuit) : "One man looks at a dying bird and thinks there's nothing but unanswered pain. But death's got the final word. It's laughing at him.
Another man sees that same bird, feels the glory. Feels something smiling through him."
Tout est question de regard, la question est, quel est le regard qui sauve, celui qui fait vivre, qui fait trouver l'éternel dans le présent, suffisamment pour pouvoir se dire un jour que son temps est passé, qu'il est temps de retrouver cette seule et grande âme qui s'incarne en chacun de nous, et qui en s'incarnant nous fait éprouver la séparation, nous laisse rechercher seul ce qui sauve, comme une braise retirée du feu.
Ce qui m'intéresse dans le personnage de Witt, ce sont les points de suspension... à travers lui, Malick montre que l'on peut atteindre une certaine forme de grâce mais que cette quête peut nous conduire à renoncer à notre vie terrestre. Donc s'apparenter aussi à une forme de renoncement... Witt n'atteint l'état de grâce, de plénitude, qu'en renonçant finalement à la vie. Le spectateur perçoit dès lors toute la complexité de l'enjeu, le dilemme qu'il peut représenter. Dans "Tree of Life" finalement tout est vite dit, tout est évident... il n'y a pas d'enjeu, plus d'interrogations, que des certitudes. On est dans le prêche et c'est ce que je reproche à ce film.
- Shunt
- Messages: 15282
- Inscription: 21 Fév 2003, 11:58
- Localisation: Lilleshire
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Shunt a écrit:Ca j'ai très bien compris. Je pose simplement la question du medium. Regarder un tableau ou un film, c'est échanger avec l'artiste. Certes, on va chercher en nous les clés qui nous permettrons de voir, d'analyser, de comprendre. Le film comme le tableau agissent comme des stimuli extérieurs, ils servent de supports et accompagnent notre propre introspection. C'est l'artiste et son oeuvre qui vont dévier notre regard et nous aider à voir le monde différemment. Dans le cas du personnage de Sean Penn, il n'y a pas d'élément extérieur qui déclenche et accompagne cette introspection. Tout s'accomplit spontanément, comme si ça coulait de source.
J'ai déjà répondu à cette objection: le film n'a pas besoin de dupliquer le dispositif cinématographique, puisque c'est le regard introspectif de Sean Penn qui permet le regard projectif du spectateur. La condition du voyage immobile du spectateur, c'est le trajet mental du personnage de Sean Penn en miroir, nécessaire pour apprécier le pli du temps, ou si tu préfères sa rédemption.
Shunt a écrit:Tu comprends ma remarque ?
Oui, elle est inopérante, parce que tu n'as pas pris en compte la métaphore de la Création.
Bien sûr. Mais encore faut-il savoir la capter. Si la lumière du Beau est une évidence comment se fait-il qu'on puisse l'ignorer ?
Parce qu'un dispositif est nécessaire pour apprécier la lumière du Beau, qui est une lumière abstraite. La beauté sensible des éléments est un appel vers la Connaissance. Le dispositif, c'est celui qui est décrit dans la Caverne, par exemple, c'est le miroir, identifié au regard, qu'il soit humain ou divin.
Et il crée quoi Sean Penn dans "Tree of Life" ?
Sean Penn, c'est une figure du Créateur, qui à travers l'épreuve de la mort (sous le double signe de la mort biologique et de la mort symbolique) accède et permet au spectateur d'accéder à la source commune de la création ou de la reconnaissance de la création, l'aptitude à déployer un monde imaginaire, qui double le monde réel. Une image mentale est le négatif d'une image matérielle. Pour le dire, autrement, observation et imagination sont inséparables.
D'où la question: comment passer de la vision à l'expression ? La réponse de Plotin:
Reviens en toi-même et regarde !
Ce que décrit Saint Augustin dans les Confessions:
J'entrai, et avec l'oeil de mon âme, quelque médiocre que fût son état, je vis, au-dessus de ce même oeil de mon âme, au-dessus de mon intelligence, une lumière immuable.
Ce décentrement du regard, c'est l'acte de création. Il n'y a évidemment aucun paradoxe à ce que l'acte de création n'ait pas besoin de la médiation d'une image matérielle (l'image cinématographique, ou le tableau) ! En quelque sorte, l'art n'a pas sa fin en lui-même, l'oeuvre a besoin d'être achevée par le secours du monde sensible. Je vais te faire une dernière confidence: le personnage de Sean Penn, c'est une ombre, il n'existe pas. C'est Ulysse, celui qui trouve le chemin qui le conduit chez lui, à l'endroit où le passé, le présent et le futur se rejoignent pour former une constellation.
S'il suffit de suivre la lumière pour accéder au monde et à la connaissance, tout le monde devrait en être capable. Or, il n'en est rien.
On ne peut voir la lumière du Beau qu'avec un décentrement du regard, un égarement, si tu préfères. C'est ce que Plotin appelle l'oeil intérieur. Le dispositif, c'est toujours le même, c'est celui du miroir. On en revient toujours à cet impératif: connais-toi toi-même. D'où l'Odyssée du personnage de Sean Penn, pour se connaître, il a besoin de la médiation d'un trajet mental, et le passé faisant un pli se transforme en spirale, le passé n'est pas passé, ce qui permet au personnage de trouver le chemin qui le conduit chez lui (la "pensée" définie par Platon), tout comme Ulysse pourra abandonner son nom de "Personne", Outis, quand il retrouve son identité en revenant sur sa terre natale. Per-sonne, ce qui résonne à travers nous, c'est ce qu'il y a de divin en l'homme. L'oeuvre d'art, c'est ce qui métamorphose l'intuition en une réalité sensible, une image mentale en image matérielle, c'est une épiphanie.
C'est la flèche dont parle Dante dans Le Paradis: elle atteint sa destination avant que le son produit par la corde de l'arc n'ait cessé. Qu'est-ce qui vibre en nous, qu'est-ce qui résonne en nous ? C'est la promesse de l'éternité. On découvre l'éternité quand on reconnaît dans le monde sensible, les merveilles représentées dans les miroirs du monde. Comment se regarder soi-même ? C'est la question primordiale, Shunt !
Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Et attention, Silver reste dubitative, sur la valeur de ce film. Ca donnerait quoi, si elle considérait que c'est un sommet cinématographique ? J'en ai des vertiges ! 
(en tout cas, merci tous deux, pour ce dialogue passionnant).
(en tout cas, merci tous deux, pour ce dialogue passionnant).
"c'est quoi le blues". Toujours les mêmes histoires, celles qui font vaciller les mondes et les empires.
John Lee Hooker
John Lee Hooker
- Shoemaker
- Messages: 22441
- Inscription: 24 Nov 2003, 12:11
- Localisation: Out of Africa
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Il fallait bien sur lire : Merci à vous 3, puisque Silver + Hugues + Shunt = 3 !
Le compte est bon !
Le compte est bon !
"c'est quoi le blues". Toujours les mêmes histoires, celles qui font vaciller les mondes et les empires.
John Lee Hooker
John Lee Hooker
- Shoemaker
- Messages: 22441
- Inscription: 24 Nov 2003, 12:11
- Localisation: Out of Africa
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
silverwitch a écrit:Qu'est-ce qui vibre en nous, qu'est-ce qui résonne en nous ? C'est la promesse de l'éternité. On découvre l'éternité quand on reconnaît dans le monde sensible, les merveilles représentées dans les miroirs du monde. Comment se regarder soi-même ? C'est la question primordiale, Shunt !
Mais cette promesse d'éternité n'est-elle pas un leurre ? Se réfugier dans son imaginaire, dans ses souvenirs, comme le fait le narrateur, est-ce une élévation ou au contraire une forme d'enfermement ? Un autiste, a priori, c'est quelqu'un qui a une vie intérieure très riche et pourtant cette vie intérieure l'isole des autres. Tout comme le moine qui s'enferme dans sa cellule. Ce qui me dérange dans "Tree of Life", c'est que les autres finalement n'existent plus qu'en souvenir. On assiste à une forme de retraite spirituelle, mais cette introspection mérite d'être davantage questionnée. Finalement, cette scène de la plage, on peut la percevoir comme une forme de communion, de réconciliation, d'harmonie, d'exaltation, d'accomplissement mais cette fine bande de sable recouverte par les eaux peut aussi être perçue comme un trait d'union entre deux mondes, celui des morts et celui des vivants. Le personnage de Sean Penn à l'issue du film est-il pleinement vivant ou a-t-il finalement renoncé à vivre ? C'est la question qu'on peut se poser.
La quotidienneté de laquelle il faudrait à tout prix s'extraire pour accéder au vrai, elle fait partie de la vie. Vouloir y échapper, c'est un peu la quête du Graal. Il y a une dimension utopique là-dedans. Je me demande si "Tree of Life" dans sa forme si elliptique ne me fait pas penser à ce film truffé de jolies images qu'on projette à Sol dans "Soleil Vert" pendant son euthanasie... une sorte de baume spirituel qui lui offre pour ses derniers instants une dernière illusion de la vie.
- Shunt
- Messages: 15282
- Inscription: 21 Fév 2003, 11:58
- Localisation: Lilleshire
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Shunt a écrit:Mais cette promesse d'éternité n'est-elle pas un leurre ? Se réfugier dans son imaginaire, dans ses souvenirs, comme le fait le narrateur, est-ce une élévation ou au contraire une forme d'enfermement ? Un autiste, a priori, c'est quelqu'un qui a une vie intérieure très riche et pourtant cette vie intérieure l'isole des autres. Tout comme le moine qui s'enferme dans sa cellule. Ce qui me dérange dans "Tree of Life", c'est que les autres finalement n'existent plus qu'en souvenir. On assiste à une forme de retraite spirituelle, mais cette introspection mérite d'être davantage questionnée. Finalement, cette scène de la plage, on peut la percevoir comme une forme de communion, de réconciliation, d'harmonie, d'exaltation, d'accomplissement mais cette fine bande de sable recouverte par les eaux peut aussi être perçue comme un trait d'union entre deux mondes, celui des morts et celui des vivants. Le personnage de Sean Penn à l'issue du film est-il pleinement vivant ou a-t-il finalement renoncé à vivre ? C'est la question qu'on peut se poser.
Il faut filer la métaphore de la Création, à propos du personnage de Sean Penn qui nous renvoie directement à notre condition de spectateur. Qu'est-ce que lire un livre, regarder un tableau, une pièce de théâtre ou un film ? C'est se retirer du monde, c'est l'expérience d'un retrait, d'un congé, d'un pas de côté, chacun choisira le terme qui lui plaira le mieux. La retraite ou l'introspection dont tu parles, c'est notre condition de spectateur, en miroir: le détour par la représentation, par le récit n'est pas la négation de la réalité mais sa métamorphose. La réalité ne se suffit pas à elle-même, pour paraphraser Camus, si le monde était clair, il n'y aurait pas besoin de récits, de représentations, de doubles de la réalité. Mais la fin de l'oeuvre n'est pas l'oubli du monde, c'est au contraire une connaissance plus complète, plus claire, une transfiguration. Après le détour par le film, la lumière se rallume et nous sommes rendus au monde, rendus à nous, changés par le voyage. Le film n'oppose donc pas la vie ordinaire et la vie intérieure.
Shunt a écrit:La quotidienneté de laquelle il faudrait à tout prix s'extraire pour accéder au vrai, elle fait partie de la vie. Vouloir y échapper, c'est un peu la quête du Graal. Il y a une dimension utopique là-dedans. Je me demande si "Tree of Life" dans sa forme si elliptique ne me fait pas penser à ce film truffé de jolies images qu'on projette à Sol dans "Soleil Vert" pendant son euthanasie... une sorte de baume spirituel qui lui offre pour ses derniers instants une dernière illusion de la vie.
Oh, non ! Le film articule ce qui est dit à ce qui est montré. Je comprends que tu éprouves une réticence devant certains choix, mais la lumière du Beau est un élément central du dispositif cinématographique de Terrence Malick. Contrairement à Kubrick, la lumière du Beau précède celle de la raison au nom d'un principe: pour être désiré, le bien doit être reconnu comme désirable.
Même si je suis parfois perplexe devant le sentiment océanique que produit le film, tes réserves m'apparaissent excessives. Rares, très rares, sont les films qui proposent une telle représentation avec une telle ambition, celle de rendre visible l'invisible, d'accéder à la résurrection dans le corps glorieux du film pourvu que nous y reconnaissions la Création. De même, quel autre film a aussi bien articulé le lien entre les deux modes de connaissance de soi, la représentation et l'amour, tous deux liés par la notion de compassion ?
Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
silverwitch a écrit:Il faut filer la métaphore de la Création, à propos du personnage de Sean Penn qui nous renvoie directement à notre condition de spectateur. Qu'est-ce que lire un livre, regarder un tableau, une pièce de théâtre ou un film ? C'est se retirer du monde, c'est l'expérience d'un retrait, d'un congé, d'un pas de côté, chacun choisira le terme qui lui plaira le mieux. La retraite ou l'introspection dont tu parles, c'est notre condition de spectateur, en miroir: le détour par la représentation, par le récit n'est pas la négation de la réalité mais sa métamorphose. La réalité ne se suffit pas à elle-même, pour paraphraser Camus, si le monde était clair, il n'y aurait pas besoin de récits, de représentations, de doubles de la réalité. Mais la fin de l'oeuvre n'est pas l'oubli du monde, c'est au contraire une connaissance plus complète, plus claire, une transfiguration. Après le détour par le film, la lumière se rallume et nous sommes rendus au monde, rendus à nous, changés par le voyage. Le film n'oppose donc pas la vie ordinaire et la vie intérieure.
Mais au final qu'est-ce que cette introspection apprend au narrateur sur lui-même qu'il ne connait pas déjà ? Et qu'est-ce qu'il nous apprend à nous ? Qu'il faut savoir regarder et apprécier les belles choses pour élever notre âme ? A la bonne heure... honnêtement qu'est-ce que ce film t'a appris de nouveau, sur toi, sur le monde ? Je crois que "Tree of Life" est davantage un film qui conforte (qui cajole même) plus qu'il ne révèle. Je n'irai pas jusqu'à le comparer à "Amélie Poulain" mais...
Shunt a écrit:Oh, non ! Le film articule ce qui est dit à ce qui est montré. Je comprends que tu éprouves une réticence devant certains choix, mais la lumière du Beau est un élément central du dispositif cinématographique de Terrence Malick. Contrairement à Kubrick, la lumière du Beau précède celle de la raison au nom d'un principe: pour être désiré, le bien doit être reconnu comme désirable.
Même si je suis parfois perplexe devant le sentiment océanique que produit le film, tes réserves m'apparaissent excessives. Rares, très rares, sont les films qui proposent une telle représentation avec une telle ambition, celle de rendre visible l'invisible, d'accéder à la résurrection dans le corps glorieux du film pourvu que nous y reconnaissions la Création. De même, quel autre film a aussi bien articulé le lien entre les deux modes de connaissance de soi, la représentation et l'amour, tous deux liés par la notion de compassion ?
"Le Retour du Jedi" ?
- Shunt
- Messages: 15282
- Inscription: 21 Fév 2003, 11:58
- Localisation: Lilleshire
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Y avait pas un topic clignotant multicolore en caractères gras de 52 sur ce gros navet plutôt que de noyer les messages sur les autres films par un débat stérile ?
#JeSuisZemmour
-

Marlaga - Messages: 21263
- Inscription: 12 Mar 2007, 09:45
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Marlaga a écrit:Y avait pas un topic clignotant multicolore en caractères gras de 52 sur ce gros navet plutôt que de noyer les messages sur les autres films par un débat stérile ?
Retourne te palucher sur tes barbus et lâche nous la grappe.
- Shunt
- Messages: 15282
- Inscription: 21 Fév 2003, 11:58
- Localisation: Lilleshire
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Shunt, je court-circuite par manque de temps le message à mon intention pour répondre à celui de silverwitch, mais j'y reviendrai hein...
Ca n'est pas (seulement) regarder ou apprécier "les belles choses".
C'est voir le Monde tel qu'il est, parfait. Le voir en tout instant, dans son mystère, son miracle, sa transcendance. C'est reconnaître l'identité entre la transcendance du Monde et celle de son regard, celle de son âme. C'est finalement trouver le regard qui voit la beauté partout, en chaque instant. Qui voit face au regard, l'ouïe, le toucher, la transcendance en permanence, une transcendance que la quotidienneté, certes les affaires du quotidien, mais aussi ce qu'on peut appeler l'habitude du Monde, à cette idée rend aveugle. L'inexplicable est toujours devant soi, en permanence. Il y a toujours devant soi la raison de s'émerveiller.
Parce que, même une vision qui exclue toute transcendance, même un esprit qui n'y voit que chimie, gravitation, électro-magnétisme... si tout est déterminé, si la volonté n'est qu'une illusion, et est absence à l'échelle atomique et subatomique, les trajectoires (par l'entremise des forces précités, par la volonté illusoire du vivant) qui ont rassemblé ces atomes, ces êtres vivants, ces personnes, ces Nations et évènement historiques (finalement les atomes de chaque échelle) qui finalement aboutissent à notre être, cela signifie qu'elles sont écrites finalement dans le premier instant du Monde.
Autrement dit, notre âme a le même mystère que le destin préécrit de chaque atome du Monde, que le Monde lui-même. Elle est écrite dans le premier instant de l'Univers. Comme toute chose.
Même la vision la plus déterministe, ne peut échapper à la question de la transcendance.
Et un regard allergique à toute transcendance qui croit échapper à cette transcendance en niant ce déterminisme et introduit le libre-arbitre, en le créant, il admet implicitement la transcendance.
C'est donc une vision qui peut réunir le déterministe athée, l'agnostique, le croyant.
L'homme plongé dans l'ex-istence, dans la séparation, ne sait pas voir qu'il est dans l'éternel. Sauf à changer son regard.
Cet éternel c'est donc à la fois l'Univers qui luit toujours devant nous même en la chose la plus humble, l'instant présent écrit de tout éternité**, l'âme. Et puis l'éternel qui se révèle par l'imagination, par la création. Ce qui touche notre âme, par le Beau, un poème, une chanson, un tableau, une image, un geste. Mais qui si l'on veut bien changer de regard, peut-être perçu en chaque instant*
Et dire tout cela, ça n'est finalement pas vraiment différent du daisen et l'Etre d'Heidegger, de l'existentialisme chrétien de Kierkegaard, et Weil. Ou de ce qu'on entend dans la polyphonie de tant de voix de l'oeuvre Dostoïevski. Et même dans une certaine mesure de l'idée du Monde et de l'idée de transcendance chez Wittgenstein.
Ce qui est fascinant, et touchant, pour moi, c'est que le cinéma de Malick est à la fois profondément inscrit dans leur lignée, et dans le même temps, dit quelque chose d'inédit qui réussit leur synthèse.
 Oui, l'homme a la vie dure ! Un être qui s'habitue à tout. Voilà, je pense, la meilleure définition qu'on puisse donner de l'homme.
Oui, l'homme a la vie dure ! Un être qui s'habitue à tout. Voilà, je pense, la meilleure définition qu'on puisse donner de l'homme. 
Hugues (hier soir)
*: le sujet de la phrase peut être l'éternel ou le Beau. Qui finalement semblent synonymes, comme si l'un était témoignage de l'autre.
**: mais aussi fruit du premier instant, fruit d'une succession d'instant qui sont chacun autant de miracles, surtout si l'on introduit le libre arbitre de la vie et des âmes.
Shunt a écrit:Mais au final qu'est-ce que cette introspection apprend au narrateur sur lui-même qu'il ne connait pas déjà ? Et qu'est-ce qu'il nous apprend à nous ? Qu'il faut savoir regarder et apprécier les belles choses pour élever notre âme ? A la bonne heure... honnêtement qu'est-ce que ce film t'a appris de nouveau, sur toi, sur le monde ?
Ca n'est pas (seulement) regarder ou apprécier "les belles choses".
C'est voir le Monde tel qu'il est, parfait. Le voir en tout instant, dans son mystère, son miracle, sa transcendance. C'est reconnaître l'identité entre la transcendance du Monde et celle de son regard, celle de son âme. C'est finalement trouver le regard qui voit la beauté partout, en chaque instant. Qui voit face au regard, l'ouïe, le toucher, la transcendance en permanence, une transcendance que la quotidienneté, certes les affaires du quotidien, mais aussi ce qu'on peut appeler l'habitude du Monde, à cette idée rend aveugle. L'inexplicable est toujours devant soi, en permanence. Il y a toujours devant soi la raison de s'émerveiller.
Parce que, même une vision qui exclue toute transcendance, même un esprit qui n'y voit que chimie, gravitation, électro-magnétisme... si tout est déterminé, si la volonté n'est qu'une illusion, et est absence à l'échelle atomique et subatomique, les trajectoires (par l'entremise des forces précités, par la volonté illusoire du vivant) qui ont rassemblé ces atomes, ces êtres vivants, ces personnes, ces Nations et évènement historiques (finalement les atomes de chaque échelle) qui finalement aboutissent à notre être, cela signifie qu'elles sont écrites finalement dans le premier instant du Monde.
Autrement dit, notre âme a le même mystère que le destin préécrit de chaque atome du Monde, que le Monde lui-même. Elle est écrite dans le premier instant de l'Univers. Comme toute chose.
Même la vision la plus déterministe, ne peut échapper à la question de la transcendance.
Et un regard allergique à toute transcendance qui croit échapper à cette transcendance en niant ce déterminisme et introduit le libre-arbitre, en le créant, il admet implicitement la transcendance.
C'est donc une vision qui peut réunir le déterministe athée, l'agnostique, le croyant.
L'homme plongé dans l'ex-istence, dans la séparation, ne sait pas voir qu'il est dans l'éternel. Sauf à changer son regard.
Cet éternel c'est donc à la fois l'Univers qui luit toujours devant nous même en la chose la plus humble, l'instant présent écrit de tout éternité**, l'âme. Et puis l'éternel qui se révèle par l'imagination, par la création. Ce qui touche notre âme, par le Beau, un poème, une chanson, un tableau, une image, un geste. Mais qui si l'on veut bien changer de regard, peut-être perçu en chaque instant*
Et dire tout cela, ça n'est finalement pas vraiment différent du daisen et l'Etre d'Heidegger, de l'existentialisme chrétien de Kierkegaard, et Weil. Ou de ce qu'on entend dans la polyphonie de tant de voix de l'oeuvre Dostoïevski. Et même dans une certaine mesure de l'idée du Monde et de l'idée de transcendance chez Wittgenstein.
Ce qui est fascinant, et touchant, pour moi, c'est que le cinéma de Malick est à la fois profondément inscrit dans leur lignée, et dans le même temps, dit quelque chose d'inédit qui réussit leur synthèse.
 Oui, l'homme a la vie dure ! Un être qui s'habitue à tout. Voilà, je pense, la meilleure définition qu'on puisse donner de l'homme.
Oui, l'homme a la vie dure ! Un être qui s'habitue à tout. Voilà, je pense, la meilleure définition qu'on puisse donner de l'homme. 
— Fiodor Dostoïevski, Souvenirs de la maison des morts
Hugues (hier soir)
*: le sujet de la phrase peut être l'éternel ou le Beau. Qui finalement semblent synonymes, comme si l'un était témoignage de l'autre.
**: mais aussi fruit du premier instant, fruit d'une succession d'instant qui sont chacun autant de miracles, surtout si l'on introduit le libre arbitre de la vie et des âmes.
- Hugues
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Hugues 
Partant de l'atheisme borné qui est de règle aujourd'hui et récusant l'épouvantable bigoterie des islamistes, je suis arrivé aux mêmes conclusions que toi (en moi bien disant). Mais comment discerner, montrer encore la beauté, cernés, ensevelis que nous sommes sous la laideur ? (dasein quand même)

Partant de l'atheisme borné qui est de règle aujourd'hui et récusant l'épouvantable bigoterie des islamistes, je suis arrivé aux mêmes conclusions que toi (en moi bien disant). Mais comment discerner, montrer encore la beauté, cernés, ensevelis que nous sommes sous la laideur ? (dasein quand même)
- Cortese
- dieu
- Messages: 33533
- Inscription: 23 Fév 2003, 20:32
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Hugues a écrit:Ca n'est pas (seulement) regarder ou apprécier "les belles choses".
C'est voir le Monde tel qu'il est, parfait. Le voir en tout instant, dans son mystère, son miracle, sa transcendance. C'est reconnaître l'identité entre la transcendance du Monde et celle de son regard, celle de son âme. C'est finalement trouver le regard qui voit la beauté partout, en chaque instant. Qui voit face au regard, l'ouïe, le toucher, la transcendance en permanence, une transcendance que la quotidienneté, certes les affaires du quotidien, mais aussi ce qu'on peut appeler l'habitude du Monde, à cette idée rend aveugle. L'inexplicable est toujours devant soi, en permanence. Il y a toujours devant soi la raison de s'émerveiller.
Parce que, même une vision qui exclue toute transcendance, même un esprit qui n'y voit que chimie, gravitation, électro-magnétisme... si tout est déterminé, si la volonté n'est qu'une illusion, et est absence à l'échelle atomique et subatomique, les trajectoires (par l'entremise des forces précités, par la volonté illusoire du vivant) qui ont rassemblé ces atomes, ces êtres vivants, ces personnes, ces Nations et évènement historiques (finalement les atomes de chaque échelle) qui finalement aboutissent à notre être, cela signifie qu'elles sont écrites finalement dans le premier instant du Monde.
Autrement dit, notre âme a le même mystère que le destin préécrit de chaque atome du Monde, que le Monde lui-même. Elle est écrite dans le premier instant de l'Univers. Comme toute chose.
Même la vision la plus déterministe, ne peut échapper à la question de la transcendance.
Et un regard allergique à toute transcendance qui croit échapper à cette transcendance en niant ce déterminisme et introduit le libre-arbitre, en le créant, il admet implicitement la transcendance.
C'est donc une vision qui peut réunir le déterministe athée, l'agnostique, le croyant.
L'homme plongé dans l'ex-istence, dans la séparation, ne sait pas voir qu'il est dans l'éternel. Sauf à changer son regard.
Cet éternel c'est donc à la fois l'Univers qui luit toujours devant nous même en la chose la plus humble, l'instant présent écrit de tout éternité**, l'âme. Et puis l'éternel qui se révèle par l'imagination, par la création. Ce qui touche notre âme, par le Beau, un poème, une chanson, un tableau, une image, un geste. Mais qui si l'on veut bien changer de regard, peut-être perçu en chaque instant*
Et dire tout cela, ça n'est finalement pas vraiment différent du daisen et l'Etre d'Heidegger, de l'existentialisme chrétien de Kierkegaard, et Weil. Ou de ce qu'on entend dans la polyphonie de tant de voix de l'oeuvre Dostoïevski. Et même dans une certaine mesure de l'idée du Monde et de l'idée de transcendance chez Wittgenstein.
Ce qui est fascinant, et touchant, pour moi, c'est que le cinéma de Malick est à la fois profondément inscrit dans leur lignée, et dans le même temps, dit quelque chose d'inédit qui réussit leur synthèse.Oui, l'homme a la vie dure ! Un être qui s'habitue à tout. Voilà, je pense, la meilleure définition qu'on puisse donner de l'homme.
— Fiodor Dostoïevski, Souvenirs de la maison des morts
Hugues (hier soir)
*: le sujet de la phrase peut être l'éternel ou le Beau. Qui finalement semblent synonymes, comme si l'un était témoignage de l'autre.
**: mais aussi fruit du premier instant, fruit d'une succession d'instant qui sont chacun autant de miracles, surtout si l'on introduit le libre arbitre de la vie et des âmes.
Encore une fois, Hugues, j'ai très bien saisi les intentions de Malick sur ce film. Le souci dans "Tree of Life", c'est qu'il échoue à retranscrire le processus par lequel son narrateur retrouve la lumière si ce n'est se replonger dans ses souvenirs et émotions enfantins. Le beau, le sublime, l'Eternel est déjà présent dès le début du film, il est déjà une évidence. Tout le monde est beau. La maison est belle, la ville est belle, papa est beau, maman est belle, mes frères sont beaux. Quel effort le narrateur - et a fortiori le spectateur - doit faire pour percevoir cette beauté ? Aucun, puisque le Beau est évident, surligné à l'extrême. Il irradie littéralement l'écran. Où est la quête, où est l'effort sur soi, où est le travail de l'esprit ? Par ailleurs, est-ce que cette beauté formelle et irradiante illustre au mieux le Beau, l'Eternel ? A priori j'aurais plutôt tendance à penser qu'une beauté trop évidente, c'est une beauté qui éblouit, donc qui empêche de voir...
On avait déjà eu ce débat avec silverwitch au sujet de la relation Smith/Pocahontas. Elle m'avait répondu que le cinéma de Malick était l'héritier de la peinture religieuse qui formalise dans toute sa splendeur le Saint-Esprit, le Divin, l'Eternel. Mais la peinture religieuse a une fonction. Si l'Eglise a commandé des fresques magistrales, des sculptures, des tableaux aux plus grands artistes, c'est pour convaincre les fidèles de l'existence de Dieu. L'art religieux, c'est un art de propagande.
Ce que je reproche ici à Malick, c'est qu'à rendre le Beau aussi évident, il "berce" le spectateur plus qu'il ne le questionne. Sa démonstration - qui brasse la Création dans son ensemble, de l'infiniment grand à l'infiniment petit - laisse finalement peu de place au questionnement. Il nous suffit de nous rendre à l'évidence et nous aurons touché l'éternel du doigt. Malgré la complexité apparente du film, c'est une forme de facilité. "Tree of Life" s'apparente davantage à un prêche qu'à un dialogue. Et j'ajouterai qu'il ne prêche finalement que les convaincus. D'où ma question : qu'est-ce que ce film vous a appris ou fait découvrir que vous ne sachiez déjà ?
- Shunt
- Messages: 15282
- Inscription: 21 Fév 2003, 11:58
- Localisation: Lilleshire
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Shunt a écrit:Mais au final qu'est-ce que cette introspection apprend au narrateur sur lui-même qu'il ne connait pas déjà ? Et qu'est-ce qu'il nous apprend à nous ? Qu'il faut savoir regarder et apprécier les belles choses pour élever notre âme ? A la bonne heure... honnêtement qu'est-ce que ce film t'a appris de nouveau, sur toi, sur le monde ? Je crois que "Tree of Life" est davantage un film qui conforte (qui cajole même) plus qu'il ne révèle. Je n'irai pas jusqu'à le comparer à "Amélie Poulain" mais...
On bute toujours sur le même point, complexe, sans doute. Je reprends, de manière plus exhaustive et plus claire, je l'espère:
L'Odyssée narre le retour d'Ulysse dans sa patrie, dans son foyer: chez lui. Platon définit la pensée comme l'expérience (ou l'épreuve, je définirais plus bas rapidement les deux termes) qui permet de retrouver le chemin qui conduit chez soi. La définition de Heidegger (La Lettre sur l'humanisme) paraphrase Platon: "la dimension dans laquelle l'essence de l'homme, déterminée à partir de l'être, se sent chez elle". Par extension, on peut proposer selon Platon et Heidegger, la définition suivante: penser, c'est l'expérience d'un retour à l'origine de ce qui nous éprouve à penser, afin de reconnaître dans leur présence initiale, les choses elles-mêmes. La pensée, c'est le retour au commencement qui nous fait voir le monde comme si c'était la première fois, comme si c'était l'aurore du monde.
Le voyage du personnage de Sean Penn est une Odyssée, dans tous les sens du terme. Il s'agit d'un trajet mental, ou si tu préfères d'un voyage par la fenêtre de la pensée, du souvenir. Ce que nous avons nommé un regard introspectif. Que cherche-t-il ? À rentrer chez lui. Et qu'est-ce que veut dire cette phrase, sinon, trouver le chemin qui va le conduire chez lui ? Poussons plus avant notre raisonnement, si la pensée est le chemin qui vers l'origine, cela signifie que l'éloignement, dans le sens de la séparation, est la condition de la pensée: sans éloignement, pas de retour de l'absent. Sans absence, sans séparation, pas de pensée. Ulysse a pour nom "Personne", parce qu'il est séparé de sa filiation et de sa paternité qu'il ne retrouvera qu'à son retour au foyer. Ainsi, l'Odyssée n'est pas tant un dépaysement géographique, qu'une séparation temporelle, et l'Odyssée ne se termine (temporairement) qu'en pliant le temps. Ce qui motive le voyage, c'est une souffrance que l'on définit depuis comme la nostalgie. Ulysse est qualifié ainsi, après vingt et un longs vers sans être nommé: l'homme qui "souffre bien des douleurs". Puis, une seconde définition du même, par Ajax: "Ulysse voit toutes choses". Nouvelle proposition: l'idée et la vue, c'est la même chose. Vidéo et idea ont la même racine (j'y reviens après). Ulysse permet une simultanéité temporelle, par le biais de la narration, grâce au regard qui unit, ou réconcilie le passé, le présent et le futur pour former une constellation. Ainsi, le couchant et l'aurore se rejoignent pour former un cercle, celui du présent éternel. Et cela n'est possible que grâce à une phrase: "Je suis Ulysse, fils de Laërte". Le mot "personne" a changé de sens, non plus le sens théâtral du latin persona qui désigne le masque d'un acteur, non plus l'absence à soi-même (la mort symbolique), mais la présence intérieure.
Il ne s'agit pas ici d'une simple digression, mais d'une définition progressive. Le voyage intérieur, c'est celui du spectateur, et c'est le personnage de Sean Penn qui fait don de son regard pour que nous puissions voir toutes choses. Comme c'est l'âme qui voyage à travers la fenêtre, Sean Penn, comme le spectateur est un voyageur immobile. Ça ne signifie pas qu'il est inactif, comme le rappelle Heidegger: "Penser, ce n'est pas ne rien faire; la pensée est elle-même en soi l'action dans son dialogue avec le mond entendu comme destin". Tu peux désormais lever le voile, les personnages de fiction n'existent pas ! Il n'y a pas de cyclopes, pas de sirènes, pas de géants, mais des moulins à vent. Le plat à barbe n'est pas le casque de Mambrin, et Aldonza n'est pas l'enchanteresse Dulcinée. C'est ce que te raconte Don Quichotte, le roman des romans qui désenchante le monde pour mieux faire voir la réalité invisible, enchantée. Don Quichotte, le personnage, le chevalier fou, va avec Sancho Pança, le terrien, tout autant personnage. Montrer et le plat à barbe et le casque de Mambrin, les moulins à vent et les géants afin de donner du sens à la vie ordinaire qui en est si dépourvue en apparence. Sans Don Quichotte, le monde est incomplet, l'existence séparée, sans la quête de la beauté lumineuse. Mais le regard de Don Quichotte privé de celui de Sancho Pança, c'est une réalité seulement invisible, dépourvue de corps, de saveurs, du plaisir sensuel de la vie ordinaire. Sans Sancho Pança, le récit ne peut s'incarner, il ne peut être achevé. Sans l'un et l'autre, pas de vie réconciliée. On comprend ainsi avec cet exemple que le regard du personnage de Sean Penn n'est pas seulement la condition du regard du spectateur, il lui est complémentaire, c'est dans l'échange de ces regards (en vérité, au nombre de trois: celui de l'auteur, celui du personnage, celui du spectateur qui prennent la forme d'un triangle) que le spectateur peut reconnaître la lumière du Beau et le regard du spectateur offre un monde pour que le regard abstrait du personnage de Sean Penn puisse s'incarner. Proposition: le regard du spectateur et le regard de l'auteur ont une source commune, l'aptitude à déployer un monde imaginaire avec des images.
Revenons aux précédents exemples du cinéma de Kubrick:
Si on prend l'exemple de Shining, c'est l'envers du miroir qui nous est présenté. Le film est aussi abstrait que le film de Malick, puisqu'on pourrait aisément postuler que tout se passe à l'intérieur d'un monde-cerveau, ou d'un monde-fantasme, si l'on préfère. Ce que décrivent les exemples ci-dessus, c'est la situation du voyageur immobile: Tom Cruise, démasqué dans Eyes Wide Shut ou Jack Torrance dans Shining qui n'arrivera jamais à passer du désir à son accomplissement, il ne pourra jamais tuer sa famille. Ce que décrit Kubrick, c'est la potentialité effrayante du piège du temps, l'espace mental des choses qui sont là depuis toujours. Le personnage de Tom Cruise était venu dans l'orgie juste pour regarder, et il est un intrus car tout est déjà là, et il ne maitrise ni son regard (c'est le rêve de sa femme), ni la parole (Ziegler en fait le récit à sa place). Sans le secours du regard de l'âme, on ne voit que des apparences et le temps est un piège auquel les personnages ne peuvent échapper. L'enfant des étoiles dans 2001 transcende la dépression du temps, parce qu'il accomplit un voyage similaire à celui du personnage de Sean Penn dans Tree of life. C'est toujours l'allégorie de la Caverne: le prisonnier ne peut s'arracher à son monde que s'il est appelé par l'Idée au-delà de l'ouverture du souterrain. C'est la lumière du Beau pour Malick, et l'idée d'Intelligence pour Kubrick, représentée par une forme géométrique (le monolithe). La Connaissance est donc une exploration pour s'approcher au plus près d'une réalité invisible, c'est l'attelage ailé du Phèdre, avant le retour à la réalité sensible, avant le retour à la caverne, si tu veux, avant que la lumière dans la salle ne se rallume. Ainsi 2001 représente une renaissance, et Tree of life une résurrection. Les deux films se complètent puisqu'ils montrent deux voies chemins vers l'invisible, celui de l'Idée et celui de l'Amour, à travers l'épreuve, l'expérience, l'exploration de la compassion. Si l'on retient pour une fois le terme d'exploration, c'est pour insister sur l'infini. Il est impossible que le voyage soit autre chose qu'immobile, puisqu'il s'agit d'une réalité ineffable que l'on peut voir avec les yeux du corps, tout comme le navigateur s'oriente d'après les étoiles qu'il ne peut atteindre. Ainsi le cosmos est le miroir de l'âme dans son ouverture infinie à la connaissance et l'âme est le miroir du cosmos, d'où la pertinence de la métaphore de la Création dans le film de Malick.
Connais-toi toi-même ! C'est de cette question que naît la représentation, et c'est pour résoudre cette énigme qu'existent des personnages de fiction. Le coup de force de Tree of life, c'est qu'il propose dans une même représentation d'unifier les deux miroirs de l'âme que sont le dispositif artistique et la compassion. Contrairement à ton affirmation hasardeuse, il ne suffit pas d'ouvrir les yeux pour voir. Il faut une lumière et un miroir, c'est une connaissance spéculaire. Pourquoi ? Parce qu'en soi, en toi, en moi, se trouve non seulement une singularité, mais une personne. J'écrivais à cet égard que ce qui résonne à travers nous, c'est le divin en l'homme. Et le divin en l'homme, c'est que l'homme en lui contient l'humanité. D'où l'expérience, l'épreuve, l'exploration: de la vue à l'idée, du sensible à l'intelligible, de l'homme concret à l'humanité, c'est-à-dire l'idée de l'homme. Ce qu'on ne peut voir qu'avec un dispositif spéculaire. Je parlais plus haut de la racine wid que l'on retrouve aussi bien en latin, video, que dans le grec idea. Il y a bien un aller et retour entre la vue et l'intelligible. L'idée de l'homme, son humanité, c'est ce qui ne peut être vu avec les yeux du corps, mais par ce qui est invisible en lui, son universelle humanité. En fait, cela signifie: ce qui est divin en l'homme, c'est ce que je ne vois jamais, c'est son âme. Cette âme ne peut se voir que par l'oeil de mon âme qui ne peut jamais se voir elle-même, sans le secours du dispositif spéculaire. Ainsi, chez Malick, la lumière du Beau, n'a pas sa fin en elle-même, c'est-à-dire dans sa propre manifestation sensible et immédiate. La lumière du Beau est un appel, non pour changer de vie, mais pour changer la vie. C'est une condition pour être au monde, pour habiter le monde. C'est donc bien un détour réflexif, dans tous les sens du terme, auquel doivent se livrer et le spectateur et le personnage de Sean Penn. Faire un retour sur soi est une condition nécessaire (et non suffisante, sauf dans un cas) pour s'ouvrir au monde. C'est cette expérience que nous partageons, nous spectateurs avec le personnage de Sean Penn, et la solution de l'écart entre nos positions se trouve dans la nature polysémique du terme. Le mot expérience a un double sens: l'épreuve d'une situation ou d'un sentiment, d'un souvenir dont nous sortons transformés, et l'expérimentation qui consiste dans l'observation d'une situation provoquée de manière artificielle. Le cinéma est une expérimentation d'actions, de sentiments ou de souvenirs fictifs qui en provoquent l'épreuve chez le spectateur.
Ou pour citer une première fois Saint-Paul (et je souligne):
"Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à face ; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai été connu.".
Tu me demandes ce que j'ai appris du film de Malick ? J'y ai vu comme dans un éclair quelque chose que je voyais sans le reconnaître, c'est ce que je décrivais comme la souffrance comme universel du vivant. Je n'avais pas compris ce que ça signifiant et quel était le lien entre le monde humain, le monde végétal qui ne peut connaître et dont la beauté nous appelle à la connaissance et le monde animal. Cette souffrance dont l'excès produit ce qui sauve, je le vois désormais, comme pour la première fois. Ensuite, je comprends désormais, de manière plus sensible et moins cérébrale, ce lien entre la représentation artistique et l'amour, que j'essaye de te communiquer. L'amour rédime notre souffrance par la compassion, la souffrance partagée. Alors enfin, je peux voir pour la première fois ce que je lisais les yeux grand fermés auparavant (Saint-Paul):
Quand je parlerais en langues, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante.
Quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurais la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien.
[...]
L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties ? Elles seront abolies. Les langues ? Elles prendront fin. La connaissance ? Elle sera abolie.
Car notre connaissance est limitée, et limitée notre prophétie.
Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli.
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant.
A présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse, mais alors, ce sera face à face.
A présent, ma connaissance est limitée, alors, je connaîtrai comme je suis connu.
Maintenant donc ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour est le plus grand.
Le miroir, la personne, ce qui résonne à travers nous. C'est dans la vibration du film en nous que se trouve cette lumière du Beau, cet appel vers une autre réalité invisible. Je revois ma vie, et c'est autre chose qu'en moi je vois.
Ça ne se fait pas de jouer de la lyre tandis que Rome brûle , mais on a tout à fait le droit d'étudier les lois de l’hydraulique.
-

Silverwitch - Seven of Nine
- Messages: 27893
- Inscription: 28 Mar 2003, 19:39
- Localisation: Filmskigrad
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
silverwitch a écrit:Tu me demandes ce que j'ai appris du film de Malick ? J'y ai vu comme dans un éclair quelque chose que je voyais sans le reconnaître, c'est ce que je décrivais comme la souffrance comme universel du vivant. Je n'avais pas compris ce que ça signifiant et quel était le lien entre le monde humain, le monde végétal qui ne peut connaître et dont la beauté nous appelle à la connaissance et le monde animal. Cette souffrance dont l'excès produit ce qui sauve, je le vois désormais, comme pour la première fois. Ensuite, je comprends désormais, de manière plus sensible et moins cérébrale, ce lien entre la représentation artistique et l'amour, que j'essaye de te communiquer. L'amour rédime notre souffrance par la compassion, la souffrance partagée.
Ce que tu décris là, c'est davantage ce que j'ai ressenti devant la "Ligne Rouge". Mais effectivement, à la lumière de ce que tu exprimes, j'ai peut-être été un peu sévère en parlant de "réhabilitation" au sujet du père dans "Tree of Life" alors qu'il s'agit comme tu le dis de compassion. Le père en fait, c'est à la fois l'opposant et le double du narrateur, le père alimente chez lui une forme de haine de soi. C'est la mort de la mère qui le conduit au réexamen de cet antagonisme père/fils. Comme tu l'as écrit, "il ne suffit pas d'ouvrir les yeux pour voir, il faut une lumière et un miroir". Dans cette introspection qui le ramène en enfance, il retrouve la lumière - la mère, celle qu'elle était avant la mort du frère - et découvre enfin le miroir en son père, au regard finalement de l'adulte qu'il est devenu. La mort de la mère le réconcilie in fine avec le père, mais aussi avec ce frère dont il n'a jamais vraiment réussi à faire le deuil. Ce frère enfant chéri du père et alter-ego encombrant (car autre moi possible) qui le renvoie à ses propres failles, à son propre échec. D'où la réconciliation finale.
On est désormais raccord sur le fond. En revanche, je maintiens mes réserves sur la forme choisie qui reste à mes yeux excessivement grandiloquente et clinquante
Dernière édition par Shunt le 16 Jan 2013, 22:59, édité 1 fois.
- Shunt
- Messages: 15282
- Inscription: 21 Fév 2003, 11:58
- Localisation: Lilleshire
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Rainier a écrit:Oui c'est bien beau tout ça ..mais le dinosaure, il vient faire quoi là dedans ?
Je crois que cette séquence est censée illustrer le miracle de la compassion. Pour ma part, je trouve cette séquence un peu ridicule. L'idée même qu'un prédateur puisse éprouver de la compassion pour sa proie est déjà assez étrange en soi (mais bon, si la compassion relève du miracle pourquoi pas)... le problème ici, c'est qu'on est à la limite du grotesque, voire de l'absurde... d'une, on peut penser que cet animal agonisant est malade et que le prédateur, logiquement, ne souhaite pas se repaître d'un individu malade... on serait donc davantage dans l'instinct de survie que dans la compassion (à moins qu'il ne s'agisse d'un charognard... mais alors qu'un charognard puisse éprouver une quelconque compassion devant un être qui souffre, c'est du délire complet)... de deux, quand bien même ce prédateur éprouverait de la compassion pour sa proie, il ne fait que lui tourner le dos et le laisse quad même crever dans son coin
- Shunt
- Messages: 15282
- Inscription: 21 Fév 2003, 11:58
- Localisation: Lilleshire
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Shunt a écrit:Rainier a écrit:Oui c'est bien beau tout ça ..mais le dinosaure, il vient faire quoi là dedans ?
Je crois que cette séquence est censée illustrer le miracle de la compassion. Pour ma part, je trouve cette séquence un peu ridicule. L'idée même qu'un prédateur puisse éprouver de la compassion pour sa proie est déjà assez étrange en soi (mais bon, si la compassion relève du miracle pourquoi pas)... le problème ici, c'est qu'on est à la limite du grotesque, voire de l'absurde... d'une, on peut penser que cet animal agonisant est malade et que le prédateur, logiquement, ne souhaite pas se repaître d'un individu malade... on serait donc davantage dans l'instinct de survie que dans la compassion (à moins qu'il ne s'agisse d'un charognard... mais alors qu'un charognard puisse éprouver une quelconque compassion devant un être qui souffre, c'est du délire complet)... de deux, quand bien même ce prédateur éprouverait de la compassion pour sa proie, il ne fait que lui tourner le dos et le laisse quad même crever dans son coin
Oui j'ai aussi trouvé cette scéne ridicule et en décalage avec le reste du film.
C'est donner des sentiments humains à des animaux peu évolués (des reptiles).
Seul un être humain peut avoir de la compassion, comme seul un être humain peut avoir de la cruauté.
Un animal tue pour se nourrir ou pour défendre son territoire ou sa vie (ou celle de ses petits)... avoir de la compassion dans un tel cas, c'est quoi ? faire la greve de la faim ou se suicider !
Quand j'ai vu la scéne, j'ai plus penser à du mépris qu'à de la compassion.
Je pense (mais qui suis je pour dire cela ? je ne connais rien au cinéma
la démocratie et la souveraineté nationale sont comme l’avers et le revers d’une même médaille.
-

Rainier - Messages: 16919
- Inscription: 26 Mar 2003, 22:46
- Localisation: Guyancourt for ever
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Il parait que Django Unchained, le dernier film de Tarantino, c'est vachement bien.
C'est vrai ce mensonge?
C'est vrai ce mensonge?
- Ouais_supère
- Messages: 25803
- Inscription: 20 Juil 2005, 11:54
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Venant de Tarantino on peut redouter le pire.
- Cortese
- dieu
- Messages: 33533
- Inscription: 23 Fév 2003, 20:32
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Ouais_supère a écrit:Il parait que Django Unchained, le dernier film de Tarantino, c'est vachement bien.
C'est vrai ce mensonge?
Je vais probablement le voir cette semaine.
"La citoyenneté réduite au droit du sang consiste à dire que la République est génétique et non pas spirituelle", Waddle, 2013.
Mon blog
Mon blog
-

Waddle - Enculeur de moucheS
- Messages: 24109
- Inscription: 10 Mai 2003, 18:05
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Je lirai avec attention ton opinion là-dessus, j'ai l'impression que la critique est assez unanimement "pour" ce film, ce qui m'a surpris.
- Ouais_supère
- Messages: 25803
- Inscription: 20 Juil 2005, 11:54
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Je vais le voir ce soir, et je dois dire qu'associer "Tarantino" à "western spaghetti", ça me fait saliver d'avance.
Si j'avais souvent répété que je désirais mourir dans mon lit, ce que je voulais vraiment dire par là, c'est que je voulais me faire marcher dessus par un éléphant pendant que je ferais l'amour. Les Fusils d'Avalon, Roger Zelazny.
-

sheon - Léon Raoul
- Messages: 23761
- Inscription: 03 Juin 2010, 16:55
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Ouais_supère a écrit:Je lirai avec attention ton opinion là-dessus, j'ai l'impression que la critique est assez unanimement "pour" ce film, ce qui m'a surpris.
Franchement, je n'y connais rien en ciné, je suis un bon ignare. J'ai du mal à voir plus loin que le scénario, l'histoire, la crédibilité des personnages.
Mais si tu veux, je donnerais mon avis quand même.
"La citoyenneté réduite au droit du sang consiste à dire que la République est génétique et non pas spirituelle", Waddle, 2013.
Mon blog
Mon blog
-

Waddle - Enculeur de moucheS
- Messages: 24109
- Inscription: 10 Mai 2003, 18:05
Re: La séquence du spectateur - TOPIC CINEMA
Ce sera déjà largement suffisant.
- Ouais_supère
- Messages: 25803
- Inscription: 20 Juil 2005, 11:54
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Ahrefs [Bot] et 14 invités



