How have we lost the eternal?
Modérateurs: Garion, Silverwitch
How have we lost the eternal?
Les critiques des films de Kubrick n'étaient pas très bonnes non plus. Ses films ont souvent été mal reçus.
- Shunt
- Messages: 15282
- Inscription: 21 Fév 2003, 11:58
- Localisation: Lilleshire
How have we lost the eternal?
Je viens de voir le dernier Malick, et je suis très mitigé.
Mitigé parce que finalement, Malick fait du Malick (avec des séquences absolument sublimes), et surtout donne parfois l'impression de s'auto-parodier. Là où le questionnement sur Dieu était amené par petites touches et avec une grace infinie dans ses précédents films, ici, il a sorti le stabilo boss, notamment dans un final new-age complétement loupé.
Loupée également, la partie "création". Certains osent la comparaison avec "2001" de Kubrick, moi, j'avais le sentiment d'être devant un docu de France 3, style "La Terre des Dinosaures".
Mitigé parce que finalement, Malick fait du Malick (avec des séquences absolument sublimes), et surtout donne parfois l'impression de s'auto-parodier. Là où le questionnement sur Dieu était amené par petites touches et avec une grace infinie dans ses précédents films, ici, il a sorti le stabilo boss, notamment dans un final new-age complétement loupé.
Loupée également, la partie "création". Certains osent la comparaison avec "2001" de Kubrick, moi, j'avais le sentiment d'être devant un docu de France 3, style "La Terre des Dinosaures".
- Ambrose
- ça c'est fort de fruits !
- Messages: 8450
- Inscription: 15 Fév 2009, 21:55
How have we lost the eternal?
Moi je redoutais cette scène sur le
Texte caché : cliquez sur le cadre pour l'afficher
Peut-être parce que j'ai considéré cela comme le voyage spirituel d'un personnage, avec un imaginaire nourri donc de sa culture, et non comme des choses que voulait asséner Malick**
Pourquoi après tout la spiritualité de Jack ou de Mrs O'Brien serait elle moins légitime parce que chrétienne que celle de Pocahontas parce que panthéiste. Pocahontas était-elle finalement moins habitée?
Je crois même que les voix intérieures se font plus rare que dans Le Nouveau Monde. Mais qu'elles semblent moins admissibles à certains spectateurs (notamment européens) parce que l'adresse au divin semble cette fois chrétienne. Et ce bien que pourtant à aucun moment le vocabulaire ne sorte fondamentalement de l'oecuménisme d'une adresse à l'univers. Et que c'est le Texte caché : cliquez sur le cadre pour l'afficher
Quant aux scènes de la création malgré le fait qu'elles sont bien plus courte dans ce montage* raccourci, il reste que le questionnement (que je veux éviter de révéler ici avant quelques semaines) donnent à ces scènes une puissance singulière.
Malick est sur un mince fil de grâce et qui que ce soit d'autre en tomberait.
Et même avec ses possibles maladresses, il délivre un film dont assurément on parlera longtemps, et dont la portée indéniable sur le langage filmique est encore à mesurer.
Et qui d'autre est parvenu à insuffler et capter tant de justesse, de spontanéité, de naturel dans le jeu d'enfants au point que jamais il ne semble qu'ils jouent un rôle
Hugues
*: (je présume que le montage initial, plus long, sortira en vidéo, comme il en a la possibilité et développera infiniment plus l'aspect mort de l'univers, l'aspect de création et de naissance éternelle, illustré par le fait que notre univers n'est qu'un parmi d'autres [je publierai ces magnifiques textes en temps voulu ], qui a été produit et monté avant une pression des distributeur pour un raccourcissement)
], qui a été produit et monté avant une pression des distributeur pour un raccourcissement)
**: d'ailleurs le souci de Malick permanent était vraiment que son film puisse être vu par chacun comme une histoire humaine, sa propre histoire, d'où qu'il vienne et quoi qu'il croit.
, parce que c'était ce qui me semblait le plus difficile à mettre en image, à enchainer avec le reste du film. Or, malgré mes appréhensions elle ne m'a pas choquée.
Peut-être parce que j'ai considéré cela comme le voyage spirituel d'un personnage, avec un imaginaire nourri donc de sa culture, et non comme des choses que voulait asséner Malick**
Pourquoi après tout la spiritualité de Jack ou de Mrs O'Brien serait elle moins légitime parce que chrétienne que celle de Pocahontas parce que panthéiste. Pocahontas était-elle finalement moins habitée?
Je crois même que les voix intérieures se font plus rare que dans Le Nouveau Monde. Mais qu'elles semblent moins admissibles à certains spectateurs (notamment européens) parce que l'adresse au divin semble cette fois chrétienne. Et ce bien que pourtant à aucun moment le vocabulaire ne sorte fondamentalement de l'oecuménisme d'une adresse à l'univers. Et que c'est le Texte caché : cliquez sur le cadre pour l'afficher
qui achève de donner cette fausse impression de nuance moindre, de trop de lyrisme, que tu décris.
Quant aux scènes de la création malgré le fait qu'elles sont bien plus courte dans ce montage* raccourci, il reste que le questionnement (que je veux éviter de révéler ici avant quelques semaines) donnent à ces scènes une puissance singulière.
Malick est sur un mince fil de grâce et qui que ce soit d'autre en tomberait.
Et même avec ses possibles maladresses, il délivre un film dont assurément on parlera longtemps, et dont la portée indéniable sur le langage filmique est encore à mesurer.
Et qui d'autre est parvenu à insuffler et capter tant de justesse, de spontanéité, de naturel dans le jeu d'enfants au point que jamais il ne semble qu'ils jouent un rôle
Hugues
*: (je présume que le montage initial, plus long, sortira en vidéo, comme il en a la possibilité et développera infiniment plus l'aspect mort de l'univers, l'aspect de création et de naissance éternelle, illustré par le fait que notre univers n'est qu'un parmi d'autres [je publierai ces magnifiques textes en temps voulu
**: d'ailleurs le souci de Malick permanent était vraiment que son film puisse être vu par chacun comme une histoire humaine, sa propre histoire, d'où qu'il vienne et quoi qu'il croit.
- Hugues
How have we lost the eternal?
Une scène tout juste mise en ligne. De toute celle dévoilée, sans doute celle la plus à même de rappeler, que nous sommes face à l'auteur de Days of Heaven. Et la plus fidèle peut-être au film dans son ensemble.
You Spoke To Me
Quelques mots toujours en anglais, à des amis d'outre-atlantique.
Certains écrits avant de revoir ce clip, sur les ravages de l'oubli, sur un film si difficile à intellectualiser sur la première vision, qu'il n'est après celle-ci presque qu'impressions. Or les impressions sont si fragiles face à l'oubli. (Plus bas d'autres mots écrits après avoir revu ce
Texte caché : cliquez sur le cadre pour l'afficher
Puis d'autres mots écrits après avoir revu cette scène. Sur le fait qu'elle est un étalon, une bouée pour ne pas succomber au piège de l'oubli.
Texte caché : cliquez sur le cadre pour l'afficher
Hugues
You Spoke To Me
Quelques mots toujours en anglais, à des amis d'outre-atlantique.
Certains écrits avant de revoir ce clip, sur les ravages de l'oubli, sur un film si difficile à intellectualiser sur la première vision, qu'il n'est après celle-ci presque qu'impressions. Or les impressions sont si fragiles face à l'oubli. (Plus bas d'autres mots écrits après avoir revu ce
Texte caché : cliquez sur le cadre pour l'afficher
Puis d'autres mots écrits après avoir revu cette scène. Sur le fait qu'elle est un étalon, une bouée pour ne pas succomber au piège de l'oubli.
Texte caché : cliquez sur le cadre pour l'afficher
Hugues
- Hugues
How have we lost the eternal?
Je suis impatient de lire les commentaires de Shunt et de Silver.
- Ambrose
- ça c'est fort de fruits !
- Messages: 8450
- Inscription: 15 Fév 2009, 21:55
How have we lost the eternal?
Ambrose a écrit:Je suis impatient de lire les commentaires de Shunt et de Silver.
Pas vu. Je viens de me fader "Entre les Murs", palme d'or 2008, et bien c'est une sacrée arnaque ! Et "Looking for Eric", qui est un petit film bien sympa.
- Shunt
- Messages: 15282
- Inscription: 21 Fév 2003, 11:58
- Localisation: Lilleshire
How have we lost the eternal?
Ambrose a écrit:Je viens de voir le dernier Malick, et je suis très mitigé.
Mitigé parce que finalement, Malick fait du Malick (avec des séquences absolument sublimes), et surtout donne parfois l'impression de s'auto-parodier. Là où le questionnement sur Dieu était amené par petites touches et avec une grace infinie dans ses précédents films, ici, il a sorti le stabilo boss, notamment dans un final new-age complétement loupé.
Loupée également, la partie "création". Certains osent la comparaison avec "2001" de Kubrick, moi, j'avais le sentiment d'être devant un docu de France 3, style "La Terre des Dinosaures".
Je l'ai vu hier, et je n'ai absolument rien compris
J'étais frustré car j'avais bien conscience d'avoir devant moi un bijou mais vraiment, en toute humilité, je n'ai rien capté!
Pas vu le rapport entre toutes les images de la création et cette famille un peu complexe qui pleure un fils, avec un père autoritaire, violent et doux à la fois.
Pas compris tous ces aller-retours dans dans le temps, et, même pas compris ce qu'il voulait faire comprendre avec la vie des enfants.
Même pas vraiment sur d'avoir compris la scène finale...
On était environ 80 dans la salle, et il y en a au moins 10 qui sont partis avant l'heure...
"La citoyenneté réduite au droit du sang consiste à dire que la République est génétique et non pas spirituelle", Waddle, 2013.
Mon blog
Mon blog
-

Waddle - Enculeur de moucheS
- Messages: 24109
- Inscription: 10 Mai 2003, 18:05
How have we lost the eternal?
Plus je lis les critiques, moins j'ai envie d'aller voir ce film 
Je me dis que j'avais bien aimé 2001 odyssée de l'espace alors que personne ne peut comprendre les dernières scénes du film sans lire toutes les théories explicatives (et fumeuses) sur le Net !
Je me dis que j'avais bien aimé 2001 odyssée de l'espace alors que personne ne peut comprendre les dernières scénes du film sans lire toutes les théories explicatives (et fumeuses) sur le Net !
la démocratie et la souveraineté nationale sont comme l’avers et le revers d’une même médaille.
-

Rainier - Messages: 16919
- Inscription: 26 Mar 2003, 22:46
- Localisation: Guyancourt for ever
How have we lost the eternal?
Rainier a écrit:Plus je lis les critiques, moins j'ai envie d'aller voir ce film
Je ne crois pas qu'il faille lire les critiques et particulièrement celles (plutôt minoritaires) qui le démonte car je ne suis pas certain que ces gens y aient vu la profondeur qui y réside.
C'est un film qui se décante en soi longtemps après l'avoir vu. Tant il est d'une richesse insoupçonnée. Pour moi cela commence à peine. Derrière la symphonie visuelle et sonore, lorsque le tourbillon d'émotion retombe (car jamais le déluge des sens n'a été tel chez Malick, je crois), même si l'on pensait l'avoir en partie compris, on découvre peu à peu des strates insoupçonnée.
Je vais essayer de résumer cet après-midi ce que j'ai pu répondre jusque là à Waddle dans une discussion que nous avons en privé, Waddle dont je crois l'opinion n'est pas négative au contraire.
Hugues
- Hugues
How have we lost the eternal?
J'ai pas encore eu le temps d'y aller, mais j'irai dès que possible. Il y a déjà la beauté des images, même si je trouve que l'esthétique un peu maniériste de Malick est assez prévisible. Et si le scénario est incompréhensible ça ne me dérange pas tellement, on peut laisser son imagination vagabonder autour de jolis plans se succédant sans ordre apparent. C'est toujours mieux que toutes les histoires assommantes d'ennui que nous assène d'habitude le cinéma. On est loin de la vigueur sophistiquée de Kubrick avec Malick à mon avis, mais c'est sans doute ce qui se fait de mieux actuellement.
- Cortese
- dieu
- Messages: 33533
- Inscription: 23 Fév 2003, 20:32
How have we lost the eternal?
Hugues a écrit:Rainier a écrit:Plus je lis les critiques, moins j'ai envie d'aller voir ce film
Je ne crois pas qu'il faille lire les critiques et particulièrement celles (plutôt minoritaires) qui le démonte car je ne suis pas certain que ces gens y aient vu la profondeur qui y réside.
En lisant une compile des critiques, j'ai quand même l'impression que mon opinion n'est pas minoritaire et que beaucoup ont vu comme moi des moments d'une beauté extrème, gachés par une sorte de gloubi boulga philosophico-théologique.
Cela dit, moi je conseille quand même d'aller voir ce film, justement pour ces instants de magie qu'on ne retrouve que chez Mallick (même si comme dit Cortese, ça confine au maniériste et que l'effet de surprise ne joue plus).
- Ambrose
- ça c'est fort de fruits !
- Messages: 8450
- Inscription: 15 Fév 2009, 21:55
How have we lost the eternal?
Hugues a écrit:Rainier a écrit:Plus je lis les critiques, moins j'ai envie d'aller voir ce film
Je ne crois pas qu'il faille lire les critiques et particulièrement celles (plutôt minoritaires) qui le démonte car je ne suis pas certain que ces gens y aient vu la profondeur qui y réside.
C'est un film qui se décante en soi longtemps après l'avoir vu. Tant il est d'une richesse insoupçonnée. Pour moi cela commence à peine. Derrière la symphonie visuelle et sonore, lorsque le tourbillon d'émotion retombe (car jamais le déluge des sens n'a été tel chez Malick, je crois), même si l'on pensait l'avoir en partie compris, on découvre peu à peu des strates insoupçonnée.
Je vais essayer de résumer cet après-midi ce que j'ai pu répondre jusque là à Waddle dans une discussion que nous avons en privé, Waddle dont je crois l'opinion n'est pas négative au contraire.
Hugues
Non, mon opinion n'est pas négative, c'est clair.
Je suis juste frustré de ne pas avoir tout saisi. Mais ca va venir.
"La citoyenneté réduite au droit du sang consiste à dire que la République est génétique et non pas spirituelle", Waddle, 2013.
Mon blog
Mon blog
-

Waddle - Enculeur de moucheS
- Messages: 24109
- Inscription: 10 Mai 2003, 18:05
How have we lost the eternal?
Ambrose a écrit:Hugues a écrit:Rainier a écrit:Plus je lis les critiques, moins j'ai envie d'aller voir ce film
Je ne crois pas qu'il faille lire les critiques et particulièrement celles (plutôt minoritaires) qui le démonte car je ne suis pas certain que ces gens y aient vu la profondeur qui y réside.
En lisant une compile des critiques, j'ai quand même l'impression que mon opinion n'est pas minoritaire et que beaucoup ont vu comme moi des moments d'une beauté extrème, gachés par une sorte de gloubi boulga philosophico-théologique.
Cela dit, moi je conseille quand même d'aller voir ce film, justement pour ces instants de magie qu'on ne retrouve que chez Mallick (même si comme dit Cortese, ça confine au maniériste et que l'effet de surprise ne joue plus).
Sur les critiques en langue anglaise, RottenTomatoes dénombre 88% de critiques positives tandis que MetaCritic estime une note de 93%. Bon en même temps Rottentomatoes dénombrait 61% de critiques positives pour Le Nouveau Monde (et là Cortese dit "ah non c'est assez juste !")
Sur les critiques françaises, je n'ai pas fait de décompte, mais il y a certaines critiques si enthousiastes, si inspirées et si argumentées qu'elles compensent largement et font perdre toute crédibilité (à mes yeux, ça n'engage que moi) à la plus sévère des critiques ( notamment une dénommée "Le nanar de la compete" où à mon avis le gars doit se recycler)
Hugues
- Hugues
How have we lost the eternal?
Un premier semblant de regard sur le film:
Texte caché : cliquez sur le cadre pour l'afficher
Hugues
PS: Texte caché : cliquez sur le cadre pour l'afficher
Texte caché : cliquez sur le cadre pour l'afficher
Hugues
PS: Texte caché : cliquez sur le cadre pour l'afficher
- Hugues
How have we lost the eternal?
J'ai sans doute pas percuté mais pourquoi mettre des textes cachés partout Hugues??
scc
THE ITALIAN GUY...
"...elles donnent beaucoup de lait vos chèvres mon brave? Les blanches donnent beaucoup de lait...et les noirrres aussi..."
THE ITALIAN GUY...
"...elles donnent beaucoup de lait vos chèvres mon brave? Les blanches donnent beaucoup de lait...et les noirrres aussi..."
-
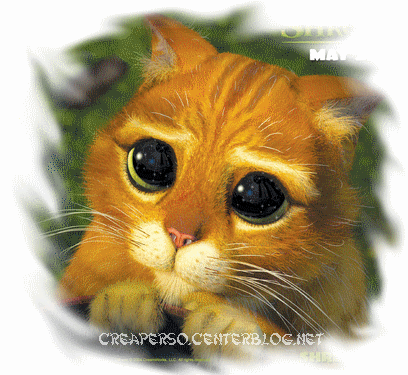
sccc - Messages: 20255
- Inscription: 22 Fév 2003, 19:32
- Localisation: Belgique
How have we lost the eternal?
Hugues,
Je me souviens d'une discussion il y a quelques années entre Shunt et Silver sur je ne sais plus quel film que Shunt avait aimé. Shunt défendait son avis de manière très argumentée, en volant tel symbolisme dans telle scène, telle allusion dans une autre séquence. Et Silver lui avait répondu : "attention Shunt, je crois que ta critique est plus intelligente que le film".
Je pense que tu tombes un peu dans le même travers. Que le film regorge d'allusions (pour la plupart invisibles du commun des mortels car on a pas tous un Master de philo) qui démontre la très grande culture du cinéaste, n'est pas suffisant pour en faire un grand film. Non, c'est pas un nanar, mais un film dont le propos se limite grosso modo à "Dieu est partout, dans le sourire d'une mère comme dans le big bang", c'est un peu short.
Je me souviens d'une discussion il y a quelques années entre Shunt et Silver sur je ne sais plus quel film que Shunt avait aimé. Shunt défendait son avis de manière très argumentée, en volant tel symbolisme dans telle scène, telle allusion dans une autre séquence. Et Silver lui avait répondu : "attention Shunt, je crois que ta critique est plus intelligente que le film".
Je pense que tu tombes un peu dans le même travers. Que le film regorge d'allusions (pour la plupart invisibles du commun des mortels car on a pas tous un Master de philo) qui démontre la très grande culture du cinéaste, n'est pas suffisant pour en faire un grand film. Non, c'est pas un nanar, mais un film dont le propos se limite grosso modo à "Dieu est partout, dans le sourire d'une mère comme dans le big bang", c'est un peu short.
- Ambrose
- ça c'est fort de fruits !
- Messages: 8450
- Inscription: 15 Fév 2009, 21:55
How have we lost the eternal?
Ouais, ben n'empêche que je me tape un gros complexe d'infériorité intellectuelle, là, et du coup je ne sais même pas si je vais aller le voir tellement j'ai peur de ne rien saisir de tout ça.
- Ouais_supère
- Messages: 25812
- Inscription: 20 Juil 2005, 11:54
How have we lost the eternal?
C'est là que tu vois que les élites politico-journalistico-culturelle ont encore de belles années devant elle.
- Neoflo
- Messages: 2531
- Inscription: 25 Fév 2003, 00:58
- Localisation: Meudon, France
How have we lost the eternal?
Neoflo a écrit:C'est là que tu vois que les élites politico-journalistico-culturelle ont encore de belles années devant elle.
Et c'est quoi le rapport ?
- Ambrose
- ça c'est fort de fruits !
- Messages: 8450
- Inscription: 15 Fév 2009, 21:55
How have we lost the eternal?
Pareil...Ouais_supère a écrit:Ouais, ben n'empêche que je me tape un gros complexe d'infériorité intellectuelle, là, et du coup je ne sais même pas si je vais aller le voir tellement j'ai peur de ne rien saisir de tout ça.
-

Maverick - Bête de sexe
- Messages: 41547
- Inscription: 22 Fév 2003, 00:02
- Localisation: Dans ton cul !!
How have we lost the eternal?
Maverick a écrit:Pareil...Ouais_supère a écrit:Ouais, ben n'empêche que je me tape un gros complexe d'infériorité intellectuelle, là, et du coup je ne sais même pas si je vais aller le voir tellement j'ai peur de ne rien saisir de tout ça.
C'est des conneries ça. Le cinéma de Mallick, c'est pas du cinéma "intello", c'est au contraire quelque chose d'extrèmement sensoriel.
- Ambrose
- ça c'est fort de fruits !
- Messages: 8450
- Inscription: 15 Fév 2009, 21:55
How have we lost the eternal?
Ambrose a écrit:Neoflo a écrit:C'est là que tu vois que les élites politico-journalistico-culturelle ont encore de belles années devant elle.
Et c'est quoi le rapport ?
Tu as raison, c'est plutôt mal formulé. Le fait que ce genre de film doit particulièrement être apprécié dans un certain type de salons parisiens par exemple, et encensé par un certain type de critique ne doit pas influencé le jugement, c'etait donc une mauvaise formulation.
Je connais pas Malick, j'ai donc aucune idée réelle ou presque de ce pourquoi il a fait ce film et ce qu'il souhaite y représenter ... mais de l'extérieur en tout cas, sur les diverses critiques lu ici et là, il y a énormément de choses qui me dérange, dans ce film et son approche.
Déjà, il est évident, que la notion même de film qui serait incompréhensible pour un "commun des mortels" tel que certains nous le présentent, film qui nécessiterait donc des explications avant même d'avoir été vu, est bien sur un point génant, tant le cheminement qui doit mener sur ce type de questionnement doit être une recherche personnelle avant tout.
Ensuite, il apparait clair que ce film souhaite interroger les spectateurs, dans un sens philosophique, en gros sur ce que j'ai lu de Hughes, sur le "pourquoi". Il y a plein de choses qui me rendent particulièrement sceptique sur la notion même de se poser des questions philosophiques dans un film :
Déjà la notion d'image me semble difficile à prendre en compte pour un questionnement intérieur, tant elle monopolise l'attention du sujet et donc lui empeche de se questionner durant cela. En gros, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment un film, donc des images peut avoir un aspect philosophique important, et ceci malgré le rythme lent qui semble présent dans le film (encore heureux !
Ensuite, en plus de l'image, le principe de film, c'est à dire une histoire qui se déroule avec une chronologie, me semble contradictoire, avec des notions philosophiques qui nécessitent des questionnements, des éclaircissements, et donc une notion de possibilité de pause, de relecture, de réetude, voir bien sur une notion de retour en arrière. Chose qui semble incompatible avec la notion de film, encore plus un film au cinéma.
Enfin, je trouve que traiter d'un si vaste questionnement en un film de à peine 2h, me semble tellement utopique, qu'il me fait forcément m'interroger sur le bien fondé de ces interrogations, et des ambitions philosophiques profondes de l'auteur.
Voila, donc en fait c'etait plus une reflexion sur la réelle portée philosophique de ce film, tel qu'il nous ait vendu par certaines critiques et autres plutot qu'une critique même si la notion de film tellement "profond" qu'il serait incompréhensible pour certains, me semble contradictoire avec ce que l'auteur semble souhaité.
Ah oui par contre, le fait que certains ait le sentiment de se sentir intellectuellement incapable de faire "face", de comprendre ce film, pour moi c'est extrenement dérangeant dans la notion de réussite de film.
Aucune culture / notion / interrogation ne devrait être inaccessible.
- Neoflo
- Messages: 2531
- Inscription: 25 Fév 2003, 00:58
- Localisation: Meudon, France
How have we lost the eternal?
Je compte aller le voir, je verrai bien.Ambrose a écrit:Maverick a écrit:Pareil...Ouais_supère a écrit:Ouais, ben n'empêche que je me tape un gros complexe d'infériorité intellectuelle, là, et du coup je ne sais même pas si je vais aller le voir tellement j'ai peur de ne rien saisir de tout ça.
C'est des conneries ça. Le cinéma de Mallick, c'est pas du cinéma "intello", c'est au contraire quelque chose d'extrèmement sensoriel.
-

Maverick - Bête de sexe
- Messages: 41547
- Inscription: 22 Fév 2003, 00:02
- Localisation: Dans ton cul !!
How have we lost the eternal?
Ambrose a écrit:Maverick a écrit:Pareil...Ouais_supère a écrit:Ouais, ben n'empêche que je me tape un gros complexe d'infériorité intellectuelle, là, et du coup je ne sais même pas si je vais aller le voir tellement j'ai peur de ne rien saisir de tout ça.
C'est des conneries ça. Le cinéma de Mallick, c'est pas du cinéma "intello", c'est au contraire quelque chose d'extrèmement sensoriel.

Absolument d'accord.
Et puis, mon regard sur le film n'est pas si compliqué que ça, ce sont des thèmes simples assimilables par n'importe qui (ce n'est pas parce que je parle de Dostoievski ou n'importe quel autre penseur parce qu'il a su le mieux exprimer ces thèmes qu'ils sont compliqués). Ces personnes, on les cite parce qu'elles sont su surtout rendre dicibles des interrogations ineffables qui étaient en chacun d'entre nous.
Ce que je voulais y montrer c'est que le propos de Malick, les propos en ses voix off, est loin d'être une bouillie informe comme on a pu le lire parfois (en fait la critique sur ce point se fait de plus en plus forte à chaque film depuis son retour en 1998). Malick derrière un torrent sensoriel (car celui-ci mérite ce titre tout autant que le Nouveau Monde) et une histoire simple qui s'apprécient à eux seul, indépendamment du reste, aborde consciemment ou inconsciemment, tout un pan de la philosophie.
C'est ce qui rend une oeuvre universelle, et plus bouleversante encore.
Hugues
- Hugues
How have we lost the eternal?
sccc a écrit:J'ai sans doute pas percuté mais pourquoi mettre des textes cachés partout Hugues??
Parce que comme je crains d'y laisser passer des spoilers (et j'en laisse passer parfois) , je préfère être prudent.
Hugues
- Hugues
How have we lost the eternal?
Ambrose a écrit:"Dieu est partout, dans le sourire d'une mère comme dans le big bang", c'est un peu short.
Et même si ce n'était que ça, n'est-ce pas beaucoup, de percevoir de nouveau le miracle présent en chaque seconde au delà de l'urgence de nos vies. Après tout c'était déjà la chose à laquelle nous incitait Pocahontas dans le Nouveau Monde, voir à chaque regard le monde comme recommencé.
Dostoievski justement écrivait :
" Oui, l'homme a la vie dure ! Un être qui s'habitue à tout. Voilà, je pense, la meilleure définition qu'on puisse donner de l'homme. "
S'habituer à la vie, à l'existence, ne plus y voir finalement quelque chose de divin, de miraculeux, n'est-ce pas ce qui nous perd ?
Aussi plus que jamais je crois que ces phrases de Malick des premières pages de son scénario, citées en début de sujet, sont plus que jamais vraies:
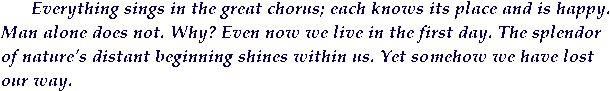
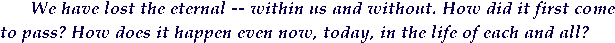
Hugues
- Hugues
How have we lost the eternal?
Hugues a écrit:Ambrose a écrit:"Dieu est partout, dans le sourire d'une mère comme dans le big bang", c'est un peu short.
Et même si ce n'était que ça, n'est-ce pas beaucoup, de percevoir de nouveau le miracle présent en chaque seconde au delà de l'urgence de nos vies. Après tout c'était déjà la chose à laquelle nous incitait Pocahontas dans le Nouveau Monde, voir à chaque regard le monde comme recommencé.
Non, je trouve que c'est trop peu car le propos du film se limite à ça. Alors que dans "Le Nouveau Monde" et aussi dans le "La Ligne Rouge" où on retrouvait déjà cet émerveillement dans les voix off ("Qui es-tu pour vivre sous des formes aussi diverses ?"), il y avait tant d'autres choses.
Ce qui dans ses films précédents n'était qu'un thème parmi d'autres, est devenu dans "The Tree of Life" son unique propos. Je trouve ça décevant. Tout comme je trouve décevant (limite inquiétant même) que cette question de la foi, abordée de manière si subtile dans ses films précédents, vire désormais au prosélytisme.
- Ambrose
- ça c'est fort de fruits !
- Messages: 8450
- Inscription: 15 Fév 2009, 21:55
How have we lost the eternal?
vais le voir ce soir en compagnie d'une très jolie eurasienne.
- Solal
- mec sérieux
- Messages: 9046
- Inscription: 06 Mai 2003, 11:40
- Localisation: Cape Town, SA
How have we lost the eternal?
Ambrose a écrit:Non, je trouve que c'est trop peu car le propos du film se limite à ça. Alors que dans "Le Nouveau Monde" et aussi dans le "La Ligne Rouge" où on retrouvait déjà cet émerveillement dans les voix off ("Qui es-tu pour vivre sous des formes aussi diverses ?"), il y avait tant d'autres choses.
Mais il y a tant d'autres choses, tu sous-estimes la richesse du récit familial.
Ce qui dans ses films précédents n'était qu'un thème parmi d'autres, est devenu dans "The Tree of Life" son unique propos. Je trouve ça décevant. Tout comme je trouve décevant (limite inquiétant même) que cette question de la foi, abordée de manière si subtile dans ses films précédents, vire désormais au prosélytisme.
Ca n'est pas l'unique propos. (Mais ça j'ai bien compris nous sommes en désaccord.
Quant au fait que tu parles de prosélytisme... A nouveau Pocahontas est-elle moins habitée par sa spiritualité? Tu n'as pas vu de prosélytisme devant un panthéisme disparu, me semble-t-il. Peut-être justement parce qu'il est disparu. En tout cas tu l'as vu en spectateur. La foi chrétienne des personnages de ce récit peut être vu de ce même regard de spectateur. En fait même le vocabulaire est très oecuménique et ne s'identifie au vocabulaire chrétien, ou plus largement des trois religions d'Abraham que bien rarement. Ce récit, Malick aurait pu le faire en Virginie au XVIe siècle dans la société Powhatan cela n'aurait rien changé.
J'ai le sentiment que ce reproche chez certains (je ne parle pas de toi ici) est en fait plus révélateur d'un sentiment conflictuel de ceux qui s'expriment ainsi, envers la religion chrétienne, que d'un véritable dérapage de Malick.
Hugues
- Hugues
How have we lost the eternal?
Hugues a écrit:Ambrose a écrit:Ce qui dans ses films précédents n'était qu'un thème parmi d'autres, est devenu dans "The Tree of Life" son unique propos. Je trouve ça décevant. Tout comme je trouve décevant (limite inquiétant même) que cette question de la foi, abordée de manière si subtile dans ses films précédents, vire désormais au prosélytisme.
Quant au fait que tu parles de prosélytisme... A nouveau Pocahontas est-elle moins habitée par sa spiritualité? Tu n'as pas vu de prosélytisme devant un panthéisme disparu, me semble-t-il. Peut-être justement parce qu'il est disparu. En tout cas tu l'as vu en spectateur. La foi chrétienne des personnages de ce récit peut être vu de ce même regard de spectateur. En fait même le vocabulaire est très oecuménique et ne s'identifie au vocabulaire chrétien, ou plus largement des trois religions d'Abraham que bien rarement. Ce récit, Malick aurait pu le faire en Virginie au XVIe siècle dans la société Powhatan cela n'aurait rien changé.
Je trouve qu'il y a une très grande différence entre filmer un personnage qui croit en Dieu ou peu importe comment elle l'appelle (je parle de Pocahontas) et assener directement sa foi au spectateur.
Dans le premier cas, il y a une distance, un recul. Qui n'existent pas dans le second cas.
Quand Mallick filme la plage-paradis avec toute la famille qui se réunit, il ne se contente pas de traduire les croyances d'un personnage, il filme ses croyances à lui, et ça me met un peu mal à l'aise car j'ai l'impression de me retrouver face à un de ses prédicateurs américains un peu illuminés.
- Ambrose
- ça c'est fort de fruits !
- Messages: 8450
- Inscription: 15 Fév 2009, 21:55
How have we lost the eternal?
Je l'ai revu ce matin. Quel monument...
Texte caché : cliquez sur le cadre pour l'afficher
Hugues
Texte caché : cliquez sur le cadre pour l'afficher
Hugues
- Hugues
How have we lost the eternal?
Palme d'Or pour "The Tree of Life".
Mais Terrence Mallick aurait été vu en train de diner avec Luc Besson ces derniers jours (c'est le gars de Canal+ qui le dit). C'est le début de la déchéance.
Mais Terrence Mallick aurait été vu en train de diner avec Luc Besson ces derniers jours (c'est le gars de Canal+ qui le dit). C'est le début de la déchéance.
- Ambrose
- ça c'est fort de fruits !
- Messages: 8450
- Inscription: 15 Fév 2009, 21:55
How have we lost the eternal?
Ça a l'air chiant comme la pluie, ce film. Rien que le titre, on dirait un téléfilm pour troisième âge avec Richard Chamberlain. Le genre de truc que regardait ma grand-mère en sirotant une verveine.
-

Lo - Messages: 4885
- Inscription: 28 Mar 2003, 18:40
How have we lost the eternal?
Lo a écrit:Ça a l'air chiant comme la pluie, ce film. Rien que le titre, on dirait un téléfilm pour troisième âge avec Richard Chamberlain. Le genre de truc que regardait ma grand-mère en sirotant une verveine.
Ca vaut pas un bon Fast & Furious, c clèr.
- Ambrose
- ça c'est fort de fruits !
- Messages: 8450
- Inscription: 15 Fév 2009, 21:55
How have we lost the eternal?
Je l'ai vu hier, bin, je sais pas, il m'a paru intéressant, avec une belle image, mais aussi lent dans le rythme et long. Après, il faudrait que je réfléchisse plus en profondeur pour le sens philosophique chrétien du film, effectivement très marqué. Je dois dire que j'ai mieux aimé le nouveau monde.
Didier
Didier
« Par exemple, le football, on y joue dans des endroits spéciaux. Il devrait y avoir des terrains de guerre pour ceux qui aiment mourir en plein air. Ailleurs on danserait et on rirait » (Roger Nimier)
- DCP
- 28 juin 2021 !
- Messages: 25717
- Inscription: 26 Fév 2003, 11:18
How have we lost the eternal?
Ambrose a écrit:Lo a écrit:Ça a l'air chiant comme la pluie, ce film. Rien que le titre, on dirait un téléfilm pour troisième âge avec Richard Chamberlain. Le genre de truc que regardait ma grand-mère en sirotant une verveine.
Ca vaut pas un bon Fast & Furious, c clèr.
GnaGnaGna...
Catéchisme + Brad Pitt c'est le repoussoir.
-

Lo - Messages: 4885
- Inscription: 28 Mar 2003, 18:40
How have we lost the eternal?
Ambrose a écrit:Palme d'Or pour "The Tree of Life".
Mais Terrence Mallick aurait été vu en train de diner avec Luc Besson ces derniers jours (c'est le gars de Canal+ qui le dit). C'est le début de la déchéance.
Europacorp, la société du gros Besson, distribue "The Tree of Life" en fait.
- Shunt
- Messages: 15282
- Inscription: 21 Fév 2003, 11:58
- Localisation: Lilleshire
How have we lost the eternal?
Lo a écrit:Ambrose a écrit:Lo a écrit:Ça a l'air chiant comme la pluie, ce film. Rien que le titre, on dirait un téléfilm pour troisième âge avec Richard Chamberlain. Le genre de truc que regardait ma grand-mère en sirotant une verveine.
Ca vaut pas un bon Fast & Furious, c clèr.
GnaGnaGna...
Catéchisme + Brad Pitt c'est le repoussoir.
Ce n'est pas parce que Brad Pitt est beau gosse et que les gonzesses hurlent son nom que c'est nécessairement un mauvais acteur. Bien dirigé (et c'est le cas dans ce film, comme ça l'était dans "L'Assassinat de Jesse James"), il peut être très bon.
Dernière édition par Ambrose le 22 Mai 2011, 21:39, édité 1 fois.
- Ambrose
- ça c'est fort de fruits !
- Messages: 8450
- Inscription: 15 Fév 2009, 21:55
How have we lost the eternal?
Je m'étais abstenu de relayer toute critique, je rompts momentanément cette prohibition:
Déjà Eric Neuhorf disait son enthousiasme lundi dernier:
Deux autres belles critiques publiées dans la semaine.
La première phrase a été changée, elle disait initialement, lors de la publication initiale : "The Tree of Life”, le cinquième film du plus rare et du plus génial des cinéastes en exercice, a divisé le public du 64e Festival..
Jupitérien, tellurique, voilà bien de beaux mots pour parler de son cinéma.
Hugues
Le Figaro a écrit:Terrence Malick, la palme de sa vie
Par Eric Neuhoff
22/05/2011 | Mise à jour : 20:54 Réagir
Le réalisateur américain est couronné pour son merveilleux film The Tree of Life.
La beauté remonte à la plus haute antiquité. Comment protéger ses enfants ? Apparemment, les dinosaures se posaient déjà la question.
Terrence Malick filme le big bang, des étoiles, des cascades, des volcans. La création du monde mène au drame d'une famille texane dans les années 50. D'emblée, domine une sensation tenace : Malick n'exerce pas le même métier que ses collègues. Ils veulent des oscars ; il peint les âmes.
Brad Pitt était un père peut-être un peu trop autoritaire, mais on n'oubliera pas la séquence où il essaie d'apprendre à boxer à ses fils. Marquera aussi le regard plein d'amertume et de regret qu'il jette sur son gamin jouant de la guitare. Lui voulait devenir pianiste : il est représentant de commerce. Surgit, au fil des images, la certitude que Dieu se réfugie dans un gazon humide de rosée, la cheville d'une épouse aspergée par un jet d'eau, un rideau blanc soulevé par le vent. On se croirait souvent dans des toiles d'Andrew Wyeth. La vie, la vie entière, se concentre dans ces 138 minutes. The tree of life est de la lave en fusion. La grâce habite cette mère quasi muette. C'est Jessica Chastain, de la très fine dentelle rousse.
Les acteurs sont comme illuminés de l'intérieur. Le film est un essai, un poème, une lettre d'amour, une prière. On ne sait pas si on en sort meilleur. En tout cas, on se sent différent. A marée basse, sur le sable mouillé, les vivants et les morts se retrouvent. Ils n'ont pas besoin de mots pour se dire tout ce qu'ils ont à se dire. Les mots, justement : il n'y en a pas assez pour exprimer tout le bien qu'on pense de ce chef d'œuvre.
Déjà Eric Neuhorf disait son enthousiasme lundi dernier:
Deux autres belles critiques publiées dans la semaine.
Valeurs Actuelles a écrit:La folie Malick
“The Tree of Life”, le cinquième film du plus rare et du plus génial des cinéastes en exercice, vient de recevoir la palme d'or au 64ième festival de Cannes. Un film fou, qui est un peu le “2001” mystique de ce créateur atypique.
Ils ne sont pas légion, les cinéastes capables sans ridicule de débuter un film par une paraphrase de l’Imitation de Jésus-Christ, au chapitre sur la nature et la grâce, juste après une citation du Livre de Job : « Où étais-tu quand je posais les fondements de la Terre ? » Terrence Malick, avec l’assurance sans faille qu’ont en partage les génies et les imbéciles, ose tout ; et c’est ainsi que The Tree of Life, le seulement cinquième film de ce cinéaste de 67 ans, s’ouvre sur la voix de Jessica Chastain, qui nous confie avoir appris chez les sœurs qu’« il y a deux voies dans l’existence : la voie de la nature et la voie de la grâce. Il vous faut choisir celle que vous suivrez ». Quiconque connaît l’œuvre de Terrence Malick, colossale malgré son petit nombre de films (la Balade sauvage en 1973, les Moissons du ciel en 1979, la Ligne rouge en 1999 et le Nouveau Monde en 2006), ne s’étonnera pas pourtant de cette introduction chez un cinéaste au tempérament contemplatif, obsédé par la nature et sachant la filmer comme personne – mais une nature animée par l’esprit, comme un reflet d’une réalité invisible qui en est le principe et le soutien. Malick, dont le style mouvant semble perpétuellement frémissant d’un souffle léger qui donne à ce qu’il filme la lumière et la vie, exalte tout au long de son oeuvre la nature, mais en cinéaste habité par la grâce.
La voie de la nature, poursuit la narratrice, sur de tranquilles et magnifiques images de bonheur familial dans l’Amérique provinciale des années 1950, c’est la voie de l’égoïsme, de la satisfaction des appétits personnels, c’est celle qui cherche à imposer sa façon de voir et de faire, quand la voie de la grâce est oubli de soi et générosité gratuite. « La nature est avare et aime mieux recevoir que donner ; elle cherche son bien particulier et personnel. La grâce est généreuse et universelle ; elle ignore son in térêt propre, se contente de peu et croit qu’il y a plus de bon heur à donner qu’à re cevoir », lit-on dans l’Imitation. Et sachant donner, elle sait aussi recevoir et goûter et chérir les beautés de l’existence, tandis que « la voie de la nature trouve des rai sons d’être malheureux quand bien même l’amour rayonne alentour », poursuit la narratrice.
Cette voix qui chante la louange de la grâce, c’est celle de Mme O’Brien (Jessica Chastain, donc, qui réussit à faire exister un personnage passif). Son mari (Brad Pitt, impressionnant de force inquiète), lui, est empêtré dans la nature : Américain archétypal, amoureux de la réussite et méprisant l’échec, croyant fermement que le succès est à la portée de quiconque saura le mériter à force de travail sur son caractère, de dépassement de soi et de déni de ses faiblesses, convaincu qu’il n’y a pas d’obstacle dont une volonté farouche et une absolue rigueur – qu’il confond avec la raideur – ne viennent à bout. On ne s’étonnera donc pas que cet homme ombrageux fasse pour ses trois fils un père tyrannique, de ceux qui ne conçoivent l’éducation que sous la forme du dressage et qui ne réussissent qu’à humilier leurs enfants au prétexte de les rendre plus forts. Jusqu’à ce que l’un d’eux, écœuré, fuie avant l’âge le domicile familial et que l’on apprenne quelque temps plus tard son décès prématuré…
Un délire créatif ordonné par une vision métaphysique
Film sans réel scénario au sens propre du terme, sans progression dramatique linéaire en tout cas, The Tree of Life alterne scènes de la vie familiale, visions de l’adulte qu’est devenu l’aîné des trois frères, Jack (Sean Penn), et plans fascinants, d’une hallucinante beauté, sortis de nulle part, qui évoquent la place de l’homme dans l’ordre du cosmos et le bouillonnement de la vie, de l’infiniment grand à l’infiniment petit : météores s’écrasant sur des planètes lointaines, micro-organismes qui grouillent, supernovas qui évoquent tantôt un gouffre, tantôt une origine matricielle, images d’espaces infinis qui sem blent is sues de quelque aventure futuriste, mais aussi créatures préhistoriques qui font renaître l’aube du monde… Images fulgurantes et folles, oscillant entre sublime et emphase, lyrisme et grandiloquence, qui confinent à la poésie abstraite et font irrésistiblement penser au 2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick, autre cinéaste démiurge et parfois abscons.
La différence est que cette folie créatrice de Malick est ordonnée, comme toujours chez lui, par le recours à la voix off, qui nous donne à entendre les méditations intérieures de Jack et de ses parents et la façon dont ils essaient, tant bien que mal, d’inscrire la disparition du frère et du fils défunt dans l’ordre éternel de la Création : espérance en la survie du fils, qui est aussi une interrogation lancée au Père ; réflexion sur la présence persistante du disparu, dans une autre sphère de réalité, qui est aussi une quête de sa propre immortalité. Malick donne ici libre cours à un mysticisme jusqu’alors plus souterrain dans son oeuvre, mais qui éclate au grand jour dans un finale en forme de profession de foi qu’on pourra, selon son humeur, juger follement audacieux ou basculant dans une naïveté malvenue. Lundi, à Cannes, l’accueil a été mitigé, entre huées et dithyrambes, certains louant l’ambition métaphysique, d’autres dénonçant un prêchi-prêcha simpliste.
Malgré des longueurs, des redites, malgré l’irritation qui peut naître parfois du sentiment d’avoir ici affaire à un cinéaste trop indépendant pour éviter toujours une certaine autocomplaisance, domine pourtant la sublime beauté d’images proprement inouïes d’un film qui ne ressemble à rien de ce que vous avez pu voir auparavant. Qu’il s’agisse d’évoquer des mondes inconnus, la profusion vitale qui anime le monde ou la complicité bienheureuse d’une mère avec son enfant, Malick possède comme personne l’art de renouveler notre regard et, à la manière de Vermeer, de fixer les choses banales avec une intensité telle qu’elles semblent soudain ouvrir une fenêtre sur l’éternité. Le tout au service d’une vision qui possède la simplicité biblique de la biblique vérité : « Sans amour, votre vie passera comme l’éclair.
Laurent Dandrieu
La première phrase a été changée, elle disait initialement, lors de la publication initiale : "The Tree of Life”, le cinquième film du plus rare et du plus génial des cinéastes en exercice, a divisé le public du 64e Festival..
Liberation a écrit:Malick, symphonie n°5
Par DIDIER PÉRON
Très attendu, «The Tree of Life» navigue entre trip cosmique new-age et prière élégiaque. Grandiose.
Cannes, c’est chaque année une extension du domaine de la vulgarité, du luxe autosatisfait, des vigiles veillant à la bonne séparation des riches oisifs et des badauds du tiers état, de la mentalité open bar et des zombis enterrés sous des tonnes de capsules Nespresso. Mais tout ce merdier peut soudain se mettre à graviter comme une déchetterie cosmique en orbite autour d’un astre pur, filant sa trajectoire dans la cathédrale brisée du Palais du festival.
Au bout de dix minutes de projection matinale de The Tree of Life, les pupilles dilatées, on sait qu’on s’en souviendra toute sa vie. Ce n’est évidemment pas un film comme les autres, et Terrence Malick est devenu, depuis la mort de Kubrick, le seul cinéaste ayant fondé son royaume altier et solitaire, farouchement mutique et inaccessible aux médias. Nul mieux que lui ne peut occuper la place de l’artiste barbu et ténébreux capable d’arracher aux studios la plus totale liberté d’action, et les moyens considérables pour parvenir à ses fins. Un an de recherche sur les effets spéciaux, 10 000 garçons auditionnés pour trouver le trio des frères occupant la partie fifties du récit, deux ans de montage (avec cinq chefs monteurs !), annoncé à Cannes en 2010 puis retiré à la dernière minute parce que pas prêt, The Tree of Life transporte avec lui sa légende de fresque poétique grandiose mais aussi de casse-tête maudit et de prière impossible à écrire ou proférer.
Amplitude des pôles. Malick a des ambitions pour le cinéma qui ne coïncident pas forcément avec l’idée que l’on s’en fait aujourd’hui, où des formes plus simplement rêveuses d’un Apichatpong Weerasethakul ou expérimentales brutes du dernier Lynch suffisent à étancher notre soif de sublime (la vodka-pomme ne faisant plus aucun effet). Chez lui, l’amplitude des pôles entre lesquels son inspiration entend naviguer n’a cessé d’augmenter de film en film : les voix les plus intérieures et l’œil le plus transcendant, l’hypersensibilité perceptive aux moindres nuances du monde ambiant, le plus charnel, le plus lumineux, et des poussées de delirium tremens métaphysique où le cinéaste semble entrer en contact direct avec le big-bang et/ou dieu en personne.
Les informations indiscrètes qui avaient filtré des premières projections à Hollywood se sont révélées exactes. Le film se situe bien sur deux époques, les années 50, avec Brad Pitt, et les années 2000, avec Sean Penn. Ce dernier n’était pas à la conférence de presse, il est difficile de savoir si son personnage a été raboté au fil des remontages successifs, mais le fait est que sa partie est réduite à la portion congrue tandis que le film s’attarde sur les relations conflictuelles dans une petite ville du Texas entre O’Brien (Pitt) et ses trois fils dont l’un meurt bientôt, noyé. Ex-officier aux méthodes d’éducations rigides, O’Brien entend endurcir ses rejetons sous l’œil timoré de son épouse (Jessica Chastain). Il ambitionnait une carrière de grand musicien et a fini simple cadre. Son volontarisme carriériste dans l’Amérique conquérante de l’époque est contrebalancé par le jugement négatif de son ainé, Jack. On voit monter la haine dans le regard bleu-sombre de l’enfant, qui découvre avec ses amis le plaisir de la destruction et la désobéissance.
Rhapsodie. Comme toujours chez l’auteur des Moissons du ciel et du Nouveau Monde, le style de la chronique est entièrement retravaillé pour lui donner une inflexion élégiaque. Les événements anodins, les cris, la joie des jeux, le tragique de l’accident, la répétition des repas, les échappées frondeuses : tout advient et disparaît comme une récapitulation éternisée. On pense aux techniques narratives de Tolstoï, avec lequel Malick partage un certain mysticisme et une aura de gourou. Comme dans Anna Karénine, les personnages sont plongés dans un clair-obscur vibrant, chaleureux et menaçant. Nous entendons, à la faveur de l’omniscience du créateur, leurs questionnements intérieurs (et ici, la rhapsodie des voix off est somptueuse), mais nous touchons aussi du doigt le mystère profond de leur destin guidé par quelque chose de plus grand qu’eux. Le regard se porte au cœur des entrailles vives, file hagard à travers les grottes du temps et s’échoue aux bords d’un abîme pulvérulent, où images et sons n’ont plus lieu d’être.
Depuis toujours, chaque plan de Malick est un capteur branché sur des forces telluriques, divines, verticales. Mais jamais il n’avait encore franchi le pas d’une représentation littérale de cet au-delà inhumain. Aidé par Douglas Trumbull, auteur des effets spéciaux de 2001, il plonge le spectateur dans un long bain sidéral, mélangeant prises de vue réelles (cascades, volcans, vues sous-marines…) et bidouillage de peintres post-Dali de l’ère iMac : «On a utilisé des produits chimiques, de la peinture, des teintures fluorescentes, de la fumée, des liquides, du dioxyde de carbone…» explique Trumbull dans le dossier de presse. On a parfois le sentiment qu’ils ont aussi sniffés de la colle et mangé un space cake, surtout à la fin où le sublime s’épuise en gaga new-age inquiétant.
Peu importe, la tambouille philosophique phosphorescente de Malick n’a jamais été ce qu’il y avait de bouleversant chez lui. Non, c’est bien une fois encore la confiance totale, intransigeante et jupitérienne dans l’acte de filmer à perdre haleine, versant l’un dans l’autre tels deux philtres noirs les univers visibles et invisibles jusqu’au point d’éblouissement final.
Jupitérien, tellurique, voilà bien de beaux mots pour parler de son cinéma.
Hugues
- Hugues
How have we lost the eternal?
Un tel "dévouement", une telle "foi" de ta part Hughes, je t'avoue que ca me fout presque la trouille.
- Neoflo
- Messages: 2531
- Inscription: 25 Fév 2003, 00:58
- Localisation: Meudon, France
How have we lost the eternal?
Alors Hugues, heureux ???? 


"c'est quoi le blues". Toujours les mêmes histoires, celles qui font vaciller les mondes et les empires.
John Lee Hooker
John Lee Hooker
- Shoemaker
- Messages: 22441
- Inscription: 24 Nov 2003, 12:11
- Localisation: Out of Africa
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités

